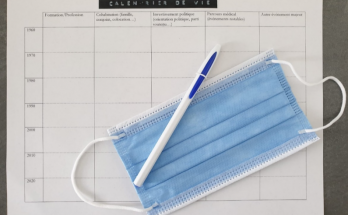Expériences de la pandémie
De mars à mai 2021, entre confinement et enseignements à distance, une classe de master de l’UNIL en sociologie de la médecine et de la santé a mené onze enquêtes au plus près du quotidien d’une variété de métiers, de communautés, de milieux. Les paroles recueillies composent la trame d’expériences partagées et de vécus intimes des événements, une lecture plurielle de leurs existences au cœur de la pandémie.
Une enquête de Nuria Medina Santana et Marjolaine Viret
1. Le scientifique et le politique
Dans la politique, il y a beaucoup de politique – Daniel
Comme pour les relations aux médias, celles à la chose politique est un apprentissage pour les scientifiques. Sur son rapport à la politique, Manuel répond du tac au tac : des hauts et des bas. Il se rappelle surtout une courbe d’apprentissage raide ; je ne connaissais rien à la politique pour être honnête ; je n’aurais même pas vraiment été capable de distinguer les politiques de l’administration, c’était tout la même chose : « Berne », en gros. J’ai dû apprendre. Pour Daniel, probablement aussi ce que cette expérience m’a fait constater de manière plus vive que je n’aurais pu le soupçonner c’est aussi toutes les manœuvres politiques qu’il y a derrière, les gens qui prônent quelque chose en espérant bien qu’on le fera pas, à qui ça permet de se positionner ; et de conclure : Dans la politique, il y beaucoup de politique ; je dirais il y a beaucoup de trucs qui se disent en politique qui sont purement de la politique, qui ne sont pas de la vérité vraie ou même de la cohérence : c’est politique.
Les politiques entendent-ils, malgré tout, les recommandations des scientifiques ? Elles sont toujours prises en compte !, répond Arnaud sans hésitation. On a parfois l’impression qu’on n’est pas écouté, mais en réalité ils nous écoutent. D’ailleurs, les critiques des scientifiques peuvent même servir les politiques – ils vont être dans une position un peu médiane et les gens vont dire « ah heureusement qu’ils n’ont pas écouté les scientifiques on était tous prêts à se dire qu’on allait fermer nos établissements, mais grâce au gouvernement on ouvre [les terrasses] » ; alors que s’ils avaient fait cela sans nos recommandations, les gens auraient dit « ah, ils continuent à nous asphyxier économiquement, ils nous ouvrent même pas nos restaurants ». Lui-même dit toutefois ne pas forcément attendre que les recommandations soient appliquées, alors que ça énerve beaucoup certains de mes collègues.
Le meilleur moyen d’influencer les politiques c’est à travers le public – Manuel
Quand on lui demande s’il a l’impression d’avoir eu une influence sur le politique, Manuel rapporte surtout un sentiment d’absence de transparence, même dans le cadre de la Task Force fédérale : C’était difficile de savoir, là, est-ce qu’ils ont décidé ça parce que nous l’avons suggéré, ou est-ce qu’ils ont décidé quelque chose d’autre parce que nous l’avons suggéré, et ils veulent nous montrer qu’ils ne…, vous voyez… Caroline est plus catégorique – ah bien sûr, oui alors très clairement ; certains experts ont influencé les prises de décision des politiques. L’influence a même pu selon elle basculer dans l’excès, à l’exemple du dépistage – ça a tellement influencé que maintenant, alors qu’on aura une bonne partie des personnes vaccinées ou immunes, on continue à vouloir faire du dépistage à outrance ; parce que les politiques ont entendu ça : « on ne dépiste pas assez en Suisse, il faut dépister, il faut dépister, il faut dépister » ; alors maintenant, la machine est en route : il faut dépister, il faut dépister. La vision de Bernard est un peu à part, puisqu’il a dans ses fonctions travaillé main dans la main avec les politiques. Il voit plutôt son influence de scientifique comme une co-création avec les décideurs et dévideuses, qui est ensuite communiquée via les médias.
Pour Manuel, le meilleur moyen d’influencer les politiques c’est à travers le public. Personne n’aime entendre ça parce que la Suisse aime beaucoup la voie « formelle » […]; si vous voulez vraiment faire bouger les choses, vous devez le faire dans les médias […]; c’est un levier énorme : à partir du moment où quelque chose apparaît dans les journaux, c’est là que les politiciens le remarque. Daniel admet avoir été parfois un adepte de la technique – j’utilise les médias pour ça […]. J’ai parfois envoyé des messages, qui n’étaient pas vraiment « subliminaux », mais dont je savais très bien qu’ils allaient remonter plus haut.
Chacun son job – Arnaud
Qu’est-ce qu’un·e expert·e peut ou ne peut pas faire dans son rapport avec les politiques ? Selon Arnaud, l’expert ne doit pas être partisan, ou le moins possible […]; chacun son job : nous on n’est pas des politiques, et on ne prend pas des décisions […]; nous, on nous demande notre avis : « comment faire pour mieux contrôler la pandémie ? ». Prendre en compte le fait que l’éducation pour les enfants c’est important, ce n’est pas le rôle du ou de la scientifique. Bernard, au contraire, juge nécessaire de se mettre dans la peau des responsables politiques avant de leur faire une recommandation scientifique. Selon lui, la Task Force devrait plutôt donner aux politicien·ne·s des arguments et scénarios pour aider à ouvrir commerces et activités, que des arguments de pure fermeture. Une réflexion donc qui permettrait davantage d’adapter les considérations scientifiques en tenant compte des impératifs politiques. Pour Caroline, la santé publique devrait jouer le rôle de chaînon manquant entre le scientifique et le collectif – l’expert en santé publique doit non seulement tenir compte de l’expert dans le domaine, mais le mettre en relation avec la société, la santé publique. A l’exemple de la transmission chez l’enfant. L’expert virologue il va vous dire « oui, l’étude a montré que sur 100 infections chez les enfants il y a deux cas de transmission chez les adultes. Donc il faut mettre de mesures de prévention » […]; ça c’est l’expert, c’est son job. Le rôle de l’expert·e en santé public c’est de pouvoir mettre des équilibres, de voir les effets secondaires : Maintenant, est-ce qu’on admet quand même qu’il y ait quelques transmissions entre enfants et adultes, ou est-ce qu’on n’admet pas ?
L’expertise est-elle inévitablement une forme d’engagement ? Arnaud ne se pense pas en militant – je ne me sens pas engagé dans des croisades, j’essaie surtout de donner un message qui est le plus proche possible, ou le plus fondé possible sur des données scientifiques qui sont à ma disposition, que je comprends et que j’interprète ; donc si mes interprétations conduisent à penser qu’il y a des erreurs manifestes dans les politiques publiques, c’est pas du militantisme, c’est, je pense, un devoir que de le dire, tout en acceptant, admet-il, qu’on fait parfois ainsi le jeu des militant·e·s. Daniel réfute lui aussi l’idée selon laquelle les scientifiques constitueraient un contre-pouvoir, – c’est plutôt un « co-pouvoir », de mettre de l’huile dans les rouages… c’est pas forcément un contre-pouvoir ; il faut un contre-pouvoir si vraiment les décisions sont fausses. Si on arrive à orienter les décisions et surtout à leur permettre d’être prise sur des bases solides et cohérentes, c’est pas forcément une contre-pouvoir ; c’est un contre-pouvoir seulement si le type d’en face est complètement obtus et refuse d’entendre.
Garder le bateau à flot – Daniel
Si l’expertise peut être critique face au politique, elle n’en reste pas moins une responsabilité. Daniel a cherché ce subtil équilibre dans le fait de critiquer sans déstabiliser l’édifice. Faire une critique constructive, étayée, avec néanmoins le souci de garder le bateau à flot ; parce que si vous êtes sur le Titanic et puis vous dites « le Capitaine est un abruti », alors il y a encore plus de gens qui meurent. Il enchaine – les décideurs, je ne sais pas s’ils l’ont réalisé ou pas mais on aurait pu les descendre en flamme ; je dirais qu’on leur a beaucoup plus souvent sauvé la mise que tiré la chaise au moment où ils allaient s’asseoir. Arnaud voit également l’appartenance à la Task Force comme une responsabilité. Finalement, peu de pression sociale, mais peut-être que je suis trop le nez dans le guidon pour me rendre bien compte! […] Je sens l’importance de l’expertise scientifique dans cette crise, je sens aussi qu’elle a des limites, les limites déjà c’est la prévision. Il dit aussi avoir un profond respect pour la personne politique, respect qu’il pense mutuel.
Bernard a senti une énorme confiance qui s’est instaurée chez les responsables politiques envers les expert·e·s, ce qui est très important car selon lui les politiques et les systèmes de santé doivent être en bonne communication. Manuel se dit, pour sa part, soulagé que les politiques en Suisse soient finalement plutôt plaisants avec les scientifiques, dans le sens où ils ne vont jamais vous donner le mérite de quoi que ce soit, mais ils ne mettront pas la faute sur vous pour quoi que ce soit non plus. Ils et elles prendront donc la décision mais ils et elles en porteront également la responsabilité. De toute façon l’expertise ne peut pas tout, conclut Caroline – ce n’est pas des experts qui peuvent nous sortir de la crise, d’une crise comme ça ; c’est prendre le problème par le mauvais bout ; j’entends, quand on connaît un peu l’épidémiologie et le mode de transmission des virus, on savait très bien que c’était pas des experts, même qui viennent de la galaxie XY et des superhéros qui arriveraient à nous faire sortir de cette crise.
2. L’impact sur la vie privée
Une hygiène de communication – Manuel
Au fil de nos échanges émerge un autre enjeu : s’exposer médiatiquement et assumer que ce « co-pouvoir avec les politiques » a des effets sur la vie personnelle et privée. Arnaud par exemple cloisonne strictement ses activités médiatiques et sa vie privée – je ne donne aucun interview en dehors des heures ouvrables et des jours ouvrables car je considère ça comme mon job, même s’il fait exception pour les interviews par écrit le weekend. Même chose pour les questions auxquelles il accepte de répondre – je ne veux pas verser dans le personnel, ça n’a pas d’intérêt ; il y a une petite tendance, avec le risque, de la starification. Mais il concède, parlant des émissions en direct, il faut être un petit peu soi-même quand même ; on a un lien avec les gens, on plaisante parfois un petit peu, je ne suis pas contre ça.
Mais la cloison entre vie professionnelle et vie privé s’effrite lorsque, comme chez Bernard, le ou la conjoint·e est également médiatisé·e, avec les effets que l’on imagine sur le quotidien familial ou les sujets à table. Par rapport à l’entourage, c’est la reconnaissance et la solidarité qui prédominent. Caroline s’est sentie également préservée par son entourage qui savait qu’elle était fortement sollicitée. Et puis – on peut deviner un sourire sous son masque – j’ai aucun souci à dire « vous ne me téléphonez pas entre 22h et 7h du matin ». Elle s’est aussi peu laissée atteindre par le remue-ménage médiatique : Durant cette année j’ai très, très peu consommé de médias, parce que, juste, pas le temps. De toute manière, elle n’a jamais eu pour coutume d’utiliser les médias comme source d’informations sur ces sujets – souvent quand j’arrivais ici au travail, qu’on me disait « T’as vu ça hier soir », « Ah non, j’ai pas vu… ». Manuel a lui aussi mis en place une hygiène de communication, en rejetant les appels qui ne provenaient pas de contacts connus, en plaçant des filtres sur sa messagerie. Et surtout, je protège mon activité sur les réseaux sociaux, car les bons retours sont l’exception, le reste du temps la personne essaie juste de prendre en otage votre visibilité pour critiquer. Il bloque alors les réponses, comme ça les trolls passent à autre chose – je ne veux pas donner une plateforme à la personne à travers mes tweets.
A chaque fois un coup de poignard – Arnaud
Pour les expert·e·s exposé·e·s dans l’espace public, la face sombre de l’expertise, ce sont les attaques, les insultes, voire les menaces de mort. Pour Bernard, une des choses les plus difficiles à supporter, c’est qu’évidemment, quand on s’engage beaucoup, c’est d’être exposé à la critique, mais c’est vrai que c’est dur des fois et qu’on a envie de leur dire : « Venez à ma place et je vais à la vôtre et on verra, parce que ce n’est pas simple ». Arnaud revient sur les attaques sur les réseaux sociaux – c’est très, très désagréable ; il ne faut pas croire que c’est quelque chose qui laisse indifférent ; c’est à chaque fois – il mime le geste de se frapper en plein cœur – un coup de poignard, quoi ; on le sent de façon émotive et personnelle, c’est très difficile. Mais il insiste pour ne pas faire d’amalgame avec le débat – parfois les débats sont musclés, les gens peuvent trouver que ce que vous dites est stupide, ca, ça ne me gêne pas. Quant aux gens qui le suivent sur les réseaux pour le critiquer, il lui arrive de leur demander : « Pourquoi me suivez-vous ? ». Qui sont ces gens ?, se demande Manuel de son côté. Il ne lit pas ce type de messages, sinon cela pompe mon attention, que je pourrais vraiment utiliser pour d’autres choses. Dans une société libre comme la Suisse, sauf à avoir une protection personnelle – ce qu’aucun·e scientifique n’a – on n’est jamais totalement à l’abri et même les gens mal intentionnés sont libres de s’exprimer, mais ajoute Manuel avec un brin d’ironie, je ne m’inquiète pas trop des gens qui écrivent des lettres ; à la rigueur, je m’inquiète des gens qui n’écrivent pas de lettres. Il souhaiterait que la société prenne ce type de comportement agressif plus au sérieux, mais il cherche à prendre du recul – c’est juste un jeu de pouvoir de quelques personnes ; le schéma est très simple : si vous êtes dans les médias, vous recevez ces lettres. Il n’y a pas de stratégie derrière.
Sans être sur les réseaux sociaux, Daniel lui aussi n’a pas été épargné. Avec pour point culminant cette poudre blanche reçue dans une enveloppe et cinq minutes après j’avais tout le service de sécurité en scaphandre dans mon bureau. Il le prend aujourd’hui à la rigolade, – je me suis bien dit que c’était plutôt du talc ; surtout qu’après cinq minutes j’étais pas mort. Ce qu’il retient, c’est qu’il y avait quand même une détresse dans la population par rapport à une situation qui était extrêmement pesante […]; donc, j’ai un peu un œil clinique sur ce genre de réactions […]; je le voyais plus comme une expression d’une souffrance que quelque chose qui était dirigé contre moi.
Quand je vais au marché, les gens sont sympas – Daniel
Quand on lui parle notoriété, Bernard pense avant tout aux conséquences de l’exposition médiatique de son institution, et il se réjouit que les gens en aient maintenant une meilleure connaissance. De même, Arnaud évoque le sentiment de responsabilité vis-à-vis de l’institution. Les répercussions personnelles lui semblent moins importantes. Bien entendu, mon entourage ou des gens que je vois, des commerçants que je rencontre me disent qu’ils m’ont vu à la télévision […]; mais c’est quelque chose que je connais depuis longtemps, même si c’était pas autant avant […]. En tout cas c’est pas à un point où c’est gênant du tout. Il ajoute sur le ton de la boutade : Le masque sert peut-être ; on me reconnaît moins. Manuel, plaisante aussi sur l’obligation du masque qui a du bon – les gens ne vous reconnaissent pas aussi vite. Il est clair qu’au début, dans certaines régions, j’étais immédiatement reconnu, et abordé ; je ne pouvais plus vraiment sortir dans un restaurant sans m’apercevoir que les gens chuchotaient entre eux, montraient, regardaient du côté de ma table. Il est curieux de voir si cela aura des conséquences pour sa vie privée, mais c’est trop tôt pour le dire. Si la Suisse a la réputation d’être un pays où les personnages publics sont encore relativement préservés et les gens les laissent tranquille, Manuel relève toutefois que comme toute crise celle-ci a montré le meilleur comme le pire chez les gens.
Daniel prend quant à lui sa nouvelle renommée avec humour : Quand je vais au marché, les gens sont sympas ; avant, quand j’allais au marché, j’étais complètement anonyme, tandis que maintenant il y en a deux ou trois qui me reconnaissent et qui discutent, le poissonnier, le marchand de légume et autres, on discute chaque fois de ces trucs-là. L’idée de retomber dans l’anonymat ne l’effraye toutefois pas, il s’imagine volontiers disparaissant dans la mémoire collective de façon à pouvoir mener ma vie à moi, sans avoir à me soucier de ce que je pourrais dire ou ne pas dire.
3. Et la suite dans tout ça ?
Daniel insiste, – on a quand même un débriefing assez sérieux à faire sur la gestion de la pandémie, mais il ne se fait pas trop d’illusions : La peur qu’on peut avoir c’est que dès que tout ça sera fini, tout le monde va recommencer à danser, remettre la musique à fond, et oublier ce qui s’est passé […] ; si la science pouvait plus être associée à la gestion du pays, je pense qu’on y gagnerait. Même si on était déjà pas si mal loti en Suisse, il espère que la pandémie aura eu un impact favorable si la population a pris l’habitude d’entendre, pas seulement des politiciens qui leur envoient des « oukases », mais aussi des scientifiques de toutes les spécialités qui seraient pertinentes, s’exprimer sur certains sujets ; si la population a l’impression en somme que l’organisation de leurs affaires est gérée sur la base de faits scientifiques solides, mâtinés de considérations politiques. Parce que tout est politique en un sens.
Cette expérience a donné à Manuel une prise de conscience nouvelle de ce que cela signifie d’être « exposé au public » ; et aussi ce que cela signifie d’avoir un impact, aussi minime soit-il. La pandémie a mis en lumière la puissance de plus en plus grande de communication et de délibération de la science et des scientifiques. Actuellement, la plupart des scientifiques sont content·e·s, ils et elles se disent : « Oh, tiens, on a du pouvoir », mais pour lui le retour de bâtonrisque d’être brutal : S’il y a une chose que le pouvoir n’aime pas, c’est d’être contesté, et d’évoquer les tendances aux États-Unis d’une forme d’animosité envers la science. En Suisse, on a l’habitude de cette coexistence heureuse l’un à côté de l’autre […] ; et, à cause du choc, les politiciens étaient contents de demander – « Dites-nous que faire ! ». Mais déjà une fraction considérable commence à se révolter, ce qui pourrait se répercuter sur les financements de la recherche, et les scientifiques pourraient être forcé·e·s de prendre parti.
Pour Caroline, le rôle de la santé publique doit être revalorisé en vue de la gestion des crises futures, pour conseiller les décideurs et dévideuses. Il y a eu une volonté pendant des années, des dizaines d’années, de reléguer tout ce pan de santé publique aux oubliettes. Et Manuel d’insister, la Suisse fait de la recherche en santé publique de pointe au niveau mondial, mais notre propre administration, surtout au début, nous a complètement snobés […]; nous avions très peu de ponts.
Tout·e·s sont d’accord, l’expertise doit être au service de la société, de toute la société. Bernard conclut en évoquant que la pandémie a également été un révélateur d’inégalités sociales et l’a convaincu de la nécessité de s’engager, même en dehors du strict cadre professionnel. Pour laisser le mot de la fin à Arnaud : Toute cette expertise, j’ai toujours une très profonde préoccupation qu’elle n’atteigne pas des segments entiers de la population, parce que ce que l’on dit est compliqué ; les gens moins éduqués, les migrants qui ne parlent pas notre langue, les couches sociales défavorisées, peut-être les gens qui ont des handicaps, sont beaucoup plus vulnérables parce qu’ils n’entendent pas ou ils ne comprennent pas une partie des messages. C’est ça qui m’inquiète le plus, beaucoup plus que les controverses, beaucoup plus que ceux qui ne sont pas d’accord avec moi. Même s’il ne prétend pas avoir la solution, il faut qu’on aille les chercher et qu’on ne les oublie pas.
Pour aller plus loin // L’expert·e exposé·e. // Partie 1. Expériences de scientifiques médiatisé·e·s durant la pandémie de COVID-19

De mars à mai 2021, entre confinement et enseignements à distance, une classe de master de l’UNIL en sociologie de la médecine et de la santé a mené onze enquêtes au plus près du quotidien d’une variété de métiers, de communautés, de milieux. Les paroles recueillies composent la trame d’expériences partagées et de vécus intimes des événements, une lecture plurielle de leurs existences au cœur de la pandémie.
Un projet accompagné par Francesco Panese et Noëllie Genre.