Par Christian Grosse
Chaque épidémie expose ceux qui accompagnent malades et mourants à des conditions particulières. Tandis qu’aujourd’hui ceux qui exercent cette activité d’empathie doivent se plier aux règles de distance sociale, les pasteurs du XVIe siècle étaient contraints au contraire d’intervenir directement auprès des malades, au péril de leur vie.
Moins de dix ans après la conversion de Genève à la Réforme (1535), une sérieuse crise met à l’épreuve la capacité des pasteurs qui ont remplacé les prêtres à assumer l’une des fonctions pastorales essentielles : l’accompagnement spirituel des malades. Cette crise éclaire à la fois certains enjeux du passage à la Réforme et les conditions dramatiques dans lesquelles s’exerçaient cette activité d’accompagnement en temps de peste. Elle met ainsi en lumière les mesures exceptionnelles qui sont prises dans les circonstances d’une épidémie de peste et permet, par comparaison, d’éclairer également les difficultés auxquelles font face ceux qui assument ce type de fonction dans le contexte actuel de la pandémie.
La Réforme insiste fortement sur le fait que les vivants ne peuvent avoir aucune influence sur les âmes et que le destin spirituel des morts appartient à Dieu seul. Elle rejette donc le purgatoire catholique – cette phase transitoire entre enfer et paradis pendant laquelle les proches comme l’Eglise peuvent élever des prières en faveur de ceux qui y subissent des peines purificatrices, pour en abréger la durée – et s’oppose aussi à toute intervention ecclésiastique au moment des funérailles. Elle insiste en revanche d’autant plus sur l’importance de la présence des pasteurs auprès des malades et des mourants : c’est sur la scène de l’agonie que le rappel des promesses de salut auquel les pasteurs doivent se livrer prend tout son sens et que la théologie réformée doit donner la démonstration de son efficacité consolatoire. La Réforme joue par conséquent une partie de son crédit auprès de populations qui ne sont souvent convaincues que de manière mitigée par son discours, en prouvant sa capacité à prodiguer effectivement de la consolation dans les derniers instants de la vie, particulièrement en temps d’épidémie. Signe de cet enjeu, les premières liturgies rédigées par les réformateurs et toutes celles qui suivront contiennent non seulement des formulaires pour la célébration du culte ordinaire, du baptême, du mariage et de la communion, mais aussi des instructions pour « la visitation des malades ».
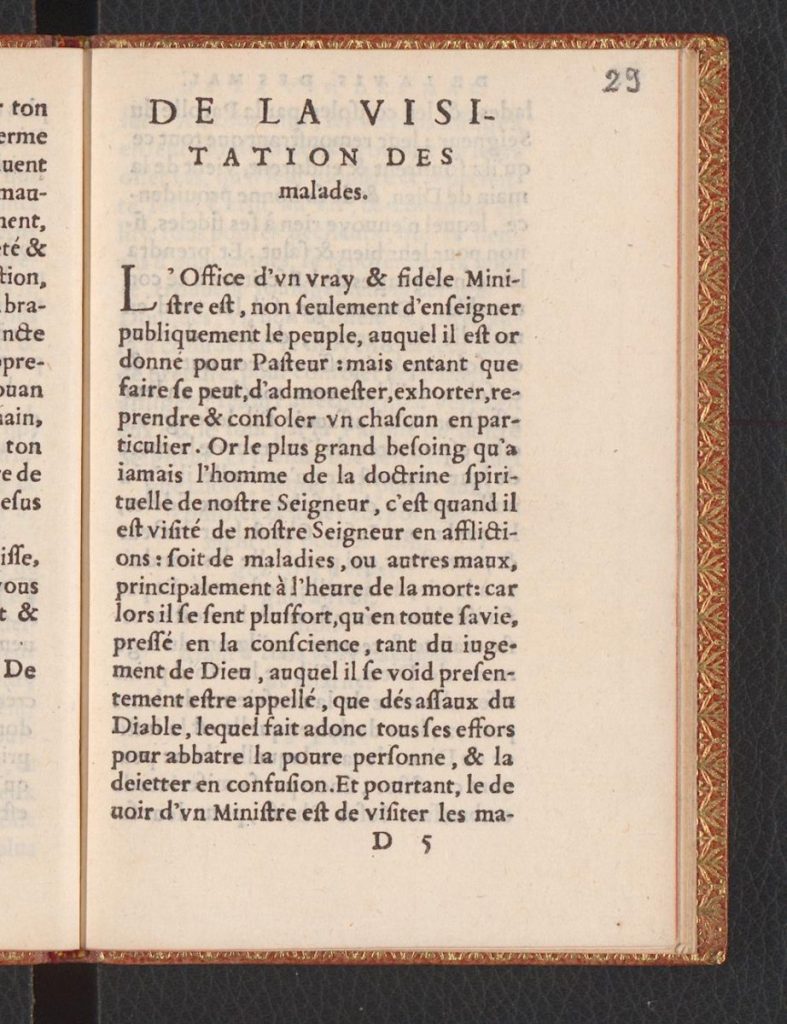
S’inspirant d’un texte précédent écrit par Guillaume Farel (1489-1565), la liturgie composée par Jean Calvin (1509-1564) et qui sera employée jusqu’à la fin du XVIIe siècle quasiment sans modifications, paraît en 1542 et contient également une telle instruction. Or ce formulaire liturgique est publié alors même qu’une épidémie de peste se déclare à Genève et pousse les autorités de la ville à mettre les pasteurs devant leurs responsabilités. Le 25 septembre, les magistrats leur demande d’envoyer l’un des leurs « pour consoler les malades » dans l’hôpital pestilentiel situé hors des murs de la ville[1]. Parmi la petite dizaine de pasteurs que compte alors l’Eglise de Genève, un seul, Pierre Blanchet, offre « d’un grand cueur » sa candidature pour ce poste risqué[2].
Les conditions de travail auxquels il est soumis permettent de prendre la mesure de son courage. Contrairement à ceux qui prennent aujourd’hui en charge l’accompagnement spirituel en s’efforçant de maintenir les distances destinées à préserver la santé de tous, il est en prise directe avec les malades, confiné avec eux dans l’hôpital pestilentiel. S’il officie aux côtés d’un responsable de l’hôpital et d’un chirurgien, il assume de multiples fonctions qui indiquent bien la létalité de la maladie qui sévit : quelques jours après que sa candidature a été acceptée, il est également nommé notaire[3]. Cela signifie qu’il a non seulement pour tâche de prodiguer un réconfort spirituel aux malades en les rassurant sur la promesse de salut, mais qu’il est en même temps habilité à recueillir et à enregistrer les dernières volontés des mourants.
Malgré la proximité qu’il doit ainsi entretenir avec les malades, il survit à son engagement et rentre en ville en décembre, lorsque la pression épidémique se relâche. Au mois de mai de l’année suivante, la peste fait cependant à nouveau des ravages. Les pasteurs sont par conséquent à nouveau sollicités par les magistrats pour lui trouver un remplacement afin de continuer à « so[u]lager et console[r] les povres infect[s] de peste »[4]. La réaction paniquée de certains d’entre eux indique bien la terreur que leur inspire la perspective de se retrouver enfermé avec les malades entre les murs de l’hôpital pestilentiel : ils répondent en effet qu’ils préfèrent aller au diable ou au gibet que d’assumer cette fonction qui relève pourtant de leur ministère[5]. Le brutal refus que certains ministres ont opposé aux autorités provoque immédiatement une crise puisque le gouvernement de la ville ordonne de mener une enquête, en menaçant les pasteurs récalcitrants de les déposer si leur désobéissance est avérée. C’est en effet la capacité des ministres réformés à succéder à l’ancien clergé catholique dans l’une de ses tâches pastorales essentielles auprès des fidèles dans une situation de détresse spirituelle qui est remise en cause si la Compagnie des pasteurs ne parvient pas à désigner l’un de ses membres pour se consacrer aux malades. Quelques jours avant cette crise, un fidèle avait en effet laissé entendre que les pasteurs « ne veulent pas aller visiter les malades »[6].
On ne connaît malheureusement pas le détail des négociations qui ont permis d’aboutir à une solution. Mais une dizaine de jours plus tard, c’est à nouveau Pierre Blanchet qui est désigné pour secourir spirituellement les « povres infects de peste ». Sans doute n’a-t-il pas eu de scrupule de profiter de la position de force dans laquelle le mettait le désistement de ses collègues, puisqu’il obtient que les magistrats prennent en charge sa subsistance et qu’une rémunération supplémentaire par rapport à son gage ordinaire lui soit versée. C’est à ce prix que la crise a pu être résolue – mais momentanément seulement. Moins de trois semaines après son retour à l’hôpital pestilentiel, Pierre Blanchet succombe à la contagion, « par le bon vollyer de Dieu ». Son décès relance la crise puisque les ministres sont à nouveau convoqués pour désigner celui qui prendra sa succession dans cette tâche fatale. Cette fois, leur réponse est encore plus franche : ils avouent sans détours que « nul d’eulx n’on[t] la constance d’allé à l’hospital pestilencial combien », reconnaissent-ils, « que leur office porte de servyr à Dieu et à son Eglise bien en prosperité que en neccessité jusques à la mort ». Prenant les pasteurs au mot, les magistrats insistent sur le fait que « leur office » consiste en effet à « servyr l’esglise cristienne », non seulement en période de sérénité, mais aussi « en temps de guerre et de peste et aultres neccessités ». Sous la pression, le pasteur français Matthieu Geneston accepte de s’exposer, offrant ainsi une issue à la crise. Quelques semaines plus tard, il est atteint par la peste et secouru par les magistrats, tandis que son épouse meurt de la même maladie[7].
Le courage de Matthieu Geneston aura pourtant offert une issue à la crise. Il aura surtout permis à la Compagnie des pasteurs de maintenir, mais sur le fil, l’ensemble des engagements qui lui incombaient et de garantir ainsi la continuité de l’encadrement spirituel exercé par l’Eglise. A peu de choses près, la peste aurait donc pu mettre en danger la succession de l’Eglise catholique revendiquée par les réformateurs. L’épilogue de cette crise se situe toutefois à quelques années de là et sur un autre terrain que celui de l’épidémie. Dans les circonstances dramatiques de cette épidémie, outre Blanchet et Geneston, deux personnalités se sont montrées assez déterminées pour affronter leur destin. Calvin, d’abord : dans sa correspondance avec le réformateur vaudois Pierre Viret (1511-1572), il a témoigné de sa résolution à assurer la visite auprès des malades. Mais les magistrats ont écarté sa candidature pour le garder au service de l’Eglise. Sébastien Castellion (1515-1563) ensuite. Mais sa candidature est également écartée au motif qu’il n’est pas ministre, bien qu’il y aspire, puisqu’il est seulement régent de l’Ecole de Genève. Ce statut lui a vraisemblablement permis d’échapper au sort de Pierre Blanchet. Ainsi ont survécu à cette flambée de peste deux figures qui vont s’affronter dix ans plus tard. Après la condamnation à mort de l’antitrinitaire Michel Servet (1511-1553), brûlé à Genève le 27 octobre 1553, à la suite d’une dénonciation de Calvin, c’est Castellion, qui, de Bale où il réside désormais, prend la plume pour protester et formuler dans son Traité des hérétiquesune des premières défenses des principes de tolérance, déclenchant ainsi une longue controverse. L’épidémie de peste de 1542-1543 est ainsi liée à deux grandes crises traversées par l’Eglise réformée de Genève durant les vingt premières années de son histoire.
[1] Registres du Conseil de Genève à l’époque de Calvin, publiés sous la dir. des Archives d’Etat de Genève, t. VII, Genève, Droz, 2018, p. 472.
[2] Ibid., p. 516.
[3] Ibid., p. 526.
[4] Archives d’Etat de Genève, R.C. 37, f. 77v (30 avril 1543).
[5] Archives d’Etat de Genève, R.C. 37, f. 80 (1er mai), f. 82 (2 mai 1543).
[6] Registres du Consistoire de Genève au temps de Calvin, t. I, publ. par T. A. Lambert et I. M. Watt, Genève, Droz, 1996, p. 232 (26 avril 1543).
[7] Joannis Calvini Opera quae supersunt omnia, éd. établie par G. Baum, E. Cunitz et E. Reuss, 59 vol., Brunswick, Berlin, Schwestschke et Fils, 1863-1900, vol. 21, cc. 313-318 (1er juin – 30 août 1543).
Christian Grosse est Professeur ordinaire en Histoire et anthropologie des christianismes modernes à l’Institut d’histoire et anthropologie des religions (IHAR) de l’Université de Lausanne. Il s’intéresse à l’anthropologie historique des cultures religieuses dans l’Europe moderne (XVIe-XIXe siècle) et à l’histoire de l’histoire des religions.




