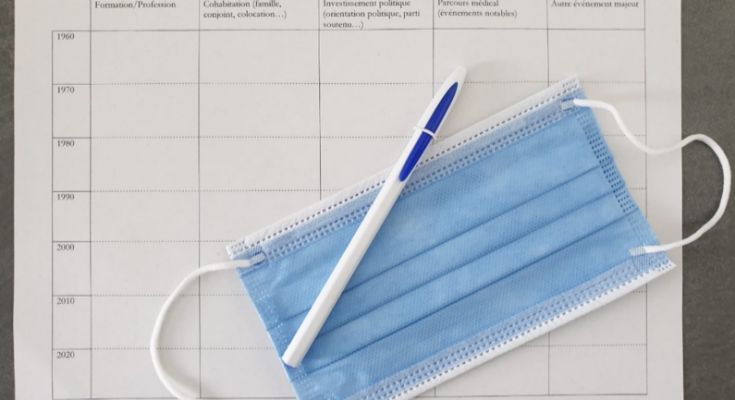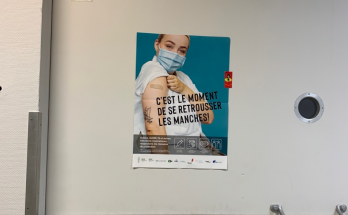Expériences de la pandémie
Lors du cours-séminaire « Sciences sociales de la médecine et de la santé » qui s’est déroulé en 2022/23 à l’UNIL sous la houlette de Laetitia Della Bianca, Céline Mavrot et Francesco Panese, une classe de master de l’UNIL en sociologie de la médecine et de la santé a mené des enquêtes au plus près du quotidien d’une variété de métiers, de communautés, de milieux autour de la thématique cruciale des vaccins. Les paroles recueillies et/ou les problématiques abordées composent la trame d’expériences partagées et/ou de vécus intimes en lien avec cette problématique.
Une enquête de Carla Cela et Valentine Mach-Perrot
À l’origine de la méfiance vaccinale : entre continuité historique et rupture biographique
Le contexte de la pandémie Covid-19 a ébranlé les fondements sociaux, médicaux et épistémiques de notre société contemporaine. Certaines mesures que l’on pensait disparues (le confinement, les quarantaines) ont refait surface, et un nouveau type de vaccin a été créé dans l’urgence (Moser, 2020 : 103). À la suite de sa mise en circulation sur le marché, de nombreuses contestations et questionnements à son sujet se sont fait entendre dans les arènes politiques, sociales et médicales.
Mais cette contestation n’est pas un phénomène nouveau. En effet, déjà depuis l’introduction de la pratique vaccinale au XIXe siècle, le mouvement antivaccin est présent et dénonce ce procédé dans l’espace public (Salvadori et Vignaud, 2019). Dans le contexte du Covid-19, ce vaccino-scepticisme a pris de l’ampleur. La présence active de collectifs « antivaccins » dans l’espace public (physique et numérique), ainsi que de nombreux·euses opposant·e·s individuel·le·s aux profils variés et aux parcours de vie hétérogènes, se sont rencontrés pour lutter contre la campagne de vaccination. Ces individus aux orientations politiques diverses ont formé une coalition contre les vaccins Covid. Afin de mieux comprendre cette méfiance vaccinale, nous avons voulu, d’une part, identifier différents types d’argumentaires antivaccins (propres aux dimensions politiques, morales et épistémiques du vaccin) et, d’autre part, comprendre en quoi le parcours de vie peut affecter l’attitude des individus par rapport au vaccin.
Nous nous demandons comment les individus auto-évaluent leur méfiance face à la vaccination contre le Covid-19 et à quelles causes ils et elles l’attribuent. Pour accompagner notre questionnement, nous avons posé deux hypothèses. La première porte sur le fait que les arguments et répertoires mobilisés par les opposant·e·s à la pratique vaccinale sont similaires à ceux émis contre les autres types de vaccin (variole, rougeole) malgré les époques différentes. Nous pouvons donc parler d’arguments « transhistoriques », c’est-à-dire des arguments similaires, qui se répètent dans le temps, malgré les changements de contextes (Eribon, 2004). L’intérêt de ce questionnement réside dans le fait que, malgré les changements de contextes historiques et sociaux, certains « schèmes de langage » reviennent lors de différentes campagnes vaccinales. Notre seconde hypothèse, présentée dans l’article suivant, postule que l’argumentaire choisi par les non-vacciné·e·s est lié à une ou plusieurs ruptures biographiques (du Breil de Pontbriand et Brugaillière, 2019). Il nous semble pertinent de mettre en lumière de potentiels liens entre l’argumentaire et le vécu.
Notre démarche est « hypothético-déductive », c’est-à-dire que nous posons des hypothèses tirées de nos lectures préalables, et « itérative », dans le sens où nous effectuons des aller-retours entre nos données empiriques et notre littérature secondaire. Nous avons réalisé quatre entretiens avec des individus refusant la vaccination contre le Covid-19. Le recrutement de nos participant·e·s s’est fait principalement par le bouche-à-oreille dans nos cercles de connaissances personnelles afin de recruter rapidement différents profils d’individus. L’analyse que nous avons faite de ces entretiens est discursive et énonciative : le contenu ainsi que la forme des discours ont été observés. Nous avons effectué une analyse avec pour considération première le langage et les termes employés, pour dégager 1) les arguments d’opposition au vaccin, ainsi que 2) les raisons du refus vaccinal liées à la trajectoire de vie de nos participant·e·s.

1) Les répertoires argumentatifs de l’opposition vaccinale
A l’observation de la littérature, trois répertoires d’opposition à la vaccination sont saillants (Galchen, 2022 : 68). Premièrement, le refus du vaccin est un choix politique selon Ollivier-Yaniv (2017) et Guimier (2021) car celui-ci s’inscrit pleinement dans un contexte politique et social, dans lequel la vaccination joue un rôle central pour la préservation du lien social entre les individus. Le vaccin a une fonction importante en ce qu’il rassemble les individus ou les éloigne ; il devient une composante même des fondements du lien social. En somme, la vaccination et la méfiance qui l’accompagne nous renseignent sur le rapport qu’entretient la population avec les autorités politiques en place (Guimier, 2021 : 230). En effet, la méfiance vaccinale semble étroitement corrélée avec la confiance envers les autorités politiques et sanitaires. Le refus de la vaccination serait lié au refus des décisions des politiques et celui-ci s’inscrit donc pleinement dans une contestation sociale (Zielinska, 2021 : 150).
Le second répertoire se rapporte à un argumentaire moral et émotionnel (Zylberman, 2020 : 118). Dans le contexte de la vaccination, pour opérer le choix de se faire vacciner ou non, les individus se questionnent sur le bien-fondé de leur décision selon des critères moraux et émotionnels qui leurs sont propres (selon nos données, la peur des effets secondaires du vaccin, la colère contre l’ingérence de l’État, notamment). Pour illustrer ce répertoire, nous nous appuyons notamment sur le concept « d’économie morale » théorisé par Didier Fassin (2009 : 1242-1244) et Janet Roitman (2000 : 49). Le terme d’« économie morale » met en avant une imbrication entre, d’une part, les réalités matérielles découlant des instances politiques et sanitaires, et d’autre part la production de normes et d’attitudes sociales dans lesquelles ces dimensions morales et émotionnelles prennent une grande place. En effet, la vaccination comme préoccupation sociale engendre un avis chez tout individu ainsi que certaines émotions présentées physiquement (rougir de gêne, par exemple) et discursivement (exprimer de la colère où de la peur par les mots, comme le font nos interlocuteur·ice·s) (Kaufmann, 2020). Les émotions ont une composante corporelle et interactionnelle qui permettent de saisir la manifestation de différentes configurations morales dans une « économie morale » de la vaccination (Fassin, 2009 ; Kaufmann, 2020).
Le troisième répertoire relève du domaine épistémique, c’est-à-dire des arguments renvoyant à la formation de certaines connaissances médicales avancées par les acteur·ice·s. L’un des arguments majeurs à l’encontre du vaccin est un doute quant à son efficacité et à son innocuité. En effet, la dangerosité des vaccins est un argument présent depuis la découverte du procédé (Salvadori et Vignaud, 2019). Pour contrebalancer ce remède allopathique, des formes de thérapies alternatives considérées comme plus naturelles et saines sont prônées. Leurs défenseurs·euses déplorent les « substances chimiques » présentes dans le vaccin et lui préfèrent des gestes qu’ils et elles considèrent comme plus sains. On peut donc voir émerger différentes formes de communications se plaçant sur un spectre allant de pseudo-scientifique à « anti-scientifique », justifiant le refus vaccinal et proposant des alternatives.
Pour observer comment nos interlocuteurs·trices « font parler » des êtres imaginaires et des principes et valeurs généraux, des discours émis dans d’autres contextes que celui présent, la notion de « ventriloquie » théorisée par François Cooren (2010) nous sera précieuse afin de dégager des arguments plus larges et généralisables. Celle-ci se rapporte au fait que les individus parlent au nom d’institutions et de principes[1]: « (…) la ventriloquie (…) permet de reconnaître l’agentivité de l’interlocuteur tout en montrant comment celui-ci fait aussi parler (…) quelque chose, quelque chose qui se met alors à agir par le biais de sa performance ». Nous utiliserons donc le terme de ventriloquie au sens de donner sa voix à une chose, une institution ou à des valeurs.
« Simplement en fait on ne m’a pas donné de bon argument, on ne m’a pas donné de raison de me faire vacciner » (Vladimir)
Dans nos entretiens, une typologie d’arguments similaires à ceux de notre cadre théorique est présente (l’argumentaire politique ; l’argumentaire moral et émotionnel et l’argumentaire épistémique).
Nous allons observer les différentes positions présentes sur le procédé vaccinal pour voir comment celles-ci se rejoignent ou au contraire sont antagonistes.
« J’ai toujours été … pas antisystème (…) mais à remettre en question beaucoup. » (Louise)
Dans leurs paroles, plusieurs de nos participant·e·s ont relevé la dimension politique de la vaccination, tant dans sa campagne de promotion que dans l’acte effectué. Le rôle qu’a pris l’État dans la promotion de la vaccination a été largement dénoncé : « l’État voulait que les populations se vaccinent, c’est logique. (…) je me suis rendu compte tout de suite que si je faisais 5 minutes de recherche, je tombais sur des avis très orientés. Ça c’est un truc qui m’a beaucoup dérangée (…) c’est une grande valeur pour moi la liberté d’expression, le fait que tous les points de vue soient ok » (Louise, 23 ans, éducatrice sociale). L’interlocutrice fait parler une voix abstraite communément admise sur l’importance de la liberté d’expression et le respect des opinions pour critiquer la gestion de la crise par les autorités fédérales (Cooren, 2010). Par ce relais, nous observons des arguments souvent utilisés par les opposant·e·s à la vaccination pour légitimer leur refus. Cette critique du rôle intrusif de l’État est aussi présente dans d’autres témoignages : « L’obligation m’a dérangé, l’État qui vient te dire quoi faire comme une maman qui veut te protéger, ça m’a beaucoup déplu » (Vladimir). L’État est personnifié, comme si l’institution était un·e gouvernant·e avec des volontés et des agissements propres qui ont des conséquences sur les êtres sociaux (Mabileau, 1960). Cette mobilisation de l’État comme être fait que les personnalités politiques et leurs décisions disparaissent dans l’entité institutionnelle abstraite de « l’État ». Cette entité est, dès lors, assignée à une place de dirigeant·e·s alors qu’elle est une réalité invisible qui constitue une institution (Maulin, 2012). En ce sens, ce n’est pas tant la pratique vaccinale qui est critiquée et contestée mais les pressions exercées par l’État sur les individus, car, dans une démocratie où les libertés individuelles et les droits des individus sont pris en compte, il semble inenvisageable pour nos interlocuteurs·trices que l’État contraigne les individus à un acte impliquant leur corps (Zylberman, 2020 : 234). Une contestation de la place de l’État pendant la crise est présente et peut possiblement traduire une certaine méfiance des autorités dans ce contexte précis, car nos participant·e·s reprennent une rhétorique de dénonciation du rôle de l’État, émanant souvent de partis ou mouvements libéraux, et l’incarnent par leur discours (Guimier, 2021 : 230 ; Cooren, 2010).
Durant la pandémie un panel de mesures a été décidé : la fermeture des commerces, des restaurants, des hautes écoles, le port du masque, la distanciation sociale, l’injonction à la vaccination, puis le Pass sanitaire. Dans un premier temps, nos interlocuteurs·trices ne contestaient pas les mesures prises et les comprenaient. Mais lorsque celles-ci ont perduré et les vaccins promus, nos participant·e·s relèvent avoir perdu confiance en les autorités et en le bien-fondé des décisions et de la vaccination : « Du coup-là, j’ai commencé à perdre confiance dans l’Etat (…) quand je voyais qu’on commençait à parler de Pass sanitaire et tout ça (…) je ne voulais pas ça quoi donc là j’ai clairement eu un… blocage au sujet de l’Etat. » (Vladimir). La parole de nos différent·e·s interlocuteurs·trices exprime le positionnement suivant : accepter le vaccin, c’est accepter les injonctions de l’État et la politique sanitaire plus largement (Zielinska, 2021). A cette critique du rôle de l’État s’ajoute l’argument du droit au choix des individus en démocratie : « on a le droit de prendre son temps, de réfléchir, puis même de se tromper hein, c’est bon on a le droit » (Louise). Cet argument peut être transposé dans n’importe quelle situation vécue, car il est assez général. En somme, les participant·e·s « font parler » un discours libéral pour justifier leur choix de ne pas se faire vacciner (Cooren, 2010). Cette mention des droits individuels montre l’importance que nos interlocuteurs·trices accordent à la marge de manœuvre possible, présente pour toute pratique médicale impliquant le corps, sauf pour la vaccination contre le Covid-19 : « Moi je déteste qu’on me dise : « Ok c’est un libre-choix par contre si tu ne le fais pas ta vie va devenir un enfer (rire gêné) ». Bon bah du coup, ce n’est pas un choix. » (Louise). Selon ces dires, l’injonction au vaccin contre le Covid par les autorités suisses a ébranlé les valeurs centrales de la démocratie helvétique, à savoir, la liberté de choix et les droits individuels « performés »[2] par les discours de nos participant·e·s (Austin, 1991).
« C’est encore très émotionnel et ça le restera encore un moment. » (Louise)
Dans le discours de nos interlocuteurs·trices, le refus du vaccin est associé à une dimension émotionnelle forte imbriquée à une dimension morale. Nous avons donc affaire à une « économie morale » de la vaccination[3], laquelle est traversée par des tensions et des conflits (Fassin, 2009 : 1257 ; Roitman, 2000 : 49) car à la réalité de la pandémie Covid-19 et de la pratique vaccinale s’associent des attitudes morales spécifiques pour les vacciné·e·s et pour les non-vacciné·e·s que nous nommons des configurations morales. Ces attitudes morales peuvent se rapporter : au sentiment de peur pour les personnes âgées ; à la volonté de protéger ses proches ; au questionnement du vaccin en termes de coûts et de bénéfices, comme relevé dans notre enquête.
Parfois, ces différentes configurations morales se confrontent, car les vacciné·e·s et les non-vacciné·e·s se basent sur des attitudes morales différentes ou parfois similaires mais détournées (comme se vacciner pour se protéger du virus / ne pas se vacciner pour se protéger du virus).
La première configuration morale observable se rapporte à la notion « transhistorique » (Eribon, 2004) de calculs bénéfice-risques pour justifier le refus vaccinal : « chaque vaccin c’est un choix et c’est un calcul bénéfice-risque » (Louise). Nos interlocuteur·trices « font donc parler »[4] un argument très ancien qui permettait aux individus de faire le choix vaccinal, plutôt que de risquer d’attraper la maladie (Salvadori et Vignaud, 2019). En effet, cette notion de calcul bénéfice-risque est morale dans le sens où les facteurs pris en compte dans ce calcul ont des tenants émotionnels : le risque encouru implique une peur et le potentiel bénéfice (la protection ou la solidarité) n’est pas suffisant (Salvadori et Vignaud, 2019). À cette dimension de calcul, s’associent également les sentiments et émotions collectives que les individus ont partagés sur la vaccination. Typiquement, nos participant·e·s soulignent d’une voix unanime ne pas avoir eu peur pour eux, mais surtout pour les personnes âgées, ce qui constitue une deuxième configuration morale : « Alors je n’ai pas vraiment eu peur, non. Puis justement, j’ai eu peur quand ma grand-mère elle l’a eu, j’avais peur pour elle, vu qu’elle a presque 90 ans (…). Mais après, quand finalement, elle n’a pas eu grand-chose, ça m’a un peu rassurée. » (Anna, 30 ans, psychologue et aide-pharmacienne). La peur pour les personnes âgées et vulnérables est saillante dans le discours de nos interlocuteurs·trices : « moi j’ai eu peur, mais j’ai eu peur pour les vieux de ma famille. » (Louise). Cette émotion est partagée par nos participant·e·s car elle se base sur des schèmes culturels communs dans lesquels il est nécessaire de protéger les personnes les plus vulnérables (Kaufmann, 2020 ; Polo et al., 2013 : 45). Typiquement, la mention de nos participant·e·s de leur crainte pour leurs grands-parents entre pleinement dans ce cadre. Toutefois, la crainte pour leurs proches n’a pas été suffisante pour que nos interlocuteurs·trices fassent le choix vaccinal. A notre sens, il est possible que la nécessité de préserver leur propre liberté de choix a été plus forte pour nos participant·e·s que la volonté de préserver leurs proches par le vaccin. La plupart de nos interlocuteurs·trices sont jeunes et il y avait possiblement la crainte de « rater » une étape de leur développement s’ils ou elles restreignaient leur liberté de choix et de mouvement. Il semblait donc plus simple pour nos participant·e·s de moins voir leurs proches « fragiles » que de se contraindre au choix vaccinal qu’ils et elles ne feraient pas pour eux-mêmes. En effet, nos interlocuteurs·trices « ventriloquent » cette idée de la force de la jeunesse, souvent mentionnée, vis-à-vis de la maladie Covid (Cooren, 2010). Ils et elles relèvent que le Covid n’est pas dangereux pour eux, alors que le vaccin l’est possiblement : « Pour un jeune en bonne santé, clairement le vaccin peut-être plus dangereux que le virus » (Vladimir). Cette idée constitue donc une troisième configuration morale propre aux personnes désirant ne pas se faire vacciner et intégrant « l’économie morale » de la vaccination (Fassin, 2009 : 1257 ; Roitman, 2000).
Une autre émotion que nos interlocuteurs·trices relèvent avoir ressentie est celle de la colère de la contrainte vaccinale perçue, notre quatrième configuration morale : « j’ai été exclue et j’ai été en colère » (Louise). Cette émotion de colère se rapporte à la contrainte de la vaccination, pas au procédé en lui-même : « Et puis j’étais aussi énervé que (…) ces gens se sont vaccinés justement pour aller au restaurant ou sortir voyager (…) j’étais assez énervé du coup que l’État les ait obligés à injecter ce truc » (Vladimir). Cette émotion de colère collective peut donc possiblement s’allier à de la contestation et à du rejet des mesures imposées par l’État. Dans ces témoignages, l’État est érigé comme l’autorité qui contraint, ce qui nous fait penser que nos participant·e·s étaient plus opposé·e·s aux mesures et aux contraintes répétées qu’à la vaccination en soi, ce qui renvoie également à notre premier répertoire politique.
Il est intéressant d’observer dans les témoignages de nos interlocuteurs·trices un certain processus d’alignement des émotions de peur et de colère. En effet, ces émotions ne sont pas similaires, mais elles se rejoignent (Kaufmann, 2020). Grâce au discours de nos participant·e·s, nous avons donc dégagé quatre configurations morales ( le rapport bénéfice-risque ; la peur pour les personnes âgées ; la croyance en la force de la jeunesse contre le Covid et la colère contre la politique vaccinale) dans « l’économie morale » de la vaccination, se rapportant à la circulation de normes, de valeurs et d’émotions dans l’espace public (Fassin, 2009 : 1257).
« J’avais souvent des retours négatifs des gens (…). Enfin, avec des effets secondaires qu’ils avaient eus. Du coup ça m’a influencée un peu négativement » (Anna)
Le rapport à la connaissance est aussi une dimension essentielle à prendre en compte pour comprendre le positionnement de nos participant·e·s. En effet, les individus se construisent une forme d’expertise qui influence les choix médicaux qu’ils et elles font. Dans le cas de la vaccination contre le Covid, cette dimension se retrouve dans la manière dont les individus ont appréhendé le procédé vaccinal. Le témoignage d’Anna incarne cette expertise. Selon elle, le vécu des patient·e·s a influencé sa décision de ne pas se faire vacciner : « il y avait un peu les gens qui avaient vraiment les effets secondaires et qui sont venus avec les mains gonflées (…) des trucs rougeurs sur tout le corps, des fièvres pas possibles, des trucs tu vois assez importants. Il y en a un aussi, il est venu parce qu’il était paralysé. Il avait une paralysie suite au vaccin. Les médecins (…) ont dit qu’il n’y avait pas d’autres explications que le vaccin ». La méfiance vaccinale se base donc sur des questionnements relatifs au produit du vaccin et au risque qu’il peut comporter. Pour reprendre Françoise Salvadori et Laurent-Henri Vignaud (2019 : 63) le vaccin serait dangereux et engendrerait des maladies. Notons que sur une base empirique, un raisonnement par induction est effectué par la participante. A la connaissance profane s’associent les différentes formes d’information récoltées par nos interlocuteurs·trices. Ils et elles se sont informé·e·s par différents canaux : alors qu’Anna s’est basée sur le vécu des vacciné·e·s présent·e·s à la pharmacie dans laquelle elle travaille, Louise privilégiait des sources en ligne de différents organismes. Cette notion d’information souligne que les interlocuteurs·trices, pour se faire une opinion, relaient et « font parler » des sources et des vécus (Cooren, 2010). Par ces moyens, les deux interlocutrices relèvent avoir relevé des incohérences entre le produit même et la réalité pratique : « j’ai découvert plein de choses qui allaient dans tous les sens (…) je voyais qu’il y avait de nouveaux articles tous les jours, dans tous les sens. Et en fait, pour moi quand il y a ça, ce que ça me renvoie comme image c’est qu’en fait ils (les autorités) ne savent pas plus que moi » (Louise). Sur le bien-fondé de la vaccination, les incohérences de la politique vaccinale sont soulevées par nos participant·e·s qui dénoncent les arguments mobilisés par l’État pour que la population se vaccine. Ces arguments étant avant tout sociaux et non relatifs à la santé : « pour moi tu ne te fais pas vacciner contre une maladie pour pouvoir aller au musée, pour prendre un train comme en France, ni pour aller en boîte, enfin bref, tu te vaccines pour te protéger contre une maladie, euh pour moi cette maladie n’était pas dangereuse, alors je ne me fais pas vacciner » (Vladimir, 24, travailleur dans l’audit). Ainsi, selon ces dires, la vaccination ne sert pas à protéger les gens contre un virus, mais elle vise à retrouver des droits perdus en temps de pandémie. Le produit vaccinal ne serait donc pas un gage de sûreté, car il est imposé pour des raisons sociales et non de santé. Nos interlocuteurs·trices ont mobilisé leurs savoirs afin de se faire un avis sur le vaccin, non pas comme un procédé social, mais en tant que produit thérapeutique. Leurs différentes explications mettent peu l’accent sur la dimension collective du procédé vaccinal, elles se basent sur le vécu et ressenti individuels.
Nous avons donc observé, dans ce chapitre, qu’au sein du discours de nos différent·e·s participant·e·s, les répertoires de la littérature, transcendant les époques, se retrouvent. En effet, la dimension politique du vaccin est clairement mise en avant par les interlocuteurs·trices : ils et elles ont relevé la grande place qu’a pris l’État dans la gestion de la politique de vaccination. La dimension morale et émotionnelle a également été saillante dans les dires des participant·e·s : au sein de « l’économie morale » de la vaccination, plusieurs configurations morales ont surgi et ont permis de comprendre les différentes attitudes morales de nos interlocuteurs·trices opposé·e·s à la pratique vaccinale. En outre, l’argumentaire d’ordre épistémique était largement présent dans l’expertise que se sont construit les participant·e·s. Ils et elles se sont informé·e·s par différents canaux afin de se construire un avis sur le procédé vaccinal. De plus, une méfiance certaine était présente à l’encontre du produit même, une méfiance qui se rapporte à l’éventuelle dangerosité du vaccin et aux potentiels effets secondaires qu’il pouvait provoquer.

Notre première hypothèse soulignant l’existence d’argumentaires « transhistoriques » selon Eribon (2004) est donc validée. Certains types d’arguments se répètent donc dans le temps malgré les contextes changeants et deviennent des prises justificatives pour les individus du bien-fondé de leurs actions.
Notre second article porte sur la manière dont les ruptures biographiques peuvent possiblement influencer la décision vaccinale. Il met en évidence que la focalisation sur les vécus est essentielle à prendre en compte pour observer comment les choix vaccinaux s’inscrivent dans un contexte social et politique, mais également dans un contexte biographique.
[1] Typiquement, dans son texte, Cooren (2010) donne l’exemple d’un chef-technicien qui, dans son interaction avec une coordinatrice médicale, parle au nom de sa fonction.
[2] Austin (1991) encapsule par le terme de « performativité du langage » la dimension intrinsèque au fait d’énoncer. En somme « dire, c’est faire » : un discours est aussi une action en soi. Dans le cas présent, nos participant·e·s « actent » leur liberté d’expression, par le fait de s’exprimer.
[3] La notion d’« économie morale » selon Fassin (2009 : 1257) renvoie à « la production, la répartition et la circulation des sentiments moraux, des émotions et des valeurs, des normes et des obligations dans l’espace social ».
[4] Réflexion reprise de Cooren (2010) sur le fait de “ventriloquer” des voix et des principes.
Bibliographie
Littérature scientifique
Austin, J. (1991). Quand dire c’est faire. Paris : Seuil.
du Breil de Pontbriand, B. D. B., & Brugaillère, M. C. (2019). L’apprentissage et la construction de soi dans une situation de rupture biographique. Savoirs, (1), 69-82.
Cavalli, S. (2007). Modèle de parcours de vie et individualisation. Gérontologie et société, 30(4), 55-69.
Cooren, F. (2010). Ventriloquie, performativité et communication. Réseaux, (5), 33-54.
Eribon, D. (2004). Sur cet instant fragile … Carnets, janvier-août 2004. Paris : Fayard.
Fassin, D. (2009). Les économies morales revisitées. Annales, Histoire et Sciences Sociales, n°6, pp. 1237-1266.
Galchen, R. (2022). A quand un vaccin contre les rumeurs ? (Traduction de Charlotte Navion). Books. L’actualité à la lumière des livres, n°119, pp. 66-69.
Gaudet, S., & Drapeau, É. (2021). L’utilisation combinée du récit et du calendrier de vie dans un dispositif d’enquête narrative biographique. Recherches qualitatives, 40(2), 57-80.
Guimier, L. (2021). Les résistances françaises aux vaccinations : continuité et ruptures à la lumière de la pandémie de Covid-19. La Découverte, n°183, pp. 227-250.
Kaufmann, L. (2020). Ces émotions auxquelles nous sommes attachés. Vers une phénoménologie politique de l’espace public. In Kaufmann, L & L. Quéré (éds). Les émotions collectives. En quête d’un « objet impossible », Editions de l’EHESS, pp. 207-250.
Kohli, M., & Meyer, J. W. (1986). Social structure and social construction of life stages. Human development, 29(3), 145-149.
Kohli, M. (1986). The world we forgot: A historical review of the life course. In V.W. Marshall (Ed.), Later life. The social psychology of aging (pp. 271-303). Beverly Hills : Sage.
Mabileau, A. (1960). La personnalisation du Pouvoir dans les gouvernements démocratiques. Revue française de science politique, 10(1), 39-65.
Maulin, É. (2012). L’État comme personne et comme représentation ou les jeux de miroir de la légalité et de la légitimité. Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, (31), 171-184.
Moser, M. (2020). La Vaccination : Fondements biologiques et enjeux sociétaux. Bruxelles : Editions de l’Université de Bruxelles.
Ollivier-Yaniv, C. (2017). La vaccination, ça se discute ? » Le rapport sur la politique vaccinale, espace polyphonique inédit. Mots. Les langages du politique, n°144, pp. 117-133.
Polo, C, Plantin, C, Lund, K, Niccolai, G. (2013). Quand construire une position émotionnelle, c’est choisir une conclusion argumentative : le cas d’un café-débat sur l’eau potable au Mexique. Semen. Revue de sémio-linguistique des textes et discours, n°35. pp. 41-63.
Roitman J [trad. Bouyssou R. ] (2000). Economie morale, subjectivité et politique. Critique internationale, vol. 6. pp. 48-56.
Salvadori, F, Vignaud L-H. (2019). Antivax : la résistance aux vaccins du XVIIIe siècle à nos jours. Paris : Vendémiaire.
Zielinska, A. (2021). L’hésitation vaccinale en France dans le contexte de la Covid-19. Une perspective comparatiste. Érès, n°11, pp. 141-155.
Zylberman, P. (2020). La Guerre des Vaccins. Paris : Odile Jacob.
Sites internet
Monier et al. (2021), Dictionnaire en ligne de l’Académie Française : Dictionnaire de l’Académie Française 8e édition, Consulté le 24 mai 2022, URL : https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A8M0713
The Morgan Library Museum, The cow – pock, -or -The wonderful effects of the new inoculation! Consulté le 24 mai 2022. URL : https://www.themorgan.org/blog/cow-pock-or-wonderful-effects-new- inoculation