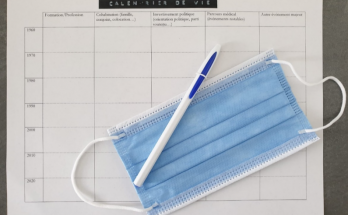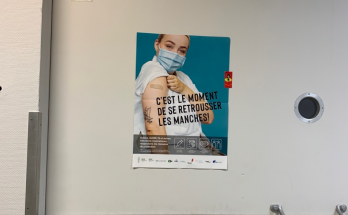Expériences de la pandémie
Lors du cours-séminaire « Sciences sociales de la médecine et de la santé » qui s’est déroulé en 2022/23 à l’UNIL sous la houlette de Laetitia Della Bianca, Céline Mavrot et Francesco Panese, une classe de master de l’UNIL en sociologie de la médecine et de la santé a mené des enquêtes au plus près du quotidien d’une variété de métiers, de communautés, de milieux autour de la thématique cruciale des vaccins. Les paroles recueillies et/ou les problématiques abordées composent la trame d’expériences partagées et/ou de vécus intimes en lien avec cette problématique.
Une enquête de Séverine Bochatay et Jean-Pierre Pavillon
Dans une première partie, nous avons tenté d’explorer les raisons générales conduisant des infirmièr·e·s à refuser le vaccin contre la COVID-19. Nous avons tiré un parallèle entre ces raisons et celles de la population générale, en soulignant que les personnes interrogées se référaient souvent au savoir que leur apportait leur profession pour justifier un refus vaccinal.
Dans cette seconde partie, nous cherchons à comprendre quelles tensions le refus vaccinal des infirmières interrogées a pu provoquer avec la hiérarchie. En effet, dans un entretien livré au journal Le Temps en mai 2021, Inka Moritz (directrice générale de la Haute École de santé Vaud) déclarait « Une infirmière qui ne se vaccine pas, c’est une pilote qui refuse de monter dans l’avion. » (Skjellaug, 2021) Notre hypothèse était donc que la hiérarchie avait poussé pour la vaccination, en insistant particulièrement sur les questions morales relatives à la protection des patient·e·s pour motiver celle-ci.
« Ce que j’ai apprécié en Suisse, c’est cette liberté de choix. » – Océane
Comment réussir à convaincre si le problème est la rapidité du développement du vaccin ? Pour Mx. J. l’important était de favoriser la discussion. Il-elle invitait régulièrement les personnes hésitantes à consulter leur médecin traitant, pour avoir une discussion plus sereine, permettant de répondre aux questions de chacun·e. Pourtant, il est assez probable que cela n’ait pas convaincu en masse. Dans le cas d’Emma, une rencontre avec un·e infectiologue avait été proposée pour qu’il-elle réponde à d’éventuelles questions, ce qui ne l’a pas intéressée. Ses autres collègues non vacciné·e·s avaient également eu cette possibilité, mais elle ne croit pas que cela les ait convaincu·e·s. Mx. J. était d’ailleurs conscient·e que l’opposition de certain·e·s au vaccin COVID était « viscérale » comme il-elle le formulait, et qu’il n’y aurait pas de moyen de les convaincre. En revanche, dans sa gestion du personnel hospitalier au centre de vaccination, il-elle nous explique : « Je ne pouvais pas accepter que des gens ici vaccinent, alors qu’ils n’étaient pas vaccinés. » Le personnel réticent était donc orienté vers un autre service.
Les infirmières que nous avons interrogées n’ont quant à elles jamais eu à se réorienter dans un autre service. Elles nous ont toutes expliqué que différents aménagements avaient été mis en place par les responsables pour leurs permettre de continuer leur travail. Des tests poolés étaient organisés par les différentes institutions, également dans les écoles, comme nous a l’expliqué Mx. D. Toutes nos intervenantes ont apprécié ces solutions mises à leur disposition. Océane se rappelle :
« Donc c’est vrai que ça restait une contrainte, mais une contrainte accessible, pas quelque chose… Enfin, moi j’ai eu cette inquiétude qu’à un moment donné la contrainte soit telle qu’on ne puisse plus dire non. Et ça n’a pas été le cas. »
La crainte de l’obligation vaccinale était bien présente. Surtout qu’en France la vaccination des soignant·e·s était obligatoire, et que celle-ci a également été discuté en Suisse (Kottelat, 2021, Revello, 2021). Les infirmières rencontrées étaient donc toutes plutôt reconnaissantes, et n’ont pas fait état de tensions avec la hiérarchie, ce que leur refus aurait pu provoquer.
« On est un peu jugées malheureusement, alors que dans notre métier le jugement n’a pas sa place. » – Chloé
Bien que dans les service médicaux la hiérarchie semble avoir respecté le choix du refus vaccinal, les deux infirmières encore en formation ont ressenti une forte pression de la part de leur école : le-la directeur·trice avait envoyé une lettre aux personnes non-vaccinées. Pour Jade : « C’était limite presque une menace. Moi je l’ai perçu comme ça. C’était une menace bien forte, une lettre bien adressée pour qu’on se vaccine. » Elle nous raconte que certain·e·s élèves avaient pris rendez-vous avec le-la directeur·rice pour que leur choix soit plus respecté, sans que cela n’aboutisse. Les deux amies ont ressenti un jugement très fort de la part de leur entourage, et leur soutien mutuel, ainsi que celui d’autres personnes non-vaccinées (notamment grâce à un groupe WhatsApp d’élèves de leur école refusant la vaccination contre la COVID) a été primordial pour elles. Le vocabulaire de la résistance est récupéré par ces deux intervenantes. Par exemple, Jade nous dit :
« Déjà là je m’étonne d’avoir résisté. Je me dis que c’est peut-être aussi parce que j’ai vécu avec des gens qui n’étaient pas vaccinés non plus et que ça m’a conforté dans mon choix et que ça m’a soutenue. Si je n’avais pas eu ce soutien, j’aurais peut-être cédé. »
Elles s’accordent à dire que dans leur stage elles ont ressenti beaucoup moins de pression de la part des supérieur·e·s. Les autres infirmières rejoignent ce constat, et comme nous l’explique Chloé, le jugement ne vient pas des supérieur·e·s hiérarchiques, mais plutôt des collègues : « Enfin, il y a quelques mois, il y a eu un jugement sur un patient qui était là, pas vacciné, et qui a eu la COVID. » Ainsi le jugement ne se fait peut-être pas directement sur les soignant·e·s mais des remarques sur les patient·e·s peuvent également être difficiles à supporter. Surtout que les infirmières avec lesquelles nous avons parlé se présentent comme des personnes qui elles-mêmes ne jugent pas.
L’entourage familial peut également être une source de tension. La situation de Chloé est un peu particulière à cet égard :
« Alors moi, j’ai une tante et un cousin qui sont médecins. Ils sont à fond sur ça, mais ils ne savent pas me donner la raison pour laquelle ils sont à fond dans le vaccin. Ils disent qu’il faut faire confiance à la science. »
Par ailleurs, aucune autre infirmière n’a éprouvé de difficulté particulière dans ses rapports aux médecin·es. Selon l’étude d’Unisanté, presque 90% des médecin·e·s étaient complétement vaccinés, et 73.4% des infirmier·ère·s. Lorsque nous demandons aux intervenantes si elles ont des hypothèses pour expliquer cette différence de taux, la plupart ne savent pas. Inès propose une explication : « J’ai l’impression que, dans les lieux de stage et dans les milieux hospitaliers, il y a beaucoup de médecins qui font les choses sans se demander pourquoi ils le font. »
Lors de notre entretien, Mx. D. avait évoqué le fait que la profession infirmière essaie de s’émanciper, de ne plus être des auxiliaires des médecin·e·s qui simplement « obéissent ». Pourtant, mise à part leur affinité avec les médecines alternatives – qu’elles ne thématisent toutefois pas comme un désir d’émancipation – aucune référence à une volonté d’affirmer une identité particulière de la profession infirmière n’a été faite par les personnes interrogées. Chloé revient cependant sur l’importance d’une collaboration entre les deux professions pour une meilleure prise en charge des patient·e·s. Elle ajoute :
« On a cette chance là que c’est vrai que nos médecins […] ont confiance en nous, et ils nous laissent quand même bien travailler en prenant des initiatives, mais avec les médecins assistants c’est plus compliqué. »
Ce ne sont pourtant pas des éléments suffisants pour confirmer notre hypothèse du refus de la vaccination comme l’affirmation d’une identité propre à la profession d’infirmière.
« Le taux de contagion est diminué, mais il est quand même présent. » – Emma
La vaccination du personnel soignant a pu apparaître comme un enjeu majeur pour endiguer la crise du coronavirus, en témoigne le fait qu’une étude dédiée à cette question ait été menée par Unisanté. Pourtant, pour les infirmières interrogées, travailler dans les soins n’est pas une raison suffisante pour accepter la vaccination. Comme le souligne Emma : « Ce n’est pas parce qu’on est dans un métier de la santé que l’on va suivre tout ce qui se fait dans le domaine médical. »
C’est également une critique que fait Océane : « Y a aussi ce côté, l’infirmière n’est pas traitée à la même enseigne que les autres. » Se pose ainsi la question de ce à quoi doivent consentir les soignant·e·s pour exercer leur métier. Les infirmier·ère·s ont déjà assuré un rôle fondamental dans ces périodes de crise, et celui-ci a été reconnu par la population, à la fois au travers des applaudissements de 21h et par le soutien à l’initiative pour les soins infirmiers lors du vote de novembre 2021 (Wicky, 2021). Une vaccination obligatoire, telle qu’elle le fut en France, peut être vue comme une injonction à un sacrifice supplémentaire. Alors que certain·e·s responsables telles que Mx. J. se positionnent clairement en faveur d’une obligation vaccinale contre la COVID pour le personnel soignant, dans l’idée que la « responsabilité c’est de protéger les patients », d’autres se montrent plus modéré·e·s. Mx. D. nous explique :
« Dans la profession infirmière, on doit donner l’exemple, donc nous, on doit être exemplaires. Il y a ce mélange entre qui je suis dans la vie professionnelle, et mes convictions intimes personnelles. On n’est plus des bonnes sœurs, on a une vie. On peut ne pas être d’accord et on n’obéit pas juste uniquement. »
Ainsi, lors de nos entretiens, l’argument que nous avancions en termes de protection des patient·e·s était rapidement balayé par les intervenant·e·s. Comme l’explique Océane : « J’estimais qu’avec les gestes barrières je protégeais déjà cette population. » Une autre manière d’éviter l’accusation d’égoïsme était de rappeler que ses collègues ne l’avaient pas fait particulièrement par un souci de l’autre, mais que bien souvent les raisons de la vaccination étaient pour partir en vacances, ou aller au restaurant.
Dans tous les cas, au vu des entretiens que nous avons menés, il semble peu probable qu’une obligation vaccinale soit un moyen de convaincre les réticent·e·s. Même si certaines ont affirmé lors des entretiens que dans une telle situation elles hésiteraient à changer de métier, cela reste une chose à laquelle elles préfèrent ne pas penser. Si elles devaient se vacciner sous la contrainte, ce serait selon nous une source de tensions dans les équipes et surtout, cela ne les convaincrait pas du bien-fondé scientifique de la vaccination. De plus, nous avons pu remarquer qu’insister sur la vaccination comme un devoir moral n’est pas plus efficace, et au contraire pourrait même être contre-productif. Comme l’explique Rosenfeld et Tomyiama (2022) :
« Intuitivement, le fait de blâmer les personnes qui évitent de se faire vacciner contre le COVID-19 peut sembler une stratégie efficace pour créer des normes morales prescriptives qui incitent à se faire vacciner. Pourtant, les gens se mettent facilement sur la défensive lorsqu’ils sentent que leur image morale est menacée. »
Conclusion
Le but de notre recherche était de comprendre les motifs de refus du vaccin chez le personnel infirmier. L’analyse des entretiens avec les infirmières rejoint les résultats de l’étude d’Unisanté sur le personnel des hôpitaux vaudois : les motivations sont souvent le manque de recul, la trop grande rapidité du développement du vaccin contre la COVID, les inconnues sur la technologie ARN, le sentiment de ne pas courir de risque à titre personnel et celui de ne pas faire courir de risque aux patient·e·s en appliquant les gestes barrières. Les théories complotistes étaient quasiment absentes, comme dans l’étude Unisanté. En revanche, les thèmes de la grossesse et de la crainte de l’infertilité, très présents dans cette étude, n’apparaissaient qu’en filigrane dans nos entretiens.
L’idée qu’une motivation spécifique aux infirmièr·e·s pourrait être l’affirmation d’une identité professionnelle et les rapports hiérarchiques parfois difficiles avec le corps médical a été soutenue par Mx. D. Dans les entretiens avec les infirmières, cette problématique était présente mais n’était pas explicitement invoquée comme ayant influencé leur choix de refuser le vaccin. En conclusion, nous avons pu observer que les arguments mobilisés pour justifier un refus vaccinal chez les infirmières sont proches de ceux de la population, bien que certains éléments propres à leur pratique étaient leur discours. Ceux-ci peuvent être des témoignages rapportés par leur patient·e·s, des observations qu’elles-mêmes ont pu faire de personnes atteint·e·s de la COVID-19, ou des éléments appris pendant leur formation. L’abandon très rapide des mesures de prévention au printemps 2022, justifié par le changement de comportement du virus, a souvent été ressenti comme une preuve de l’incohérence des politiques sanitaires et une confirmation de l’inutilité du vaccin. En revanche, comme les infirmières interrogées n’étaient en principe pas opposées aux vaccins « historiques », si la vaccination contre la COVID-19 devenait à nouveau un enjeu majeur dans le futur, nous pouvons supposer que celles-ci pourraient être convaincues par des arguments scientifiques encourageants.
Bibliographie
Sources primaires
BAUD, David (2022), « Votre courrier du 1er novembre concernant le bulletin d’information « Vaccination contre le COVID-19 pendant la grossesse ». Disponible sur : https://www.reinfosante.ch/femmes-enceintes/ [consulté le 19.05.2022].
BROCARD, Martine (2019), « Entre médecins et infirmiers, une hiérarchie tenace », Hémisphère, n°17. Disponible sur : https://revuehemispheres.ch/entre-medecins-et-infirmiers-une-hierarchie-tenace/ [consulté le 08.06.2022].
Déclaration conjointe de l’OMS, des Nations Unies, de l’UNICEF, du PNUD, de l’UNESCO, de l’ONUSIDA, de l’UIT, de l’initiative Global Pulse et de la FICR, (2020) « Gestion de l’infodémie sur la COVID-19 : Promouvoir des comportements sains et atténuer les effets néfastes de la diffusion d’informations fausses et trompeuses ». Disponible sur : https://www.who.int/fr/news/item/23-09-2020-managing-the-covid-19-infodemic-promoting-healthy-behaviours-and-mitigating-the-harm-from-misinformation-and-disinformation [consulté le 19.05.2022].
« Coronavirus : voici comment nous protéger », OFSP. Disponible sur : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html#1770417724 [consulté le 20.05.2022].
KOTTELAT, Didier (2021) « Au Parlement, la vaccination obligatoire ne séduit pas (encore?) », RTS Info, 9 décembre 2021. Disponible sur : https://www.rts.ch/info/suisse/12701644-au-parlement-la-vaccination-obligatoire-ne-seduit-pas-encore.html [consulté le 28.03.2022].
REVELLO, Sylvia (2021) « En Suisse, la vaccination obligatoire pour les soignants n’est pas à l’ordre du jour », Le Temps, 13 juillet 2021. Disponible sur : https://www.letemps.ch/suisse/suisse-vaccination-obligatoire-soignants-nest-lordre-jour [consulté le 28.03.2022].
ROBERT, Denis (2022), « Les dissidents : immersion dans les sphères conspirationnistes », YouTube. Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=Dj6h0OqUjzY&t=1640s [consulté le 06.06.2022].
SKJELLAUG, Aïna (2021) « Inka Moritz: « Une infirmière qui ne se vaccine pas, c’est une pilote qui refuse de monter dans l’avion » », Le Temps, 7 mai 2021. Disponible sur : https://www.letemps.ch/suisse/inka-moritz-une-infirmiere-ne-se-vaccine-cest-une-pilote-refuse-monter-lavion [consulté le 28.03.2022].
Témoignages des infirmiers, https://www.reinfosante.ch/temoignages/ [consulté le 28.03.2022].
WICKY, Julien (2021), « Le Covid consolide l’initiative sur les soins infirmiers », 24 Heures, 17 novembre 2021. Disponible sur : https://www.24heures.ch/le-covid-consolide-linitiative-sur-les-soins-infirmiers-371888954436 [consulté le 09.06.2023]
Sources secondaires
BOYEAU Cécile, et al. (2011), « Couverture vaccinale antigrippale saisonnière et pandémique (H1N1) 2009 : étude auprès du personnel du chu d’Angers », Santé Publique, vol. 23, n°1, pp. 19-29. Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2011-1-page-19.htm [consulté le 29.03.2022].
CORDONIER, Laurent, DIEGUEZ, Laurent (2021), « Le complotisme, un outil de mobilisation dangereux », Tangram, n°45. Disponible sur : https://www.ekr.admin.ch/f847.html [consulté le 06.06.2022].
EHRENREICH, Barbara, ENGLISH, Deirdre (2018 [1973]), Sorcières, sages-femmes et infirmières : une histoire des femmes et de la médecine, Montréal, Les Éditions du Remue-Ménage.
GUIMIER, Lucie (2021), « Les résistances françaises aux vaccinations : continuité et ruptures à la lumière de la pandémie de Covid-19 », Hérodote, vol.4, n° 183, pp. 227-250. Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-herodote-2021-4-page-227.htm [consulté le 29.03.2022].
GERBER, Michelle, KRAFT, Esther, BOSSHARD, Christophe (2018), « La collaboration interprofessionnelle sous l’angle de la qualité », Bulletin des Médecins Suisses, vol. 99, n°44, pp. 1524-1529. Disponible sur : https://bullmed.ch/article/doi/saez.2018.17276 [consulté le 08.06.2022].
HABERSAAT, Katrine Bach, JACKSON, Cath (2020) « Understanding vaccine acceptance and demand—and ways to increase them ». Bundesgesundheitsbl, n°63, pp. 32–39. Disponible sur : https://doi.org/10.1007/s00103-019-03063-0 [consulté le 06.06.2022].
HASSENTEUFEL, Patrick (2020). « Handling the COVID-19 crisis in France: Paradoxes of a centralized state-led health system ». European Policy Analysis, vol. 6, n°2, pp. 170– 179. Disponible sur : https://doi.org/10.1002/epa2.1104 [consulté le 06.06.2022].
MESH, Gustavo, SCHWIRIAN, Kent (2015), « Social and political determinants of vaccine hesitancy: Lessons learned from the H1N1 pandemic of 2009-2010 », American Journal of Infection Control, vol. 43, n°11, pp.1161-1165. Disponible sur : ajicjournal.org/article/S0196-6553(15)00750-6/fulltext [consulté le 28.03.2022].
PIERCE, Charles S. (1984 [1877]), « Comment se fixe la croyance », in Textes anticartésiens, trad. et prés. J. Chenu, Paris, Aubier, pp. 267-286.
ROSENFELD, Daniel, TOMIYAMA, Janet (2022), « Jab my arm, not my morality: Perceived moral reproach as a barrier to COVID-19 vaccine uptake », Social Science & Medecine, vol. 294. Disponible sur : https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.114699 [consulté le 28.03.2022].
SCHÄFER-KELLER, Petra, SCHAFFERT-WITVLIET, Bianca (2021), « Des faits et des informations sur la vaccination contre le coronavirus. Se faire vacciner contre le Covid ? S’informer et décider », Soins infirmiers, pp. 52-57, disponible sur : https://www.heds-fr.ch/fr/ecole/actualites/des-faits-sur-la-vaccination-contre-le-coronavirus/ [consulté le 08.06.2022].
VIGNAUD, Laurent-Henri (2021), « La vaccination de Pasteur aux antivax », Sciences Humaines, n°340, p. 15. Disponible sur : https://www.cairn.info/magazine-sciences-humaines-2021-10-page-15.htm [consulté le 20.05.2022]. ZIELINSKA, Anna C. (2021), « L’hésitation vaccinale en France dans le contexte de la Covid-19. Une perspective comparatiste », Revue française d’éthique appliquée, vol. 1, n°11, pp. 141-155. Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-francaise-d-ethique-appliquee-2021-1-page-141.htm [consulté le 29.03.2022].