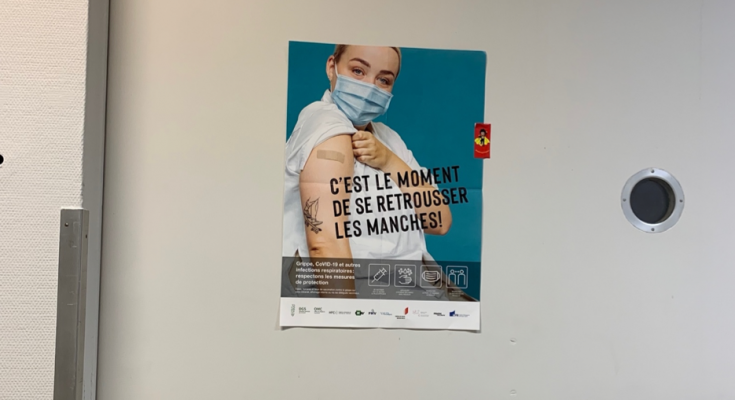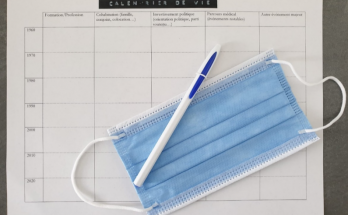Expériences de la pandémie
Lors du cours-séminaire « Sciences sociales de la médecine et de la santé » qui s’est déroulé en 2022/23 à l’UNIL sous la houlette de Laetitia Della Bianca, Céline Mavrot et Francesco Panese, une classe de master de l’UNIL en sociologie de la médecine et de la santé a mené des enquêtes au plus près du quotidien d’une variété de métiers, de communautés, de milieux autour de la thématique cruciale des vaccins. Les paroles recueillies et/ou les problématiques abordées composent la trame d’expériences partagées et/ou de vécus intimes en lien avec cette problématique.
Une enquête de Séverine Bochatay et Jean-Pierre Pavillon
Un virus prévu, mais inattendu
Depuis plusieurs années les spécialistes en maladies infectieuses et les épidémiologistes prédisaient une prochaine pandémie. Ils l’imaginaient comme une mutation majeure du virus de la grippe ou, scénario catastrophe, comme une fièvre hémorragique de type Ebola. Finalement, c’est un coronavirus proche du SARS (syndrome aigu respiratoire sévère responsable d’une épidémie en Asie du sud-est en 2002-2003) ou du MERS (infection à coronavirus éteinte spontanément en 2012 au Moyen-Orient) (Schäfer-Keller, Schaffert-Witvliet, 2021), qui a émergé et a pris de court l’ensemble de la communauté scientifique par son comportement et sa transmissibilité atypiques.
Durant les premiers mois de la pandémie, les gouvernements et les autorités sanitaires ont dû prendre des décisions malgré des connaissances lacunaires, et ont eu des attitudes contradictoires, par exemple sur le port du masque (Hassenteufel, 2020, Zielinska, 2021). La pandémie a induit une ère d’incertitude, de doute et d’insécurité. Dans ce contexte, la mise au point très rapide d’un vaccin, développé grâce à une technologie éprouvée dans d’autres domaines, mais nouvelle dans celui des maladies infectieuses, a suscité une méfiance au-delà du cercle des personnes opposées aux vaccins en général.
Alors que la vaccination du personnel soignant apparaît comme un enjeu central de la lutte contre la COVID-19 (Skjellaug, 2021, Kottelat, 2021), le personnel des institutions médicales a pu se montrer réticent. Ce fut notamment le cas en France où les soignant·e·s sont descendu·e·s dans la rue pour contester l’obligation de vaccination pour le personnel. Dans un article paru en 2020, Katrine Habersaat et Cath Jackson posaient l’hypothèse que le niveau d’éducation influençait l’attitude des individus face à la vaccination (2020 : 34). La question du vaccino-scepticisme chez le personnel soignant devient donc particulièrement intéressante, étant donné que c’est lui qui est le plus formé sur ces questions.

Lors des campagnes de vaccinations précédentes, par exemple contre la grippe A H1N1, il avait été observé que les infirmier·ère·s se vaccinaient beaucoup moins que les médecin·es (Boyeau et al., 2011), des clivages qui semblent également apparaître dans le cas de la COVID-19 (Guimier, 2021). Ainsi, et ce malgré leur haut niveau de formation, des infirmier·ère·s se retrouvent à l’écart de la pensée majoritaire du corps médical. Dans Sorcières, Sages-Femmes et Infirmières, publié pour la première fois en 1973 aux États-Unis, et réédité plusieurs fois depuis, les militantes féministes Barbara Ehrenreich et Deidre English, explorent la manière dont les femmes ont été exclues du champ médical. De manière un peu provoquante, elles dressaient ce constat :
« L’ensemble des infirmières ne constitue que du personnel « auxiliaire » par rapport au médecin. Depuis l’aide-infirmière, dont les tâches serviles sont dictées avec une précision « industrielle », jusqu’à l’infirmière qui transmet les ordres du médecin, tout ce personnel féminin en uniforme constitue une armée de servantes aux ordres des professionnels mâles. » (2018 : 16)
Ces observations sur le rôle des infirmier·ère·s peuvent nous questionner sur la place actuelle de cette profession dans les systèmes de santé. D’une certaine manière celle-ci conserve son actualité : ces dernières années, de nombreux articles ont été publiés pour appeler à une plus grande collaboration entre médecin·e·s et infirmier·ère·s (Gerber et al., 2018), bien que dans les faits la hiérarchie reste pesante (Brocard, 2019).
Le but de ce travail sera donc d’étudier les raisons invoquées par des infirmier·ère·s suisses romands méfiant·e·s par rapport au vaccin contre la COVID-19, et comment cette méfiance a été gérée par les responsables de différentes institutions de santé. En se fondant sur la littérature précédemment citée et sur l’expérience professionnelle de l’un d’entre nous, nous formulons l’hypothèse que l’affirmation d’une identité différente de celle des médecins et d’une vision de la santé plus centrée sur le patient que sur la maladie pourraient expliquer un tel refus.
Notre étude a été menée par une étudiante en master en humanités numériques et un auditeur, médecin retraité. Elle se fonde sur des entretiens semi-directifs abordant les questions de refus vaccinal avec des infirmières qui ont refusé le vaccin contre la COVID-19, que nous avons contacté en demandant à des connaissances infirmières si certaines de leurs collègues avaient refusé cette vaccination et accepteraient de nous en parler. Nous avons également interrogé des personnes qui forment ou encadrent la profession infirmière (désignés ci-dessous comme « responsables »), pour savoir si le refus vaccinal avait été un problème. Préalablement, nous avons utilisé les résultats d’une enquête menée par Unisanté (Centre de médecine communautaire du canton de Vaud) sur la vaccination chez le personnel des hôpitaux vaudois (étude non publiée, 2021).
Profils
Infirmières
Chloé est infirmière dans un hôpital valaisan en soins continus depuis son arrivée en Suisse, il y a quelques années. Elle a effectué sa formation en France, et y habite toujours. Elle est âgée de 27 ans. Elle aime beaucoup son métier, qu’elle considère comme une vocation.
Emma est infirmière depuis 2015 après une courte période dans un hôpital, elle se tourne vers les soins à domicile et commence à travailler dans un CMS. En 2021, elle rejoint le CMS d’une ville valaisanne. Elle a également effectué sa formation en Valais. Ne sachant pas très bien quel métier elle voulait faire, elle a d’abord effectué une formation d’employée de commerce.
Océane, 43 ans, a emménagé en Suisse peu avant le confinement pour rejoindre son compagnon de l’époque. Ils se sont séparés durant la crise du COVID et elle pense retourner en France plus tard, cependant elle refusera d’y travailler en tant qu’infirmière. Elle travaille dans une unité d’intervention mobile en psychiatrie dans un hôpital intercantonal.
Inès est originaire du Valais et est âgée de 21 ans. Elle étudie les soins infirmiers dans une école vaudoise et terminera son bachelor cette année. Durant son cursus, elle a effectué sept stages dans des milieux médicaux divers, dont certains pendant les vagues de COVID.
Jade est une camarade de classe et amie d’Inès. Toutes deux ont décidé de participer à l’entretien ensemble à la fois pour des raisons organisationnelles, mais surtout pour se soutenir, comme elles le font toujours quand il est question de refus vaccinal. Jade a 24 ans et est originaire du Valais.
Responsables
Mx. J. est actuellement directeur·rice des soins communautaires dans un important hôpital régional romand. Il-elle est infirmier·ère-anesthésiste de formation. Durant l’épidémie de COVID-19, il-elle a été responsable du centre de tests et de vaccination de cet hôpital.
Mx. D. est un·e cadre supérieur·e d’une école d’infirmèr·e·s romande. Il-elle a travaillé dans plusieurs institutions de santé de Suisse romande et n’est à son poste actuel que depuis quelques temps. A son arrivée, les mesures anti-COVID étaient déjà en place.
« Leur métier ne les a pas protégées. » – Mx. J.
En juillet 2020, Unisanté a conduit une enquête quantitative auprès du personnel d’institutions hospitalières du canton de Vaud. Malgré le fait que ces résultats n’aient pas (encore) fait l’objet d’une publication, nous y avons eu accès grâce à l’un·e des chercheur·euse·s ayant travaillé sur cette étude. Parmi les participant·e·s, 73,4% d’entre-eux et elles étaient entièrement vacciné·e·s contre la COVID-19, ce qui correspondait à ce moment à deux doses de vaccin, ou une dose et une infection. Les personnes non-vaccinées avaient la possibilité d’indiquer librement les raisons de leur refus. L’analyse textuelle des 328 réponses à cette question ouverte révèle sept classes thématiques :
- Le manque de savoir par rapport aux effets à long terme
- Le développement trop rapide du vaccin
- La peur d’affaiblir le système immunitaire
- Une infection passée à la COVID
- Pas de risque perçu de développer une forme grave de la maladie
- L’efficacité de l’application de gestes barrière
Si ces différentes catégories sont souvent liées les unes aux autres, une dernière est sémantiquement à part. Il s’agit des risques perçus pour une grossesse (en cours ou envisagée).
La population interrogée étant restreinte, il n’est malheureusement pas possible d’extraire uniquement les réponses des infirmier·ère·s de cette enquête d’Unisanté, mais comme nous le verrons dans la suite de ce travail, ces thématiques sont souvent mobilisées par nos répondant·e·s. Dans l’ensemble, il est intéressant de constater que les motivations évoquées ici pour refuser la vaccination contre la COVID-19 des professionnel·le·s de santé diffèrent globalement peu de celles de la population générale selon le/la chercheur·se avec qui nous avons été en contact. Cette personne souligne pourtant que les références au complotisme sont bien moins fréquentes dans les réponses du personnel hospitalier que dans la population générale. Pour Sébastien Dieguez et Laurent Cordonier (2021), les théories du complot « expliquent les malheurs du monde […] par des récits mettant en scène des acteurs aux intentions malveillantes. » Certes, les infirmières que nous avons interrogées ne font pas référence à de tels acteurs, pourtant nous pouvons quand même nuancer ce résultat, car nous avons pu remarquer que certaines de nos intervenantes adoptaient un argumentaire proche de celui observable dans les sphères complotistes telles que l’a décrit Anthony Mansuy dans un entretien pour le média Blast (Robert, 2022). C’est notamment le cas d’Océane qui nous a mentionné avoir réussi à faire soigner un membre de sa famille par le docteur Raoult.
Cette continuité entre les raisons de la non-vaccination dans la population générale et chez les soignant·e·s a également été observée par Mx. J. Lors des procédures de dépistage de la COVID, il-elle essayait d’effectuer le test lui-elle-même si il-elle savait que la personne était un·e professionnel·le de la santé. Il-elle essayait ainsi d’instaurer un dialogue avec la personne non-vaccinée. Dans ce cadre-là, il-elle a constaté que les motifs d’un refus qui revenaient fréquemment étaient la rapidité du développement du vaccin, la peur de s’injecter un tel produit, ou l’impression de ne pas être un danger (grâce aux gestes barrière). La référence à la liberté de choix était également récurrente. Il-elle affirme que les soignant·e·s n’avaient en réalité « pas plus d’arguments contre le vaccin que le reste de la population ». Il-elle considérait ainsi ces discours comme en partie irrationnels Pour lui-elle, les infirmier·ère·s ne font pas figure d’exception face aux questionnements auxquels nous avons sûrement tous été confronté lors de cette crise, et cela malgré leur haut niveau de formation en santé : « Elles étaient désécurisées comme les autres. Le métier ne les a pas protégées. »
L’expérience des infirmières
Plusieurs auteur·e·s ont parlé d’« infodémie » en ces temps de crise. En 2020, plusieurs organisations internationales (dont l’OMS) ont conjointement publié une déclaration intitulée « Gestion de l’infodémie sur la COVID-19 » (OMS et al. 2020). Dans celle-ci, l’infodémie est définie comme :
« Une surabondance d’informations, tant en ligne que hors ligne [qui] se caractérise par des tentatives délibérées de diffuser des informations erronées afin de saper la riposte de santé publique et de promouvoir les objectifs différents de certains groupes ou individus. »
Dans Textes anticartésiens (1877), Charles S.Pierce consacre un chapitre à la manière dont se fixe la croyance, c’est-à-dire à comment nous choisissons de croire une théorie plutôt qu’une autre lorsque nous avons un doute. Il insiste particulièrement dans ce texte sur le rôle du doute, qui agit comme un moteur pour déclencher un raisonnement aboutissant à une croyance. Pour lui, ce raisonnement sera bon s’il parvient à « une conclusion vraie tirée de prémisses vraies » (p.270). Lors d’une pandémie, durant laquelle les expert·e·s et les autorités eux-mêmes parfois se contredisent, savoir quelles sont les prémisses vraies devient particulièrement complexe, surtout s’il l’on considère l’infodémie qui double ces discours. Trouver des informations est une difficulté dont nous a fait part Océane :
« Parce qu’en fait quand c’est comme ça, vous êtes tellement noyé d’informations qui viennent de toutes parts : des gens pour, des gens contre. Je me suis dit, que peut être dans la revue scientifique, au moins j’aurai des éléments un petit peu plus fiables. »
L’enjeu, dans une telle situation, se situe plutôt dans la relation de confiance envers les institutions. Dans une analyse pour AOC media, Pierre-Michel Menger (2021) soulignait justement que la confiance était un enjeu majeur de cette crise. A un moment où les vaccins commençaient tout juste d’être administrés à la population (janvier 2021), il remarquait déjà des méfiances ; pourtant, il prédisait : « si le ou les vaccins font effectivement leur œuvre, une situation nouvelle s’ouvrira. Les incrédules et les défiants pourront bien douter, la caravane de la recherche avancera, et celle du processus de vaccination aussi ». Si, dans ce laps de temps, beaucoup de personnes méfiantes ont décidé de se faire vacciner, les infirmières que nous avons interrogées étaient sûres de leur choix de ne pas le faire.
En quoi nos intervenantes ont-elles confiance, et de quoi se méfient-t-elle concrètement ?
« Là, à 27 ans, j’ai confiance en mon corps » – Chloé
Selon le site de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), les personnes considérées comme vulnérables face à la COVID-19 sont les femmes enceintes, les adultes atteints de la trisomie 21, les adultes atteints de certaines maladies chroniques, et les personnes âgées. Il est expliqué que « le taux d’hospitalisation augmente à partir de 50 ans. » Ainsi, nos intervenantes ne font a priori partie d’aucune de ces catégories, et elles-mêmes ne se considèrent pas comme étant à risque. Souvent, elles font référence à leur jeunesse, ou à leur immunité naturelle. Par exemple, Emma nous dit : « Je suis quelqu’un qui est en bonne santé, je peux favoriser mon immunité naturelle sans avoir besoin de faire le vaccin. » Elles comprennent d’ailleurs que des personnes à risque fassent le vaccin. Inès nous explique que toute une partie de sa famille est vaccinée et elle précise : « Ce que je pouvais comprendre et ce que je respectais parce que c’étaient des personnes à risques. »
Cette confiance en leur immunité naturelle est aussi à mettre en lien chez certaines de nos intervenantes avec la volonté assumée de contracter la maladie plutôt que de se vacciner. En fait, la gravité de la maladie et l’efficacité du vaccin sont toutes deux sous-considérées, parfois du fait même de leur expérience du contact avec des personnes malades. C’est le cas de Chloé qui, dans son travail aux soins intensifs a dû soigner des personnes jusqu’à triplement vaccinés, et même si elle avoue que celles-ci avaient des comorbidités, il s’est agi d’une expérience suffisante pour qu’elle remette en cause la nécessité de se vacciner.
Cela ressort également dans une question que nous pose Océane : « est-ce qu’on est sûr que le vaccin évite les cas graves ? » Dans une lettre de réponse au collectif Réinfosanté qui s’inquiétait de la vaccination des femmes enceintes, publiée sur leur site, le chef d’obstétrique du CHUV David Baud écrit : « Cependant, aux hypothétiques effets inattendus du vaccin encore méconnus, vous n’opposez pas le risque du virus lui-même. » Nos intervenantes semblent effectivement ne pas considérer les risques de la maladie elle-même.
Océane s’oppose clairement au vaccin, alors que les autres se considèrent plutôt comme neutres. Elle ne considère pas avoir milité contre celui-ci, mais elle nous explique qu’ils en ont régulièrement parlé en famille. Peu après la première dose du vaccin anti-COVID, son père, atteint d’un cancer, voit son taux de globules augmenter. Pour elle, la cause est forcément du côté du vaccin :
« Mais voilà, moi sur le coup, j’ai vu qu’il avait fait ce vaccin, j’ai tout de suite eu peur, et j’ai eu cette réaction, « papa s’il te plaît retourne pas faire la 2e dose ». On n’était pas d’accord, mais ce sont des gens adultes et responsables. »
Océane est aussi l’aînée des intervenantes. Bien qu’elle n’ait pas l’âge d’être considérée comme vulnérable, elle est néanmoins sujette à quelques soucis vasculaires. Ce qui pourrait être une motivation pour faire le vaccin, devient au contraire chez elle une raison de plus de s’en méfier : elle pense que les vaccins peuvent avoir des effets indésirables sur le système cardio-vasculaire. En se référant à une étude qu’elle a lue, elle nous explique que les anticorps contre la protéine spike développés lors de la vaccination provoqueraient des insuffisances cardiaques à partir de la huitième dose. Bien qu’il ne soit pas question d’un tel nombre de doses, cela remet également en cause le bien-fondé de cette vaccination à ses yeux.
Un élément ressort de sa position qui semble récurrent dans la rhétorique des personnes qui s’opposent au vaccin, la référence à « une » étude ou à « un » médecin. Comme Océane l’a également fait un peu plus tôt dans l’entretien :
« J’ai lu des études sur un Monsieur qui fabrique le vaccin de la grippe depuis 40 ans. J’imagine qu’un Monsieur qui est directeur de je ne sais quoi qui fabrique un vaccin depuis 40 ans sait quand même de quoi il parle. »
Concrètement, elle ne nous a pas expliqué quelles étaient les conclusions de cette étude, mais nous pouvons imaginer que celle-ci s’opposait à la vaccination. Océane est peut-être également l’infirmière avec qui nous avons parlé qui essayera le plus d’appuyer son discours avec des éléments qu’elle considère comme scientifiques, par exemple en utilisant un vocabulaire médical et des acronymes (tels que AMM pour autorisation de mise sur le marché). Elle fera également référence à différentes études, donnant ainsi à son discours une certaine forme de légitimité.
Les autres intervenantes feront plus facilement référence à leur expérience personnelle comme raison pour se méfier de la vaccination. Comme nous en avait parlé Mx. J., des liens de causalité sont souvent supposées entre le vaccin contre la COVID et un autre événement médical. Par exemple, Chloé nous explique que les médecins ont découvert une sclérose en plaques chez une de ses amies et qu’une autre a perdu son bébé à trois mois, toujours peu de temps après s’être vaccinées. Elle précise : « Mais bien sûr bon, ils ne mettent pas en lien, mais … » Inès, qui a travaillé dans un centre de vaccination, nous raconte qu’elle recevait « beaucoup de témoignages de certaines femmes » dont le cycle menstruel était déréglé, ou qui avaient fait des fausses couches. Nous retrouvons ici la thématique de la peur des effets du vaccin sur le cycle reproducteur.
De même, leur formation d’infirmière peut également les amener à questionner la légitimité de cette vaccination. C’est ce qu’explique Chloé : « Alors en fait moi j’ai eu des cours, comme beaucoup de mes collègues. C’est pour ça que j’ai été étonnée qu’ils ne se posent pas plus de questions. » C’est un point que nous avons pu aborder avec Mx. D., qui nous a expliqué que, dans son école, les approches complémentaires étaient promues. Ainsi une distance est prise par rapport au biomédical pour favoriser une approche holistique : il semblerait que cette formation invite à parfois questionner certains remèdes, plutôt que d’aveuglement appliquer des protocoles. Cet aspect a selon il-elle pu jouer un rôle pour une approche différenciée des infirmièr·e·s face à la vaccination. D’ailleurs, dans plusieurs entretiens, un penchant pour les médecines alternatives était affirmé, et mis en lien avec le sentiment qu’il existait d’autres moyens que la vaccination pour se protéger.
« On n’avait pas assez ce recul qui était nécessaire après un vaccin. » – Jade
Les conclusions auxquelles amènent l’expérience et les savoirs des différentes infirmières interrogées sont que le vaccin a été développé trop vite. La rapidité de mise sur le marché des différents vaccins est peut-être l’argument le plus souvent mobilisé par celles et ceux qui refusent le produit. Laurent-Henri Vignaud (2021) souligne que les vaccins actuels, dont ceux contre la COVID sont « de véritables produits high-tech qui exigent une chaîne de fabrication complexe et des investissements financiers considérables dont peu de laboratoires dans le monde sont capables », ce qui peut susciter de la méfiance. C’est notamment ce qu’exprime Chloé : « Même avec tout l’argent du monde […] j’ai trouvé qu’il y avait beaucoup de vaccins mis en service, donc j’ai trouvé ça incohérent. » Océane est encore plus tranchante dans sa position. Elle nous explique :
« Ce n’est pas un vaccin. Enfin, je ne sais pas, un vaccin dans mon esprit c’est un virus inactivé qui stimule les défenses immunitaires. C’est comme ça qu’on nous l’avait appris. Après, on peut pousser les choses. Mais pour moi, ce qui a été injecté aux personnes, là, ce n’est pas un vaccin, c’est quelque chose de plutôt expérimental qui n’a pas passé les AMM et qui ne met pas du tout en confiance. »
C’est cette méfiance non pas envers un vaccin, mais envers une nouvelle technologie développée rapidement qui permet de se mettre à distance d’une position fondamentalement anti-vaccinale. Ainsi, les vaccins « historiques » sont acceptés. Inès nous explique quand même qu’elle n’aurait pas forcément fait le vaccin contre l’hépatite-B si elle ne travaillait pas dans la santé, mais elle a accepté car :
« Sur ces vaccins on avait pas mal de recul, et puis ils étaient quand même bien efficaces. Ça n’empêche bien sûr pas d’attraper, mais ça limite beaucoup les risques. Enfin, il y a eu beaucoup moins de cas depuis qu’il y a eu ces vaccins. Donc je me suis dit oui, pour protéger. Et personnellement, pour avoir été quand même en contact avec des patients où j’ai quand même eu le risque d’attraper l’hépatite par exemple, j’ai quand même été très satisfaite d’avoir été vaccinée et au final ça ne m’a pas posé problème justement parce qu’on avait du recul sur ce vaccin. »
Nous retrouvons ici certains arguments mobilisés dans les discours pro-vaccination, mais la rapidité de fabrication permet toutefois ici de discréditer le vaccin contre la COVID-19.
Répertoires argumentaires du refus de la vaccination
Dans leur recherche, accessible dès le 31 août 2023 sur ce blog, Carla Cela et Valentine Perrot, ont proposé d’analyser les arguments contre la vaccination selon trois répertoires : épistémique, politique et moral. En reprenant ces catégories, nous pouvons soutenir que les différentes raisons dont nous avons traitées dans cette partie sont avant tout épistémiques, c’est-à-dire qu’elles se fondent sur des éléments propres aux connaissances que nos intervenantes reconnaissent comme scientifiquement légitimes (ce qui ne veut pas dire que ce soit effectivement le cas). Ces raisons sont aussi souvent à mettre en rapport avec l’expérience propre des infirmières interrogées.
Les répertoires moraux et politiques ne sont pourtant pas absents du discours de nos intervenantes. En effet, dans une seconde partie, nous traiterons de l’impact du refus de la vaccination contre la COVID-19 sur les relations entre les responsables et les infirmières, ainsi qu’entre les infirmières et leurs collègues et proches. Dans ce contexte, les personnes avec qui nous avons mené nos entretiens reviennent sur la sensation d’avoir été jugé négativement pour leur choix de refuser la vaccination. Ce sont ces enjeux moraux et leur rapport au politique que nous vous proposons de lire dans la deuxième partie de cette publication.
Partie 2 : Tensions et dimensions morales
Dans une première partie, nous avons tenté d’explorer les raisons générales conduisant des infirmièr·e·s à refuser le vaccin contre la COVID-19. Nous avons tiré un parallèle entre ces raisons et celles de la population générale, en soulignant que les personnes interrogées se référaient souvent au savoir que leur apportait leur profession pour justifier un refus vaccinal.
Dans cette seconde partie, nous cherchons à comprendre quelles tensions le refus vaccinal des infirmières interrogées a pu provoquer avec la hiérarchie. En effet, dans un entretien livré au journal Le Temps en mai 2021, Inka Moritz (directrice générale de la Haute École de santé Vaud) déclarait « Une infirmière qui ne se vaccine pas, c’est une pilote qui refuse de monter dans l’avion. » (Skjellaug, 2021) Notre hypothèse était donc que la hiérarchie avait poussé pour la vaccination, en insistant particulièrement sur les questions morales relatives à la protection des patient·e·s pour motiver celle-ci.
« Ce que j’ai apprécié en Suisse, c’est cette liberté de choix. » – Océane
Comment réussir à convaincre si le problème est la rapidité du développement du vaccin ? Pour Mx. J. l’important était de favoriser la discussion. Il-elle invitait régulièrement les personnes hésitantes à consulter leur médecin traitant, pour avoir une discussion plus sereine, permettant de répondre aux questions de chacun·e. Pourtant, il est assez probable que cela n’ait pas convaincu en masse. Dans le cas d’Emma, une rencontre avec un·e infectiologue avait été proposée pour qu’il-elle réponde à d’éventuelles questions, ce qui ne l’a pas intéressée. Ses autres collègues non vacciné·e·s avaient également eu cette possibilité, mais elle ne croit pas que cela les ait convaincu·e·s. Mx. J. était d’ailleurs conscient·e que l’opposition de certain·e·s au vaccin COVID était « viscérale » comme il-elle le formulait, et qu’il n’y aurait pas de moyen de les convaincre. En revanche, dans sa gestion du personnel hospitalier au centre de vaccination, il-elle nous explique : « Je ne pouvais pas accepter que des gens ici vaccinent, alors qu’ils n’étaient pas vaccinés. » Le personnel réticent était donc orienté vers un autre service.
Les infirmières que nous avons interrogées n’ont quant à elles jamais eu à se réorienter dans un autre service. Elles nous ont toutes expliqué que différents aménagements avaient été mis en place par les responsables pour leurs permettre de continuer leur travail. Des tests poolés étaient organisés par les différentes institutions, également dans les écoles, comme nous a l’expliqué Mx. D. Toutes nos intervenantes ont apprécié ces solutions mises à leur disposition. Océane se rappelle :
« Donc c’est vrai que ça restait une contrainte, mais une contrainte accessible, pas quelque chose… Enfin, moi j’ai eu cette inquiétude qu’à un moment donné la contrainte soit telle qu’on ne puisse plus dire non. Et ça n’a pas été le cas. »
La crainte de l’obligation vaccinale était bien présente. Surtout qu’en France la vaccination des soignant·e·s était obligatoire, et que celle-ci a également été discuté en Suisse (Kottelat, 2021, Revello, 2021). Les infirmières rencontrées étaient donc toutes plutôt reconnaissantes, et n’ont pas fait état de tensions avec la hiérarchie, ce que leur refus aurait pu provoquer.
« On est un peu jugées malheureusement, alors que dans notre métier le jugement n’a pas sa place. » – Chloé
Bien que dans les service médicaux la hiérarchie semble avoir respecté le choix du refus vaccinal, les deux infirmières encore en formation ont ressenti une forte pression de la part de leur école : le-la directeur·trice avait envoyé une lettre aux personnes non-vaccinées. Pour Jade : « C’était limite presque une menace. Moi je l’ai perçu comme ça. C’était une menace bien forte, une lettre bien adressée pour qu’on se vaccine. » Elle nous raconte que certain·e·s élèves avaient pris rendez-vous avec le-la directeur·rice pour que leur choix soit plus respecté, sans que cela n’aboutisse. Les deux amies ont ressenti un jugement très fort de la part de leur entourage, et leur soutien mutuel, ainsi que celui d’autres personnes non-vaccinées (notamment grâce à un groupe WhatsApp d’élèves de leur école refusant la vaccination contre la COVID) a été primordial pour elles. Le vocabulaire de la résistance est récupéré par ces deux intervenantes. Par exemple, Jade nous dit :
« Déjà là je m’étonne d’avoir résisté. Je me dis que c’est peut-être aussi parce que j’ai vécu avec des gens qui n’étaient pas vaccinés non plus et que ça m’a conforté dans mon choix et que ça m’a soutenue. Si je n’avais pas eu ce soutien, j’aurais peut-être cédé. »
Elles s’accordent à dire que dans leur stage elles ont ressenti beaucoup moins de pression de la part des supérieur·e·s. Les autres infirmières rejoignent ce constat, et comme nous l’explique Chloé, le jugement ne vient pas des supérieur·e·s hiérarchiques, mais plutôt des collègues : « Enfin, il y a quelques mois, il y a eu un jugement sur un patient qui était là, pas vacciné, et qui a eu la COVID. » Ainsi le jugement ne se fait peut-être pas directement sur les soignant·e·s mais des remarques sur les patient·e·s peuvent également être difficiles à supporter. Surtout que les infirmières avec lesquelles nous avons parlé se présentent comme des personnes qui elles-mêmes ne jugent pas.
L’entourage familial peut également être une source de tension. La situation de Chloé est un peu particulière à cet égard :
« Alors moi, j’ai une tante et un cousin qui sont médecins. Ils sont à fond sur ça, mais ils ne savent pas me donner la raison pour laquelle ils sont à fond dans le vaccin. Ils disent qu’il faut faire confiance à la science. »
Par ailleurs, aucune autre infirmière n’a éprouvé de difficulté particulière dans ses rapports aux médecin·es. Selon l’étude d’Unisanté, presque 90% des médecin·e·s étaient complétement vaccinés, et 73.4% des infirmier·ère·s. Lorsque nous demandons aux intervenantes si elles ont des hypothèses pour expliquer cette différence de taux, la plupart ne savent pas. Inès propose une explication : « J’ai l’impression que, dans les lieux de stage et dans les milieux hospitaliers, il y a beaucoup de médecins qui font les choses sans se demander pourquoi ils le font. »
Lors de notre entretien, Mx. D. avait évoqué le fait que la profession infirmière essaie de s’émanciper, de ne plus être des auxiliaires des médecin·e·s qui simplement « obéissent ». Pourtant, mise à part leur affinité avec les médecines alternatives – qu’elles ne thématisent toutefois pas comme un désir d’émancipation – aucune référence à une volonté d’affirmer une identité particulière de la profession infirmière n’a été faite par les personnes interrogées. Chloé revient cependant sur l’importance d’une collaboration entre les deux professions pour une meilleure prise en charge des patient·e·s. Elle ajoute :
« On a cette chance là que c’est vrai que nos médecins […] ont confiance en nous, et ils nous laissent quand même bien travailler en prenant des initiatives, mais avec les médecins assistants c’est plus compliqué. »
Ce ne sont pourtant pas des éléments suffisants pour confirmer notre hypothèse du refus de la vaccination comme l’affirmation d’une identité propre à la profession d’infirmière.
« Le taux de contagion est diminué, mais il est quand même présent. » – Emma
La vaccination du personnel soignant a pu apparaître comme un enjeu majeur pour endiguer la crise du coronavirus, en témoigne le fait qu’une étude dédiée à cette question ait été menée par Unisanté. Pourtant, pour les infirmières interrogées, travailler dans les soins n’est pas une raison suffisante pour accepter la vaccination. Comme le souligne Emma : « Ce n’est pas parce qu’on est dans un métier de la santé que l’on va suivre tout ce qui se fait dans le domaine médical. »
C’est également une critique que fait Océane : « Y a aussi ce côté, l’infirmière n’est pas traitée à la même enseigne que les autres. » Se pose ainsi la question de ce à quoi doivent consentir les soignant·e·s pour exercer leur métier. Les infirmier·ère·s ont déjà assuré un rôle fondamental dans ces périodes de crise, et celui-ci a été reconnu par la population, à la fois au travers des applaudissements de 21h et par le soutien à l’initiative pour les soins infirmiers lors du vote de novembre 2021 (Wicky, 2021). Une vaccination obligatoire, telle qu’elle le fut en France, peut être vue comme une injonction à un sacrifice supplémentaire. Alors que certain·e·s responsables telles que Mx. J. se positionnent clairement en faveur d’une obligation vaccinale contre la COVID pour le personnel soignant, dans l’idée que la « responsabilité c’est de protéger les patients », d’autres se montrent plus modéré·e·s. Mx. D. nous explique :
« Dans la profession infirmière, on doit donner l’exemple, donc nous, on doit être exemplaires. Il y a ce mélange entre qui je suis dans la vie professionnelle, et mes convictions intimes personnelles. On n’est plus des bonnes sœurs, on a une vie. On peut ne pas être d’accord et on n’obéit pas juste uniquement. »
Ainsi, lors de nos entretiens, l’argument que nous avancions en termes de protection des patient·e·s était rapidement balayé par les intervenant·e·s. Comme l’explique Océane : « J’estimais qu’avec les gestes barrières je protégeais déjà cette population. » Une autre manière d’éviter l’accusation d’égoïsme était de rappeler que ses collègues ne l’avaient pas fait particulièrement par un souci de l’autre, mais que bien souvent les raisons de la vaccination étaient pour partir en vacances, ou aller au restaurant.
Dans tous les cas, au vu des entretiens que nous avons menés, il semble peu probable qu’une obligation vaccinale soit un moyen de convaincre les réticent·e·s. Même si certaines ont affirmé lors des entretiens que dans une telle situation elles hésiteraient à changer de métier, cela reste une chose à laquelle elles préfèrent ne pas penser. Si elles devaient se vacciner sous la contrainte, ce serait selon nous une source de tensions dans les équipes et surtout, cela ne les convaincrait pas du bien-fondé scientifique de la vaccination. De plus, nous avons pu remarquer qu’insister sur la vaccination comme un devoir moral n’est pas plus efficace, et au contraire pourrait même être contre-productif. Comme l’explique Rosenfeld et Tomyiama (2022) :
« Intuitivement, le fait de blâmer les personnes qui évitent de se faire vacciner contre le COVID-19 peut sembler une stratégie efficace pour créer des normes morales prescriptives qui incitent à se faire vacciner. Pourtant, les gens se mettent facilement sur la défensive lorsqu’ils sentent que leur image morale est menacée. »
Conclusion
Le but de notre recherche était de comprendre les motifs de refus du vaccin chez le personnel infirmier. L’analyse des entretiens avec les infirmières rejoint les résultats de l’étude d’Unisanté sur le personnel des hôpitaux vaudois : les motivations sont souvent le manque de recul, la trop grande rapidité du développement du vaccin contre la COVID, les inconnues sur la technologie ARN, le sentiment de ne pas courir de risque à titre personnel et celui de ne pas faire courir de risque aux patient·e·s en appliquant les gestes barrières. Les théories complotistes étaient quasiment absentes, comme dans l’étude Unisanté. En revanche, les thèmes de la grossesse et de la crainte de l’infertilité, très présents dans cette étude, n’apparaissaient qu’en filigrane dans nos entretiens.
L’idée qu’une motivation spécifique aux infirmièr·e·s pourrait être l’affirmation d’une identité professionnelle et les rapports hiérarchiques parfois difficiles avec le corps médical a été soutenue par Mx. D. Dans les entretiens avec les infirmières, cette problématique était présente mais n’était pas explicitement invoquée comme ayant influencé leur choix de refuser le vaccin. En conclusion, nous avons pu observer que les arguments mobilisés pour justifier un refus vaccinal chez les infirmières sont proches de ceux de la population, bien que certains éléments propres à leur pratique étaient leur discours. Ceux-ci peuvent être des témoignages rapportés par leur patient·e·s, des observations qu’elles-mêmes ont pu faire de personnes atteint·e·s de la COVID-19, ou des éléments appris pendant leur formation. L’abandon très rapide des mesures de prévention au printemps 2022, justifié par le changement de comportement du virus, a souvent été ressenti comme une preuve de l’incohérence des politiques sanitaires et une confirmation de l’inutilité du vaccin. En revanche, comme les infirmières interrogées n’étaient en principe pas opposées aux vaccins « historiques », si la vaccination contre la COVID-19 devenait à nouveau un enjeu majeur dans le futur, nous pouvons supposer que celles-ci pourraient être convaincues par des arguments scientifiques encourageants.
Bibliographie
Sources primaires
BAUD, David (2022), « Votre courrier du 1er novembre concernant le bulletin d’information « Vaccination contre le COVID-19 pendant la grossesse ». Disponible sur : https://www.reinfosante.ch/femmes-enceintes/ [consulté le 19.05.2022].
BROCARD, Martine (2019), « Entre médecins et infirmiers, une hiérarchie tenace », Hémisphère, n°17. Disponible sur : https://revuehemispheres.ch/entre-medecins-et-infirmiers-une-hierarchie-tenace/ [consulté le 08.06.2022].
Déclaration conjointe de l’OMS, des Nations Unies, de l’UNICEF, du PNUD, de l’UNESCO, de l’ONUSIDA, de l’UIT, de l’initiative Global Pulse et de la FICR, (2020) « Gestion de l’infodémie sur la COVID-19 : Promouvoir des comportements sains et atténuer les effets néfastes de la diffusion d’informations fausses et trompeuses ». Disponible sur : https://www.who.int/fr/news/item/23-09-2020-managing-the-covid-19-infodemic-promoting-healthy-behaviours-and-mitigating-the-harm-from-misinformation-and-disinformation [consulté le 19.05.2022].
« Coronavirus : voici comment nous protéger », OFSP. Disponible sur : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html#1770417724 [consulté le 20.05.2022].
KOTTELAT, Didier (2021) « Au Parlement, la vaccination obligatoire ne séduit pas (encore?) », RTS Info, 9 décembre 2021. Disponible sur : https://www.rts.ch/info/suisse/12701644-au-parlement-la-vaccination-obligatoire-ne-seduit-pas-encore.html [consulté le 28.03.2022].
REVELLO, Sylvia (2021) « En Suisse, la vaccination obligatoire pour les soignants n’est pas à l’ordre du jour », Le Temps, 13 juillet 2021. Disponible sur : https://www.letemps.ch/suisse/suisse-vaccination-obligatoire-soignants-nest-lordre-jour [consulté le 28.03.2022].
ROBERT, Denis (2022), « Les dissidents : immersion dans les sphères conspirationnistes », YouTube. Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=Dj6h0OqUjzY&t=1640s [consulté le 06.06.2022].
SKJELLAUG, Aïna (2021) « Inka Moritz: « Une infirmière qui ne se vaccine pas, c’est une pilote qui refuse de monter dans l’avion » », Le Temps, 7 mai 2021. Disponible sur : https://www.letemps.ch/suisse/inka-moritz-une-infirmiere-ne-se-vaccine-cest-une-pilote-refuse-monter-lavion [consulté le 28.03.2022].
Témoignages des infirmiers, https://www.reinfosante.ch/temoignages/ [consulté le 28.03.2022].
WICKY, Julien (2021), « Le Covid consolide l’initiative sur les soins infirmiers », 24 Heures, 17 novembre 2021. Disponible sur : https://www.24heures.ch/le-covid-consolide-linitiative-sur-les-soins-infirmiers-371888954436 [consulté le 09.06.2023]
Sources secondaires
BOYEAU Cécile, et al. (2011), « Couverture vaccinale antigrippale saisonnière et pandémique (H1N1) 2009 : étude auprès du personnel du chu d’Angers », Santé Publique, vol. 23, n°1, pp. 19-29. Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2011-1-page-19.htm [consulté le 29.03.2022].
CORDONIER, Laurent, DIEGUEZ, Laurent (2021), « Le complotisme, un outil de mobilisation dangereux », Tangram, n°45. Disponible sur : https://www.ekr.admin.ch/f847.html [consulté le 06.06.2022].
EHRENREICH, Barbara, ENGLISH, Deirdre (2018 [1973]), Sorcières, sages-femmes et infirmières : une histoire des femmes et de la médecine, Montréal, Les Éditions du Remue-Ménage.
GUIMIER, Lucie (2021), « Les résistances françaises aux vaccinations : continuité et ruptures à la lumière de la pandémie de Covid-19 », Hérodote, vol.4, n° 183, pp. 227-250. Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-herodote-2021-4-page-227.htm [consulté le 29.03.2022].
GERBER, Michelle, KRAFT, Esther, BOSSHARD, Christophe (2018), « La collaboration interprofessionnelle sous l’angle de la qualité », Bulletin des Médecins Suisses, vol. 99, n°44, pp. 1524-1529. Disponible sur : https://bullmed.ch/article/doi/saez.2018.17276 [consulté le 08.06.2022].
HABERSAAT, Katrine Bach, JACKSON, Cath (2020) « Understanding vaccine acceptance and demand—and ways to increase them ». Bundesgesundheitsbl, n°63, pp. 32–39. Disponible sur : https://doi.org/10.1007/s00103-019-03063-0 [consulté le 06.06.2022].
HASSENTEUFEL, Patrick (2020). « Handling the COVID-19 crisis in France: Paradoxes of a centralized state-led health system ». European Policy Analysis, vol. 6, n°2, pp. 170– 179. Disponible sur : https://doi.org/10.1002/epa2.1104 [consulté le 06.06.2022].
MESH, Gustavo, SCHWIRIAN, Kent (2015), « Social and political determinants of vaccine hesitancy: Lessons learned from the H1N1 pandemic of 2009-2010 », American Journal of Infection Control, vol. 43, n°11, pp.1161-1165. Disponible sur : ajicjournal.org/article/S0196-6553(15)00750-6/fulltext [consulté le 28.03.2022].
PIERCE, Charles S. (1984 [1877]), « Comment se fixe la croyance », in Textes anticartésiens, trad. et prés. J. Chenu, Paris, Aubier, pp. 267-286.
ROSENFELD, Daniel, TOMIYAMA, Janet (2022), « Jab my arm, not my morality: Perceived moral reproach as a barrier to COVID-19 vaccine uptake », Social Science & Medecine, vol. 294. Disponible sur : https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.114699 [consulté le 28.03.2022].
SCHÄFER-KELLER, Petra, SCHAFFERT-WITVLIET, Bianca (2021), « Des faits et des informations sur la vaccination contre le coronavirus. Se faire vacciner contre le Covid ? S’informer et décider », Soins infirmiers, pp. 52-57, disponible sur : https://www.heds-fr.ch/fr/ecole/actualites/des-faits-sur-la-vaccination-contre-le-coronavirus/ [consulté le 08.06.2022].
VIGNAUD, Laurent-Henri (2021), « La vaccination de Pasteur aux antivax », Sciences Humaines, n°340, p. 15. Disponible sur : https://www.cairn.info/magazine-sciences-humaines-2021-10-page-15.htm [consulté le 20.05.2022]. ZIELINSKA, Anna C. (2021), « L’hésitation vaccinale en France dans le contexte de la Covid-19. Une perspective comparatiste », Revue française d’éthique appliquée, vol. 1, n°11, pp. 141-155. Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-francaise-d-ethique-appliquee-2021-1-page-141.htm [consulté le 29.03.2022].