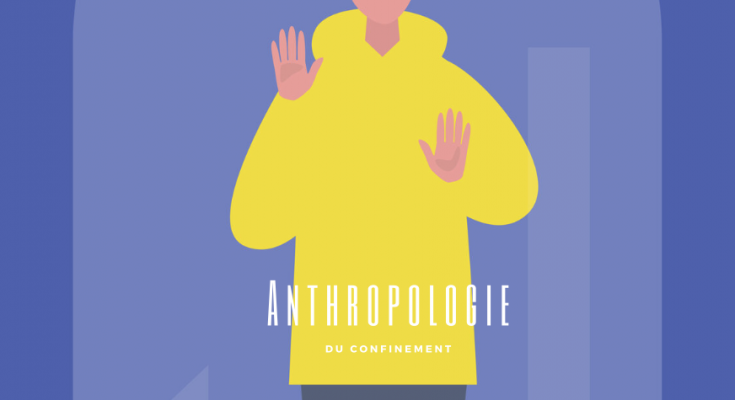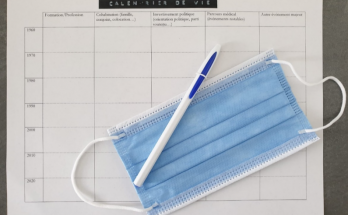Par Fanny Parise
Cet article s’appuie sur les données récoltées via une enquête quantitative en ligne (3 vagues sur 4 ont été lancées au 3 mai 2020), menée auprès d’un échantillon de 6000 personnes représentatif de la population de Suisse et de France, âgée de 18 à 70 ans établi sur la base de quotas sur les critères suivants : âge, sexe, catégorie socioprofessionnelle, région et taille de l’agglomération de résidence ; et sur une étude qualitative en cours, menée auprès d’un échantillon de 60 individus.
La crise du COVID-19 bouleverse la morphologie sociale (structure et forme de la société), les règles de proxémie (distance socialement acceptable entre deux individus en fonction des situations) et érige le logement comme ultime sociofuge (espace qui favorise l’isolement social). Autant de changements qui œuvrent à la mise en place de routines provisoires et instaurent de nouvelles conventions sociales. Dans ce contexte, porter un masque et faire un “check” du coude deviennent des pratiques chargées de sens et peuvent même être considérées comme des phénomènes sociaux totaux (un fait qui permet d’expliquer l’ensemble de la société).
De l’étude CONSOVID-19 à l’Anthropologie du confinement.
Cette situation participe à ébranler les connaissances des anthropologues sur les mondes contemporains et sur le sens que les individus fondent dans leur quotidien. C’est dans cette optique que CONSOVID-19 a été lancée en mars 2020, à travers l’étude de l’évolution des comportements et des représentations liées à la consommation de la population tout au long du confinement. L’impact systémique des mesures sanito-politiques nous ont rapidement conduit à penser un protocole de recherche cohérent avec la diffusion d’outils adaptés à la situation exceptionnelle engendrée par COVID-19. Par exemple, nous avons mis en place des plateformes digitales afin de rendre accessible l’évolution de notre travail : chaine de Podcast, site Internet dédié et projet spéculatif associé (mobilisation de l’ethno-design, suivant une approche similaire à celle de M. Augé). Cette posture scientifique s’inscrit en réaction à la dynamique de “démocratie technique”, initiée par la gestion médiatique de la crise par l’ensemble des acteurs (politique, santé, expert, scientifique, profane, etc.), qui semble se rapprocher du modèle de “forum hybride” théorisé par M. Callon, P. Lascoumes et Y. Barthe. En quelque sorte, chaque individu devient « expert » de la crise. Les discours politiques, médiatiques et profanes s’entremêlent et engendrent l’émergence de théories conspirationnistes, et par extension de la nécessité de donner accès à une information neutre grâce à la vulgarisation scientifique, par exemple.
Plus précisément, notre recherche propose d’appréhender la période actuelle comme une catégorie de rite de passage spécifique (rite d’initiation à un nouveau mode de vie), par l’intermédiaire d’une ethnologie du confinement. Il s’agit de s’intéresser à l’ensemble des aspects de la vie quotidienne d’un individu : consommation, alimentation, planning domestique, vie de famille, etc., par la réalisation d’entretiens en visioconférences (1h30) et par la collecte de photographies et de vidéos par les participants eux-mêmes. Plus précisément, d’un côté nous avons le confinement qui peut être perçu comme une action salutaire pour celui ou ceux qui décident de se confiner ou de confiner les autres. Il peut également être le théâtre d’un “système de cruauté”, tel un miroir de notre société. Étudier ce phénomène d’un point de vue anthropologique équivaut à observer dans un milieu naturel (reconstitué ou non) les interactions sociales de groupes d’individus spécifiques, dans une société donnée. De l’autre côté, nous avons une littérature riche qui objective l’importance des rites de passages dans la vie des hommes. Ces derniers permettent de lier l’individu à un groupe mais aussi de structurer sa vie en étapes précises. Ils peuvent être entrevus comme des “fictions collectives qui ont pour but d’ordonner la nature” et qui participent à la “symbolisation du monde” pour le rendre plus familier. Les 3 étapes qui structurent un rite de passage : sacralisation (rites préliminaires), marginalisation (rites liminaires), désacralisation (rites postliminaires) offrent un cadre d’analyse propice à nos recherches.
Eclairage quantitatif et qualitatif.
L’étude quantitative (2 premières vagues de questionnaires en ligne) révèle que c’est le degré de proximité avec COVID-19 qui va structurer les routines de confinement, les pratiques de consommation et les imaginaires associés à cette crise. Quatre typologies de « confinés” se distinguent : les naufragés pour 34% des répondants (peu de sorties hors-domicile et/ou assistance à des personnes fragiles), les entre-deux à 46% (télétravail, sorties fréquentes du domicile. Le confinement est perçu comme un moment privilégié), les (travailleurs) essentiels à 12% (augmentation de la charge mentale vis-à-vis de l’activité professionnelle et dégradation des conditions de vie) et les exilés qui représentent 8% des répondant (lieu de confinement autre que le lieu de vie habituel, valorisation de l’entre-soi). Le sentiment de proxémievécue et perçue avec le virus va donc être corrélé à la fréquence, au type (volontaire ou contraint) et à la quantité d’interactions sociales auxquelles elles doivent faire face : la typologie des (travailleurs) essentiels semble plus exposée que les typologies des naufragés ou des exilés.
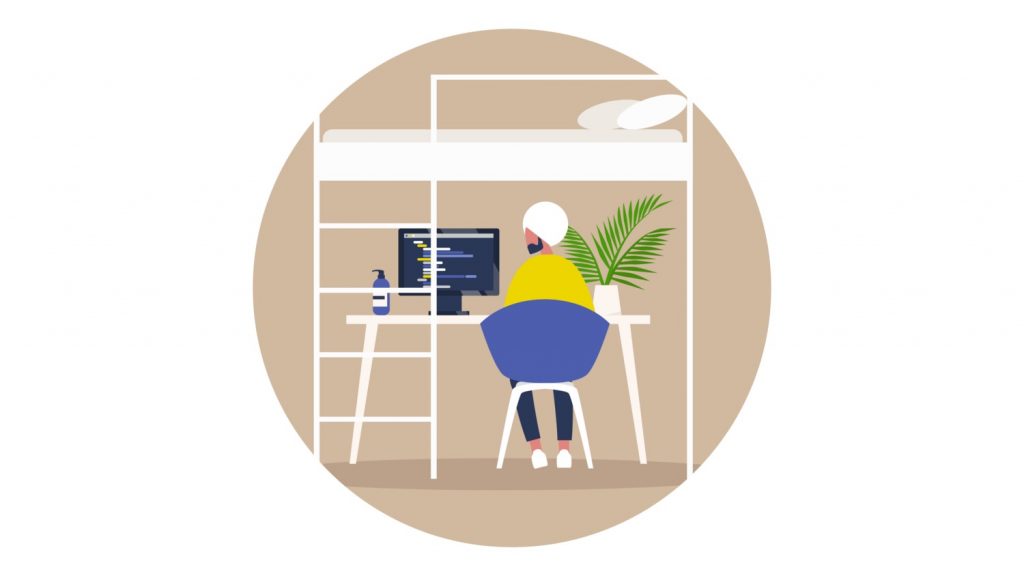
Télétravail, sorties fréquentes du domicile.
Le confinement est perçu comme un moment privilégié.

Augmentation de la charge mentale vis-à-vis de l’activité
professionnelle et dégradation des conditions de vie.

Peu de sorties hors-domicile
et/ou assistance à des personnes fragiles.
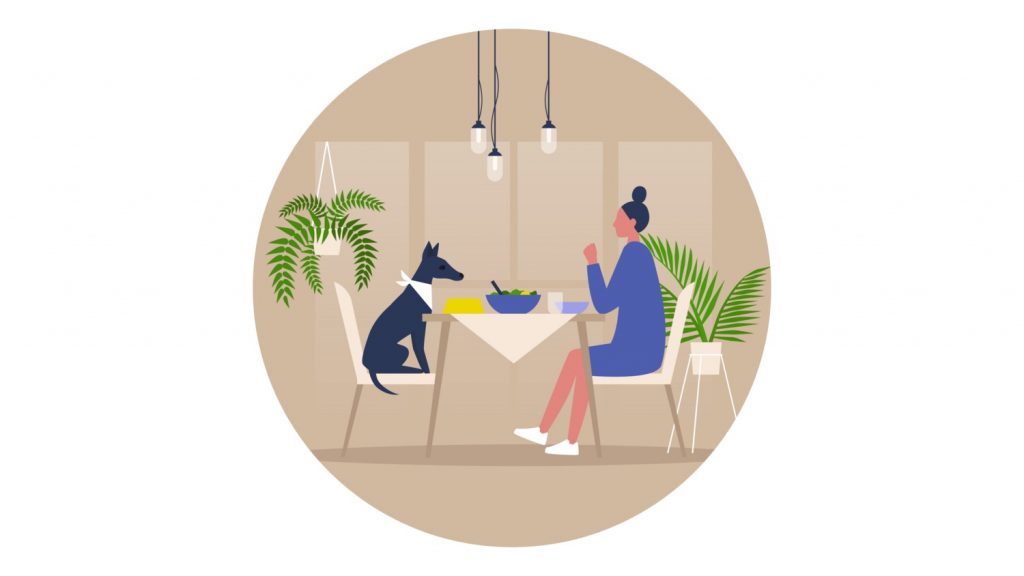
Lieu de confinement autre que le lieu de vie habituel,
valorisation de l’entre-soi.
L’étude qualitative elle, permet d’objectiver des enjeux anthropologiques avec lesquels les individus comme le collectif vont devoir interagir pour s’adapter aux pratiques et représentations (semi-provisoires) mises en place afin d’affronter cette situation, et cela à toutes les échelles d’observation. 6 thématiques principales ont pu être identifiées durant cette phase de la recherche :
- Objet totem : COVID-19 érige de nouveaux objets totems qui permettent d’expliquer les stratégies individuelles comme collectives entourant la crise actuelle : masque, papier WC, smartphone, webcam, gel hydroalcoolique, etc.
- Rituels de salutations : Le respect des gestes barrières amène les individus à renoncer aux rituels de salutations, comme faire la bise ou serrer la main. Mais cette injonction à la distance sociale va-t-elle perdurer après le confinement ?
- Conventions sociales : Garder ses distances dans les lieux publics et/ou porter un masque modifient les conventions sociales. Comment signifier à un individu que l’on souhaite entrer en interaction avec lui ? Comment ne pas vexer un individu lorsque l’on change de trottoir à son approche ?
- Purification : L’hygiène et le lavage des mains n’ont jamais autant fait parler ! Les enjeux de purification des mains, mais également des objets de consommation entrainent la mise en place de nouvelles pratiques lors des sorties ou des retours au domicile.
- Ultra-connexion : L’expérience du confinement que nous vivons est également une expérience de la digitalisation de nos modes de vie. A travers l’hybridation des relations sociales et numériques, du commerce de proximité et du online, les individus expérimentent un nouveau rapport à soi et aux autres.
- Spiritualité : COVID-19 est également une crise des consciences et questionne la place que nous avons dans notre société, mais également dans le monde. Entre nouvelles pratiques spirituelles et réinvention des rituels de foi, les individus innovent pour affronter l’incertain de cette situation.
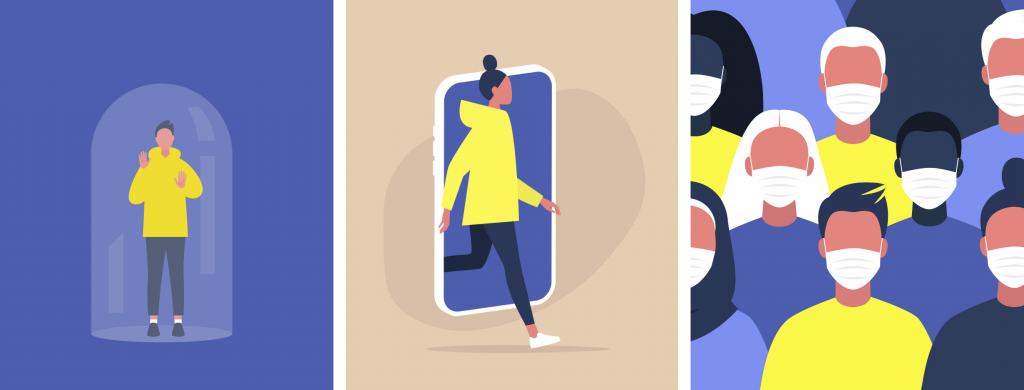
Ces thématiques ont permis d’objectiver en phase quantitative des enjeux transversaux qui, en phase qualitative, ont pu être approfondis avec les individus interrogés :
- Une envie de changer de vie : Dès les premiers jours du confinement, une grande partie des répondants aspirent à changer de vie après la crise que nous vivons. De manière pragmatique, le confinement questionne sur les habitudes de consommation, de mobilité et même de travail.
- Un nouveau rapport au temps : Le confinement bouleverse le rapport individuel comme collectif que les individus entretiennent avec le temps. Tout un chacun doit composer avec une alternance de temps “nouveaux” : le temps de l’urgence, le temps long et même l’accélération du temps.
- Une perte de confort qui fait peur : Au-delà des aspirations humanistes que déclenche cette crise, la perte du niveau de vie et du confort au quotidien font peur aux individus.
- Une consommation plus éthique : La peur de la pénurie face à la diminution des échanges internationaux engendre une volonté de privilégier un mode de consommation plus éthique. Différentes justifications : santé, solidarité envers les producteurs et respect des conditions de travail des livreurs (directement exposés au virus).
- Une vie sociale bouleversée : Le confinement touche en premier lieu la sphère sociale, bien que les répondants mettent en place des stratégies de communication digitale et de nouveaux rituels sociaux, la distance avec les proches est vécue comme compliquée et questionne pour l’après.
- Une crise politique : Pour les répondants, la crise que nous sommes en train de vivre, est avant tout politique avant d’être sanitaire ou économique. Selon eux, la situation actuelle est à la fois l’expression des dysfonctionnements de notre système de santé et des paradoxes de notre société.
Vers une Anthropologie du déconfinement ?
Alors que les mesures de déconfinement se précisent en Suisse et en France, cette prochaine étape vers l’instauration d’une néo-normalité peut inquiéter. Certains individus déclarent avoir vécu le confinement comme une “parenthèse enchantée” et nombre de répondants s’interrogent sur les contours de ce nouveau quotidien. Le déconfinement renvoie à un imaginaire anxiogène (voir eschatologique), questionne sur l’après et (re)interroge les 6 thématiques précédemment identifiées : une problématique liée à la notion de “consentement” pour les rituels de salutations émerge tout comme une appréhension face aux nouvelles conventions sociales instaurées dans les commerces non-essentiels se dessine.
Pour réduire l’incertitude et augmenter leurs marges de manœuvre face à cette nouvelle “gestion culturelle du risque” (M. Douglas), les individus arbitrent vis-à-vis de la dangerosité d’une pratique ou d’une situation en prenant en considération 4 variables spatio-symboliques. Ils construisent intuitivement des systèmes de classification de la saleté (du visible à l’invisible), de la pollution (de l’air, des surfaces, de la peau), des objets nécessaires (masque, gant, désinfectant) et de la sécurité (gestes barrières, civisme, dispositifs spécifiques).
Notre recherche se poursuit et met à présent en perspective les résultats déjà obtenus avec l’observation des stratégies déployées par ces mêmes individus pour agir dans un monde qu’ils perçoivent comme incertain à mesure que le début du processus de déconfinement approche. Pour le moment, l’espérance fondée dans l’attente de la fin du confinement semble se heurter à une crainte d’un futur non-maitrisé, malgré les aspirations de changements de société évoqués dès le début du confinement par nos répondants.
Pour participer Répondre à la troisième vague de questionnaire.
Pour aller plus loin https://anthropologieduconfinement.com
https://www.anthropologiedudeconfinement.com
Images ©Fanny_Parise
Fanny Parise est anthropologue et chercheuse associée à l’ILTP à l’Université de Lausanne. Elle est spécialiste des mondes contemporains et de l’évolution des modes de vie depuis 10 ans. Elle mène actuellement une étude quantitative et qualitative (Suisse & France) sur l’impact du confinement et du déconfinement dans nos vies.