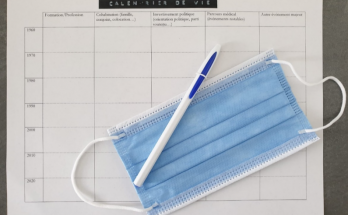Par Gaëlle Venard, Stijn Van Petegem et Grégoire Zimmermann
La crise sanitaire a amené les familles à réorganiser leur quotidien. Quelles sont les conséquences possibles sur les dynamiques familiales ?
Suite au confinement, officiellement décrété par le Conseil Fédéral le 16 mars 2020, chacune et chacun d’entre nous avons dû faire face à une situation inédite qui a entrainé une réorganisation de notre vie quotidienne. Avec la fermeture des écoles et l’annulation des activités extrascolaires, les familles ont particulièrement été touchées. Une grande majorité des parents ont dû honorer leurs obligations professionnelles en travaillant depuis leur domicile tout en assurant la garde de leurs enfants. Ainsi, les parents – et les mères en particulier – ont dû faire face à une double injonction : assurer les tâches éducatives et de soin de leur enfant tout en travaillant efficacement, et ce, sans pouvoir compter, par exemple, sur l’aide des grands-parents. En tant que chercheurs-psychologues rattachés au Centre de recherche sur la famille et le développement (FADO) de l’Université de Lausanne, il nous a semblé important d’apporter une esquisse de nos réflexions quant à cette réorganisation familiale soudaine. Il est probable que cette situation exceptionnelle ait accentué la charge mentale et éducative qui incombe aux parents, et qu’elle ait pu les mettre à mal dans leur rôle parental, menaçant potentiellement non pas seulement leur propre santé mentale, mais aussi le développement de leur enfant.
Être un parent parfait : des attentes sociétales qui mettent les parents sous pression
Depuis quelques années déjà, plusieurs études ont mis en évidence le phénomène de l’intensive parenting ideology (l’idéologie du parentage intensif) dans nos sociétés occidentales contemporaines (p.ex. Hoffman, 2010). Ce concept désigne l’injonction sociétale généralement véhiculée par les médias (livres, émissions télévisées, réseaux sociaux), mais aussi par les autres parents (Bernstein & Triger, 2011) à être un « parent parfait ». Il s’agirait aujourd’hui pour les parents d’être très investis dans leur rôle parental, en consacrant notamment beaucoup de temps, d’argent et d’énergie pour l’éducation de leur enfant. Cette pression à être un « parent parfait » concernerait également le devoir d’être au courant et d’appliquer tout ce qui est conseillé pour le développement optimal d’un enfant. L’implication intensive du parent débuterait dès la naissance de l’enfant avec, par exemple, une grande attention portée à la qualité de la nourriture et aux étapes développementales de l’enfant. Puis, cette attention se poursuivrait jusqu’à l’adolescence et même au-delà (p.ex., suivi intensif des performances scolaires, surveillance stricte du temps passé devant les écrans, etc.). Toutefois, la poursuite de cet idéal parental semble constituer une source de pression importante pour de nombreux parents, les conduisant à mettre au premier plan leur enfant au détriment parfois de leurs propres besoins. Certains résultats de recherche issus des travaux menés au Centre de recherche sur la famille et le développement (FADO) indiquent, par exemple, que les femmes sont particulièrement sensibles à la pression sociale concernant la parentalité, et qu’elles se sentent souvent obligées d’aspirer à la perfection dans leur rôle parental. En effet, nos résultats indiquent que plus celles-ci ressentent de la pression de la part des médias, de la société ou d’autres parents, plus elles ont tendance à s’occuper démesurément de leur enfant.
Durant la période de confinement, une multitude de messages supplémentaires (p.ex., conseils pour l’organisation de la journée, pour la gestion du temps d’écrans, etc.) ont été diffusés via les médias et les réseaux sociaux afin de soutenir les parents dans l’organisation de la vie familiale. Malheureusement, il est possible qu’au lieu de soutenir les parents dans leur rôle et de les accompagner dans cette période incertaine, ce déluge de conseils n’ait contribué qu’à accentuer la pression sur certains parents. Or, cette pression peut comporter certains risques à long terme sur le bien-être des différents membres de la famille. Dans certains cas, le parent sensible à la pression environnante et accaparé par les diverses tâches domestiques pourrait finir par souffrir d’épuisement parental (burnout parental ; Roskam & Mikolajczak, 2018). Cet épuisement se traduit par une distance émotionnelle que prend le parent vis-à-vis de son enfant. Il rencontre alors des difficultés à prendre du plaisir dans l’interaction avec son enfant et à s’investir dans son éducation de façon adaptée. Dans cet état, le parent se sent triste, coupable et honteux de ne pas être capable de s’impliquer comme auparavant. En plus de ces symptômes individuels, l’épuisement parental peut conduire à des tensions au sein du couple conjugal, mais aussi à des comportements négligents, voire parfois violents avec l’enfant. Il est possible que la situation engendrée par le confinement ait contribué à augmenter l’épuisement parental chez de nombreux parents. Dans ce contexte, la Professeure Isabelle Roskam de l’Université Catholique de Louvain (UCL), leader dans le domaine de la recherche et de la prise en charge de l’épuisement parental, a, par exemple, diffusé une vidéo préventive sur les risques de burnout parental pendant le confinement. Elle proposait, par exemple, d’assouplir certaines règles habituellement admises, d’accepter de ne pas pouvoir être performant dans tous les domaines (« choisir ses combats), ou encore de structurer les journées de l’enfant (MAIF, 2019).
La menace omniprésente du virus : un autre risque pour le bien-être familial
Il est possible également que la menace omniprésente du COVID-19 ait pu alimenter des phénomènes de surprotection parentale, potentiellement néfastes pour le développement de l’enfant et de l’adolescent. La surprotection parentale se définit par un degré de protection disproportionné par rapport au niveau développemental de l’enfant (Thomasgard et al., 1995). Par exemple, le parent surprotecteur a tendance à vouloir prévenir son enfant des moindres dangers ou contrariétés, à résoudre ses conflits relationnels à sa place et à réagir démesurément lorsqu’il rencontre des problèmes (Brenning et al., 2017). Cette manière d’agir a, en général, pour effet d’entraver l’autonomie de l’enfant et de l’empêcher de développer des compétences nécessaires pour faire face aux difficultés de la vie. En conséquence, les enfants surprotégés auraient davantage de troubles somatiques (p.ex., maux de ventre), anxieux, dépressifs et comportementaux (Van Petegem et al., 2020). Plusieurs travaux indiquent aujourd’hui que les parents anxieux ou inquiets sont ceux qui ont tendance à manifester le plus de pratiques surprotectrices (Segrin, et al., 2013).
Durant le confinement, ces éléments ont pu être largement amplifiés par le climat anxiogène qui régnait. En effet, les mesures strictes d’hygiène et de distanciation sociale, les avis d’experts (parfois contradictoires) sur la gestion de la pandémie ainsi que la diffusion massive d’images et d’informations inquiétantes ont ponctué notre quotidien. Il a été également longtemps question du rôle des enfants dans la dispersion du virus et du bienfondé du retour en classes des élèves. Tous ces éléments ont pu générer du stress et nourrir une perception du monde comme étant dangereux, et ceci en particulier chez les personnes de nature inquiète. En outre, dans les circonstances de la pandémie, certains comportements qui pouvaient être qualifiés de surprotecteurs dans des conditions dites « normales », ont pu être considérés comme adaptés (p.ex. interdiction de sortie du domicile, de voir des amis), en particulier en raison de la menace réelle que constituait le virus. Néanmoins, nous ne pouvons pas exclure que l’anxiété de l’enfant et du parent ainsi que leur perception menaçante du monde perdure, amenant le parent à maintenir un comportement surprotecteur au-delà du confinement au détriment du besoin d’exploration et d’autonomie de l’enfant, et de son développement psychosocial.
Le risque d’une crise après la crise ?
Finalement, le coronavirus pourrait mettre les familles sous pression à plus long terme. Lorsque l’épidémie du COVID-19 a pris de l’ampleur en Europe, les politiques ont longtemps hésité à mettre en place un confinement strict, par peur que l’économie du pays ne soit trop négativement impactée. Finalement les mesures de confinement ayant été décrétées pour plusieurs semaines dans la plupart des contextes européens, il nous semble important d’évoquer les implications qu’une crise économique imminente pourrait avoir sur les dynamiques familiales. Certaines recherches (p.ex. Doepke & Zilibotti, 2019) ont, en effet, mis en exergue le fait que les parents vivant dans un pays à fortes inégalités salariales pouvaient avoir des tendances surprotectrices envers leur enfant, par rapport à des contextes plus égalitaires. Par exemple, aux États-Unis, pour accéder aux universités réputées très onéreuses et sélectives, les parents n’hésiteraient pas à pousser leurs enfants à travailler sans relâche afin qu’ils soient sélectionnés ou qu’ils obtiennent éventuellement une bourse (Lukianoff & Haidt, 2018). Cette inclination à surveiller excessivement l’enfant serait apparue dans les années quatre-vingt, au moment où les inégalités économiques devenaient de plus en plus importantes. Ainsi, les parents seraient devenus particulièrement soucieux de la réussite scolaire de leur enfant, se considérant comme de plus en plus responsables de l’avenir de ce dernier (Doepke & Zilibotti, 2019).
Une certaine sécurité économique a longtemps épargné les familles suisses de cette pression concernant la scolarité de l’enfant. Cependant, l’économie mondiale semble plus incertaine que jamais. Si de plus grandes inégalités apparaissaient à l’avenir au sein du pays et que l’accès au marché du travail devient plus difficile et incertain, cela pourrait amener certains parents en Suisse à adopter des comportements plus surprotecteurs. En effet, ils s’inquièteraient davantage de la réussite économique de leur progéniture et s’investiraient alors d’autant plus pour assurer leur avenir, au détriment de leur propre santé et celle de leur enfant.
Actuellement, nous n’avons pas suffisamment de recul pour affirmer que la crise sanitaire ait provoqué des changements majeurs dans les dynamiques familiales. Toutefois, en prenant en compte de la pression supplémentaire que les parents ont pu ressentir, le climat anxiogène dans lequel la réorganisation familiale s’est effectuée ainsi que l’instabilité socio-économique potentiellement entrainée par le virus, nous faisons l’hypothèse que le bien-être de certaines familles pourrait être fortement impacté. Seul l’avenir nous le dira.
Bibliographie
Bernstein, G., & Triger, Z. (2011). Over-parenting. U.C. Davis Law Review, 44(4), 1221-1280.
Brenning, K.M., Soenens, B., Van Petegem, S., & Kins, E. (2017). Searching for the roots of overprotective parenting in emerging adulthood: Investigating the link with parental attachment representations using an actor partner interdependence model (APIM). Journal of Child and Family Studies, 26(8), 2299-2310. doi:10.1007/s10826-017-0744- 2
Doepke, M., & Zilibotti, F. (2019). Love, money & parenting: How economics explains the way we raise our kids. Princeton, NJ : Princeton University Press.
Hoffman DM (2010) Risky Investments: Parenting and the Production of the ‘Resilient Child’. Health, Risk and Society 12(4): 385–394.
Holmbeck, G. N., Johnson, S. Z., Wills, K. E., McKernon, W., & Rose, B. (2002). Observed and perceived parental overprotection in relation to psychosocial adjustment in preadolescents with a physical disability: The mediational role of behavioral autonomy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 70(1), 96-110. doi:10.1037/0022- 006X.70.1.96
Lukianoff, G., & Haidt, J. (2018). The coddling of the American mind: How good intentions and bad ideas are setting up a generation for failure. New York, NY : Penguin Books.
Roskam, I., & Mikolajczak, M. (2018). Le burn-out parental: Comprendre, diagnostiquer et prendre en charge. De Boeck Superieur.
Segrin, C., Woszidlo, A., Givertz, M., & Montgomery, N. (2013). Parent and child traits associated with overparenting. Journal of Social and Clinical Psychology, 32(6), 569- 595. doi:10.1521/jscp.2013.32.6.569
Thomasgard, M., Metz, W. P., Edelbrock, C., & Shonkoff, J. P. (1995). Parent-child relationship disorders: I. Parental overprotection and the development of the Parent Protection Scale. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 16(4), 244-250. doi:10.1097/00004703-199508000-00006
Van Petegem, S., Antonietti, J.-P., Eira Nunes, C., Kins, E., & Soenens, B. (2020). The relationship between maternal overprotection, adolescent internalizing and externalizing problems, and psychological need frustration: A multi-informant study using response surface analysis. Journal of Youth and Adolescence, 49, 162-177. doi:10.1007/s10964-019-01126-8
Vidéo
MAIF. (2020, 26 mars). Le burnout parental en situation de confinement avec Isabelle Roskam [Vidéo].Youtube
Gaëlle Venard est titulaire d’un Master en psychologie et chercheuse junior FNS au Centre de recherche sur la famille et le développement (FADO – www.unil.ch/fado) de l’Institut de Psychologie de l’Université de Lausanne. Le Dr Stijn Van Petegem est chercheur postdoc et premier-assistant au FADO où il dirige actuellement un projet de recherche FNS sur la surprotection parentale. Grégoire Zimmermann est professeur de psychologie de l’adolescence à l’Institut de Psychologie et membre du FADO.