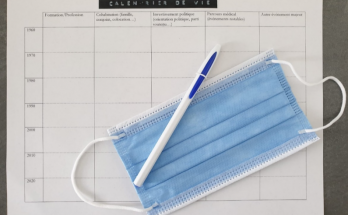Par Nolwenn Bühler et Célia Burnand
Face à l’urgence d’une crise sanitaire, les efforts des autorités sanitaires se concentrent en priorité sur la réduction de la mortalité générale plutôt que sur les effets secondaires de la crise en termes d’inégalités de genre. Or, les femmes[1] semblent particulièrement affectées par les mesures prises par les autorités politiques et sanitaires dans de tels contextes. Par exemple, en Afrique de l’Ouest pendant l’épidémie d’Ebola entre 2014 et 2016, les femmes ont été particulièrement touchées à travers le rôle de care qui leur est assigné socialement. Ce sont également ces femmes qui se sont occupées majoritairement des malades ou encore des enterrements, les exposant ainsi au risque de contamination ainsi qu’à une charge de travail accrue, peu ou pas rémunérée (Menéndez et al. 2015). Par ailleurs, des violences sexuelles et domestiques sont systématiquement rapportées dans des situations d’épidémie, de conflit ou de catastrophes naturelles (Aolain 2011). Cela a notamment été le cas par exemple après le tsunami au Sri Lanka en 2004, l’ouragan Katrina aux USA en 2005, ou encore l’accident nucléaire de Fukushima au Japon en 2011. Ces inégalités liées au genre restent pourtant peu reconnues et prises en compte dans la préparation et la mise en place des stratégies de réponses aux crises humanitaires de la part des acteurs de la santé publique, autant au niveau national qu’international (Davies and Bennett 2016). Comment alors, en cas de crise sanitaire, prendre d’une part rapidement des mesures visant à protéger la population générale, tout en tenant compte d’autre part des besoins spécifiques de certains groupes de la population ou de personnes qui sont déjà concernés par différentes formes d’inégalités ? Comment inclure une dimension de genre dans les réponses sanitaires d’urgence ? Mais surtout, comment comprendre, au-delà de l’urgence, les implications sociales en termes de genre et leurs conséquences sur les pratiques de santé ? C’est ce à quoi nous allons tenter de répondre dans ce post en nous penchant sur la crise actuelle liée à la pandémie de Covid-19, qui si elle semble toucher sa fin en Suisse, n’en demeure pas moins une réalité globale avec laquelle nos sociétés doivent composer dans la durée.
Covid-19 : miroir grossissant des inégalités de genre et de santé ?
Si la pandémie de Covid-19 a par définition une dimension globale, elle est également profondément locale et située, tant dans sa circulation que dans ses répercussions individuelles et collective. Comme un miroir grossissant, elle met en lumière des formes persistantes d’inégalités relues aujourd’hui au prisme de leurs synergies avec la santé. Le vieillissement et l’état de santé général des individus, notamment en lien avec des maladies chroniques, ont rendu certaines catégories d’individus particulièrement vulnérables au virus, en raison du risque accru d’avoir des complications sévères et potentiellement fatales. L’âge a ainsi rapidement permis de caractériser des groupes de population « à risque » – les personnes âgées – mais également de pointer une autre catégorie de la population – les enfants et adolescent·e·s – en raison de leur rôle possible dans les chaînes de transmission virales. En revanche, d’autres éléments socio-économiques, notamment ceux liés au genre, sont restés davantage dans l’ombre des politiques sanitaires. Pourtant, le genre a été très présent durant la pandémie, et ceci à de nombreux niveaux. En se basant sur nos observations de la crise sanitaire notamment dans les médias et les pratiques de la vie quotidienne, ainsi que sur une première revue des publications sur cette thématique, il nous semble que trois espaces surgissent de façon plus saillante.
Tout d’abord, les mesures de confinement adoptées pour protéger la population ont produit un repli de la vie sociale et professionnelle dans l’espace domestique. Les injonctions à « restez chez soi » ont conduit les individus à (ré)investir cet espace, historiquement et socialement constitué comme un domaine réservé aux femmes, en opposition à l’espace public et professionnel, associé traditionnellement au masculin. Cet espace privé, le foyer, est défini par ses tâches reproductives, généralement réalisées gratuitement et de façon invisible par les femmes, en raison justement de leur ancrage dans cet espace. Fusionnés, ces espaces peuvent donner lieu d’une part à des renforcements des pratiques et comportements genrés mais aussi d’autre part, à des réflexions sur la répartition des rôles au sein du foyer en lien avec de possibles réorganisation du travail domestique. Par exemple, le taux de soumission d’articles de chercheuses a fortement diminué pendant la pandémie (Fuchs-Schundeln 2020), ce qui suggère que les femmes ont eu moins de temps à consacrer à leur travail en raison de leur implication dans d’autres tâches quotidiennes du care et d’éducation. D’un autre côté, de nombreux hommes se sont retrouvés impliqués dans le travail domestique, la garde des enfants et la gestion de l’école à la maison lorsque leur partenaire devait travaillait (notamment dans les métiers du care). Par ailleurs, de nombreuses études s’inquiètent de l’isolement qu’induit le (semi-) confinement et la rupture avec les réseaux sociaux, notamment d’entraide (Gelder et al. 2020). L’augmentation des violences domestiques est également un sujet documenté par des chercheur·se·s et une préoccupation pour les professionnel·le·s. Ces violences semblent particulièrement toucher les personnes vivant dans des zones rurales, ainsi que de provenance ethnique non-blanche. Les effets à court et moyen terme de ces reconfigurations des rapports de genre, de même que leurs implications sur la santé restent toutefois à analyser.
Un deuxième espace où le genre est apparu de façon diffuse concerne le travail dit du care, réalisé en grande partie par des femmes et/ou des personnes défavorisées socio-économiquement. Celles-ci reproduisent à l’extérieur du foyer ces mêmes activités de care, qui demeurent peu valorisées financièrement, justement en raison de leur caractère privé et de la vision selon laquelle elles découlent « naturellement » et de façon évidente des identités féminines, ne représentant pas un « véritable » travail producteur de biens ou de valeur financière. Ce travail invisibilisé s’est pourtant retrouvé sur le devant de la scène au travers de la célébration soudaine des professions et services essentiels à la vie humaine, symbolisés par les applaudissements de 21h au balcon, relayés quotidiennement au journal télévisé du soir. Dans un premier temps, ces manifestations de soutien public s’adressaient principalement aux soignant·e·s des soins intensifs célébrés pour lutter « au front » contre le virus, valorisant ainsi, certes une forme de travail de care, mais mise en avant ici avant tout pour ses dimensions héroïques et spectaculaire, en lien avec une médecine hautement technologique. Or, après quelques semaines, d’autres professions du care, comme celles de la distribution alimentaire ou encore du nettoyage, sont également apparues publiquement, élargissant ainsi les célébrations à toutes les pratiques essentielles au fonctionnement de base de la population. Si cette revalorisation sociale de ces tâches souvent considérées comme ingrates est bienvenue, l’expérience de la crise et du travail au cœur de celle-ci doit tout autant être prise en compte par les autorités sanitaires et politiques. Cela pourrait se faire par une réévaluation des salaires ou, par exemple, par un suivi des répercussions sur la santé mentale et physique de la crise sur les travailleur·euse·s, comme le suggèrent des études sur l’anxiété et l’expositions au risque pendant la pandémie (Shanafelt, Ripp, and Trockel 2020). Le vécu et les effets à long terme de cette revalorisation soudaine du care, et de ses implications tant pour la santé que pour les inégalités de genre et de classe demeurent toutefois à explorer.
Un troisième espace où le genre est apparu de façon diffuse est la santé elle-même. Si les hommes semblent être sensiblement plus affectés médicalement parlant par Covid-19 que les femmes, celles-ci semblent en effet plus touchées dans leur santé par les mesures de santé publique adoptées. De manière générale, les besoins de santé identifiés en premier pendants la pandémie auxquels il fallait apporter une réponse étaient majoritairement ceux des hommes (Wenham, Smith, and Morgan 2020), c’est-à-dire que des mesures spécifiques liées aux vulnérabilités de santé des femmes n’ont pas été mises en place. De nombreuses recherches ont été conduites sur les femmes enceintes pour déterminer si le SARS-CoV-2 était dangereux à la fois pour la mère et l’enfant, mais les conséquences autour des difficultés d’accès à la santé reproductive et sexuelle pour femmes et leurs proches restent en revanche peu étudiées. Par exemple, de nombreux accouchements se sont déroulés sans la présence du père ou d’autres proches aidants. Autre exemple, de nombreuses femmes préféraient accoucher hors des hôpitaux submergés par les cas de covid-19. Également, certaines pathologies féminines, telles que l’endométriose (Rowe and Quinlivan 2020) ont pu être laissées de côté dans la bataille contre le Covid-19. Si les efforts contre le virus sont nécessaires et importants, il est crucial de ne pas négliger d’autres problématiques de santé moins visibles au risque de voir les inégalités de santé augmenter.
Vers des politiques sanitaires inclusives ?
De nombreuses « leçons » de la pandémie sont encore à venir. Cette crise nous a néanmoins permis de dévoiler ou de souligner des inégalités de genre, dont nous avons parlé dans ce post, mais également de montrer que pour les comprendre il faut les penser en imbrication avec des inégalités de classe et liées à la racialisation. Ces « leçons » peuvent ainsi amener des opportunités : les professions du care, principalement féminines pourraient être revalorisées financièrement et la proportion de femmes, notamment non-blanches, à des postes décisionnels et parmi les expert·e·s dans les organes de gestion de crise devrait être augmentée. Cela implique également d’inciter les politiques publiques à mettre en place des mesures de santé publique intégrant les enjeux de genre, autant en période de crise qu’à moyen terme. En effet, les sciences sociales se sont mobilisées pour tenter de comprendre ce qui se déroule au nom de la santé publique et ses conséquences sur les inégalités de genre. En mai 2020, l’Association suisse pour les Etudes Genre a publié une liste non-exhaustive des enjeux liés aux genre cristallisés dans la pandémie, dans le but de servir de point de départ à des débats et recherches. Cela a notamment fait suite aux recommandations de la Task Force COVID-19 suisse sur les enjeux de genre de la pandémie et de la réponse. Des projets de recherche tels que SérocoViD, une étude sérologique mandatée par le Canton de Vaud et visant à comprendre comment se transmet le coronavirus et évaluer dans quelle mesure la population générale et certains groupes à risque ont été exposés et ont développé des anticorps, ont rapidement vu le jour. Cette étude comporte un volet qualitatif qui vise à explorer la manière dont le milieu de vie des personnes ayant contracté la maladie, ainsi que celui de leurs contacts proches, impacte la perception du risque d’exposition au virus et les manières de s’en protéger. Allier les sciences sociales à l’épidémiologie et à l’infectiologie permet en effet une compréhension plus holistique des mesures de santé publique et des inégalités, notamment de genre, et ainsi informer des décisions de santé publique qui prennent en compte ces dimensions.
[1] Le terme de « femme » inclut toute personne se reconnaissant comme femme, mais les enjeux liés aux vulnérabilités spécifiques des personnes trans et non-binaires en temps de crise sanitaire ne sont pas approfondis dans ce post.
Références
Aolain, Fionnuala. 2011. “Women, Vulnerability, and Humanitarian Emergencies.” Michigan Journal of Gender & Law18(1):1–23.
Davies, Sara E., and Belinda Bennett. 2016. “A Gendered Human Rights Analysis of Ebola and Zika: Locating Gender in Global Health Emergencies.” International Affairs 92(5):1041–60.
Fuchs-Schundeln, Nicola. 2020. “Gender Structure of Paper Submissions at the Review of Economic Studies during COVID-19: First Evidence.” 6.
Gausman, Jewel, and Ana Langer. 2020. “Sex and Gender Disparities in the COVID-19 Pandemic.” Journal of Women’s Health 29(4):465–466.
Gelder, N. van, A. Peterman, A. Potts, M. O’Donnell, K. Thompson, N. Shah, and S. Oertelt-Prigione. 2020. “COVID-19: Reducing the Risk of Infection Might Increase the Risk of Intimate Partner Violence.” EClinicalMedicine 21.
Harman, Sophie. 2016. “Ebola, Gender and Conspicuously Invisible Women in Global Health Governance.” Third World Quarterly 37(3):524–41.
Menéndez, Clara, Anna Lucas, Khátia Munguambe, and Ana Langer. 2015. “Ebola Crisis: The Unequal Impact on Women and Children’s Health.” The Lancet Global Health 3(3):e130.
Rowe, Heather, and Julie Quinlivan. 2020. “Let’s Not Forget Endometriosis and Infertility amid the Covid-19 Crisis.” Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology 41(2):83–85.
Shanafelt, Tait, Jonathan Ripp, and Mickey Trockel. 2020. “Understanding and Addressing Sources of Anxiety Among Health Care Professionals During the COVID-19 Pandemic.” JAMA 323(21):2133–34.
Wenham, Clare, Julia Smith, and Rosemary Morgan. 2020. “COVID-19: The Gendered Impacts of the Outbreak.” The Lancet 395(10227):846–48.
Célia Burnand est chargée de recherche à Unisanté pour le projet SérocoViD. Sociologue de formation, elle acoordonné des projets pour Médecins Sans Frontières dans des contextes d’épidémies et de conflits en Afrique et au Moyen Orient, mais également en Suisse lors de la pandémie du Covid-19.
Nolwenn Bühler est chercheuse FNS senior à l’Université de Lausanne, Institut des sciences sociales, STSlab et par ailleurs également Maître-Assistante en Etudes Genre à la MAPS – Maison d’analyse des processus sociaux de l’Université de Neuchâtel. Anthropologue de la médecine et de la santé, elle a travaillé sur la médecine reproductive et l’infertilité liée à l’âge et se penche actuellement sur la santé publique de précision et l’exposition environnementale.