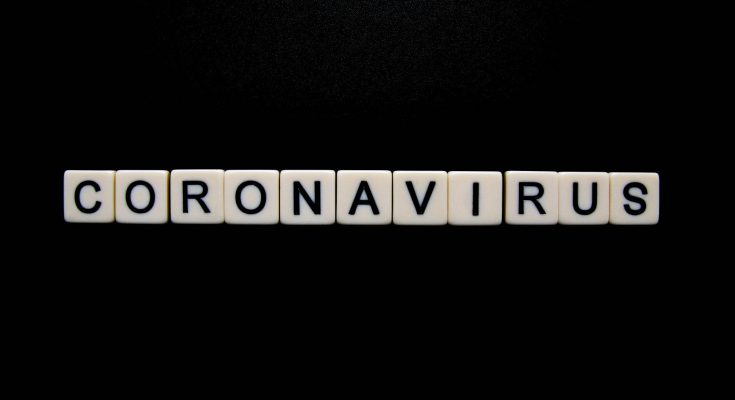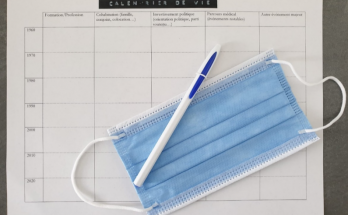Par Nolwenn Bühler
Des mots. Des mots pour dire les incertitudes, les peurs, les espoirs. Des mots pour mettre à distance, pour circonscrire, pour donner du sens, comprendre. Des mots pour rire, des mots pour remplir, des mots pour se dire, se redécouvrir. Depuis l’entrée en confinement qui en un weekend a confirmé la réalité d’un virus qui jusque-là semblait lointain, qui semblait affecter la vie des autres, depuis que nos vies sont directement concernées, les mots se multiplient. De toutes parts des voix s’élèvent pour dire la pandémie, comme si en créant une rupture dans le cours de la vie quotidienne, en marquant un avant et un après à l’échelle d’une société entière, en troublant les repères de l’ordinaire, le coronavirus avait ouvert une brèche propice à la production et la circulation des mots. Récits, discours, nouvelles, messages, informations, articles, vidéos, gags, images cherchent à saisir l’ampleur extraordinaire de l’événement et ce qu’il fait à nos vies personnelles, à nos institutions, au monde globalisé dans lequel nous vivons. Alors pourquoi ajouter une voix, celle des sciences sociales, à ce qui sonne par moments comme un vacarme assourdissant généré dans l’immédiateté de l’expérience présente et l’inconnu dans lequel il nous plonge ? Pourquoi ajouter des mots quand l’histoire de cette pandémie se réécrit jour après jour, au gré des nouvelles informations, connaissances et décisions ? Quand la réflexion d’aujourd’hui semble dépassée le lendemain ? Pourquoi ajouter des mots alors que par moment seule la respiration du silence permettrait de penser sociologiquement et anthropologiquement ce qui se joue ?
Poser ces questions c’est inviter à réfléchir à l’identité des sciences sociales, à ce qui rend leur regard et leur parole spécifique, à ce qui fait leur force dans un moment où l’urgence et le besoin d’action prédominent. En effet, les sciences humaines et sociales (SHS) produisent de la réflexion, de la distance critique, elles ont besoin de temps pour déployer leurs analyses, pour apprendre de ce qu’elles observent, pour faire sens des expériences, des savoirs et des discours qu’elles collectent. L’espace de ce blog fait un pari. Celui que les sciences sociales et humaines peuvent au travers de leurs mots faire une différence et qu’elles ont un rôle à jouer dans l’ici et maintenant de la crise. Rôle qui nécessite de sortit des sentiers battus et de créer de nouvelles manières de faire communauté et d’engager le dialogue avec la société.
Les SHS ont de nombreux outils à leur disposition pour accomplir cette tâche. Tout d’abord, si la pandémie de COVID-19 nous plonge dans l’inconnu, les épidémies ont une longue histoire que les sciences humaines et sociales ont relatée et analysée. Elles peuvent ainsi éclairer le moment présent en mobilisant des connaissances propres à leurs disciplines. Elles peuvent également mobiliser leurs expertises pour éclairer les dimensions sociales, humaines, économiques et politiques dans lesquelles la circulation du virus est enchevêtrée. Si cette pandémie révèle les logiques globales qui organisent le monde dans lequel nous vivons, elle nous rappelle aussi que le contexte local est déterminant. Le virus ne circule pas de la même manière et n’a pas les mêmes effets, d’un pays, d’une région, d’un canton, d’une communauté, ou d’une personne à l’autre. Or les sciences sociales et humaines ont des outils pour penser le global dans le local et rendre compte de l’imbrication des multiples échelles qui déterminent la circulation du virus, les réponses sanitaires et politiques qui lui sont apportées ainsi que leurs implications pour les individus et communautés. Elles sont notamment particulièrement équipées pour rendre compte de la diversité des situations et des inégalités que cette crise (re)produit. Elles peuvent ainsi rendre compte du moment présent et des multiples expériences qu’il génère en utilisant leurs méthodes scientifiques et leurs concepts. Il s’agit aussi pour elles d’une opportunité pour créer des liens et du dialogue avec les communautés locales concernées et impliquées, qu’elles soient scientifiques ou citoyennes, de faire entendre les voix de celles et ceux que l’on n’entend pas, et de sortir de la zone de confort dans laquelle elles ont tendance à se cantonner. Parce que l’on commence à parler de l’après-pandémie et que le futur du monde dans lequel nous vivons se joue aussi maintenant, que les enjeux écologiques, sociaux, économiques et politiques soulevés par la crise sont majeurs et que s’ils sont vécus sur le mode de la catastrophe par beaucoup, ils ouvrent aussi l’espoir d’un monde différent, d’un monde dans lequel le vivre ensemble serait repensé. Si face à l’événement les SHS sont réticentes à l’intervention (Bensa and Fassin 2002), elles peuvent néanmoins s’engager dans ces débats et, de par leur perspective à la fois compréhensive et critique, peut-être faire une différence.
Bensa, Alban, and Eric Fassin. 2002. « Les sciences sociales face à l’événement ». Terrain. Anthropologie & sciences humaines (38):5–20.
Nolwenn Bühler est chercheuse FNS senior à l’Université de Lausanne, Institut des sciences sociales, STSlab et par ailleurs également Maître-Assistante en Etudes Genre à la MAPS – Maison d’analyse des processus sociaux de l’Université de Neuchâtel. Anthropologue de la médecine et de la santé, elle a travaillé sur la médecine reproductive et l’infertilité liée à l’âge et se penche actuellement sur la santé publique de précision et l’exposition environnementale.