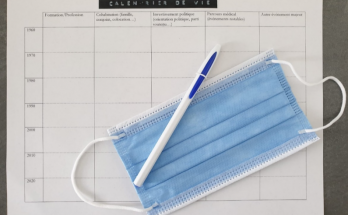Par Léone Ruiz
Jour -5, l’immatérialité des courants d’air.
Depuis des semaines, tout le monde n’a plus que ce mot à la bouche. Mais personne ne saisit vraiment sa portée concrète, ni ce qu’il implique, au-delà de l’immatérialité des informations venues de loin. Les murmures sur la fermeture de l’Université s’engouffrent dans les couloirs avec la brise fraiche du début de printemps. J’entends les mots, je les échange sur le ton de la discussion. Mais comme beaucoup d’entre nous, je ne les comprends pas. Pas vraiment.
Jour 0, vous avez reçu un nouveau mail de la TaskForce.
On s’y attendait. Et puis un soir. Ça y est. C’est là. On ne sait pas vraiment encore quoi, mais c’est là cette fois. Il va falloir rester là. Enfin, ici. Chez soi.
Jour 4, à deux mètres, s’il vous plait.
Pendant plusieurs jours, je lis frénétiquement tout ce que mon algorithme me propose sur le sujet. Je comprends ce qui est mis en avant, les interdits, le danger potentiel, les « fragiles ». Pourtant, le lendemain, je ne sais pas encore vraiment comment me comporter pour aller faire les courses. Ce nouveau savoir n’est pas incorporé. Il me faut désapprendre. Réapprendre. Mon corps est indiscipliné, il ne connait ni les gestes barrières, ni le désinfectant. Il va devoir s’adapter. Éviter les autres. Se laver les mains, beaucoup. Sursauter, lorsque quelqu’un se racle la gorge un peu trop bruyamment. Échanger des regards entendus. Des petites blagues dans les files d’attentes. Pour tromper les solitudes naissantes, le vide qui envahit les existences et le désœuvrement de ne plus avoir de repères sociaux, de ne plus savoir comment être ensemble. À deux mètres les un-e-s des autres.
Jour 7, réinventer des mondes.
Les appels fusent. Les projets, les conférences, les réunions, les colloques tombent, les un-e-s après les autres. Il va falloir rester chez soi. Un bon bout de temps. Il va falloir réinventer son monde. Sans la présence des autres. Il va falloir faire preuve de réactivité, se familiariser avec les plateformes de travail à distance. S’habituer à ne plus se voir qu’à travers un écran, organiser ses journées sans déplacements, sans interactions. Les délais s’allongent, les coups de pression diminuent. Le travail se réorganise, plus calmement. Oui, plus personne ne peut être aussi rapide qu’avant, le régime de la performance baisserait-il d’un ton ?
Jour 11, déchiffre des chiffres.
Rien d’autre ne se passe dans l’information, dans les conversations. Que ça. Que lui. Les chiffres continuent de tomber, des statistiques à ne plus savoir où les ranger. À ne plus savoir sous quel angle les analyser ni comment les interpréter. Une multitude de graphiques faits à l’emporte-pièce, remplis de couleurs, de traits, de courbes, qui appuient des discours rapides, des discours qui savent encore si peu. Mais le monde a besoin de réponses à toutes ces questions encore balbutiantes.
D’ailleurs, le voisin d’en face l’a eu. Il a dû s’isoler deux bonnes semaines. Heureusement, il va mieux.
Jour 14, le disparu reparait.
En ville, c’est du jamais-vu pour un vendredi midi, les ruelles sont presque désertes. Les vrombissements des moteurs se sont tus. Cette fois-ci, le monde des pressés s’est arrêté. Çà et là quelques silhouettes encore emmitouflées déambulent seules en silence. Les pas se font somptueusement nonchalants lorsque l’empressement n’a plus lieu d’être, lorsque personne ne doit plus se rendre nulle part.
Sur la petite place, une vingtaine de cerisiers se sont drapés de leur manteau rose, encouragés par les rayons du soleil. Les fleurs embaument un air que plus grand monde ne peut respirer, derrière son masque. À l’ombre des arbres, au cœur de cette atmosphère si particulière, les battements d’ailes de milliers d’abeilles, affairées à gouter les premières lueurs du printemps, animent la ville. Leur chant caresse l’atmosphère. La transfigure. Ce qui avait disparu dans le brouhaha, reparait. Et si, derrière le drame, il y avait quelque chose à comprendre de ce système, quelque chose qui, comme les abeilles, avait toujours été là, mais que plus personne n’avait le loisir d’écouter ? Et si, prendre le temps permettait aussi de mieux penser, de mieux réfléchir ? De faire de la recherche plus qualitative.
Jour 17, l’absence de nous.
Les jours se suivent et se confondent lorsqu’ils ne sont plus rythmés par les interactions. Les gens manquent. Leurs bises trop brusques, leurs poignées de mains moites. Je pense à celles et ceux qui mastiquent bruyamment au cinéma, qui étalent leur tracas au téléphone dans les wagons bondés, qui bousculent sans s’excuser. Oui ces personnes-là aussi. Elles me manquent. Dans leur présence, dans leur corporalité. Je ressens l’absence, cette absence d’un nous. Un nous que je ne saurais définir. L’inverse du seulement moi. Ce seulement moi qui n’a de cesse d’être là, devant le bureau. Là, dans le lit. Là, sur le fauteuil. Là et là, toujours aux mêmes endroits, ces endroits qui sont habités par la carence de sensation des autres. Par le manque d’être parmi les autres.
Jour 21, tout s’est arrêté, et pourtant tout continue.
Ma cadence cardiaque apprécie ce nouveau rythme de travail imposé. Ça ne l’empêche pas de travailler, de lire, de marcher, au contraire. Je repense à l’avant. À la frénésie. Au train de 7h26, au colloque de 8h15, aux mails à envoyer avant onze heures, aux articles qui ne s’écrivent pas assez vite, aux lectures qu’on n’a pas le temps de terminer, aux après-midi qui s’enchainent sans avoir eu le temps d’exister, au multi-tasking continuel, aux regards épuisés de certain-e-s collègues, aux arrêts de travail pour surmenage des autres, aux courses à faire vite avant la fermeture, au train qui a pris trois minutes de retard, zut, la correspondance n’attendra pas. Je n’aurais pas le temps de… Pas le temps. Jamais vraiment le temps. Je repense à ce marathon intérieur. Effréné. Celui qui doit, chaque jour, nous amener à un demain plus productif, plus optimisé, plus publié.
À présent que tout semble s’être arrêté, l’essentiel continue d’exister. Différemment. Avec les moyens du bord. Qui induisent de l’indulgence mutuelle. De la créativité aussi. Et de l’espace. De l’espace pour organiser ses réflexions, ses pensées.
Jour 26, existences recomposées.
Les voisins donnent les cours à leurs enfants de 7 ans et 9 ans. Elle travaille encore en présentielle, à temps partiel. Lui, en télétravail. L’école à la maison est pliée en deux heures, le reste du temps, les enfants jouent, bricolent. Ça n’est pas si évident, non, mais le stress n’est plus le même. La famille fait chaque jour un tour à vélo ou une randonnée. Les enfants aident à jardiner, à cuisiner. Il y a de nouveau espaces, de nouvelles temporalités. J’aime parce que Papa est souvent là, me confie Maxime. Il ajoute qu’il n’a pas hâte de retourner à l’école. Enfin si, mais seulement pour les copains.
Jour 32, il creuse.
Le virus creuse. C’est vrai. Ils creusent les précarités, les inégalités. Toutes les inégalités. Certains parents croulent sous la tâche, les pathologies mènent la vie dure aux co-confiné-e-s, des personnes de tous âges se retrouvent isolées, démunies. Les faibles revenus, les indépendant-e-s, les artistes tirent la langue. Les écarts, déjà existants, se creusent. Et la vulnérabilité de ce modèle économique ressurgit, lorsqu’on l’oubliait presque. Alors, si l’avant fut le terreau fertile de l’émergence de tant de vulnérabilités individuelles et structurelles, pourquoi ne pas réfléchir à un après ? Un vrai après. Pas un après exactement comme avant.
Jour 40, bilan intermédiaire d’une frénésie avortée.
Et si, sans frénésie, ce monde pouvait fonctionner non pas tout aussi bien, mais encore mieux ? Et si, la recherche – au même titre que l’apprentissage, l’humour, la vie familiale, la vie professionnelle – pouvait s’épanouir dans la nonchalance des démarches moins empressées ? Des réflexions qui ne doivent plus courir pour se rendre, toujours vite, quelque part. Surtout là où c’est rentable.
Et si, au-delà des angoisses, des peurs, des incertitudes, le confinement ouvrait la voie des possibles qui ne pouvaient être auparavant qu’imaginés ? La voie de codes nouveaux, qui ne souscrivent pas aux au facteur d’impact, au publish or perish. Et si, cette expérience pointait, malgré tout, qu’il est d’autres manières d’être, de faire, d’envisager, de performer la recherche ? Des possibles moins frénétiques, moins tournés vers toujours plus de contenu, toujours plus de publications, toujours plus vite.
Et si, nous les envisagions, si nous les réinventions ? Ensemble.
Léone Ruiz est chercheuse doctorante à la Maison d’Analyse des Processus Sociaux (MAPS) à l’Université de Neuchâtel. Elle s’est intéressée aux pratiques et aux processus d’engagement et de désengagement des bénévoles dans le cadre du soutien aux réfugié-e-s statutaires en Suisse. Actuellement, elle travaille sur les pratiques et les processus mis en place par les acteur-trice-s (bénévoles, désobéissant-e-s) qui soutiennent les trajectoires des personnes migrantes, particulièrement après les passages de frontières irréguliers au sein de l’Union européenne.