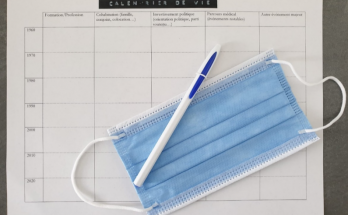Expériences de la pandémie
De mars à mai 2021, entre confinement et enseignements à distance, une classe de master de l’UNIL en sociologie de la médecine et de la santé a mené onze enquêtes au plus près du quotidien d’une variété de métiers, de communautés, de milieux. Les paroles recueillies composent la trame d’expériences partagées et de vécus intimes des événements, une lecture plurielle de leurs existences au cœur de la pandémie.
Une enquête de Matilda Bianchetti et Marie Reynard
Dans le cadre exceptionnel de la pandémie de Covid-19, nous avons souhaité donner la parole à des acteurs particuliers de la société : les représentant·e·s religieux·euses. Leurs témoignages nous semblent intéressants car ils et elles sont à la fois les guides religieux et spirituels d’une grande partie de la population, mais également les réceptacles privilégiés de ses souffrances. Par Zoom ou en personne nous avons pu rencontrer quatre d’entre eux : Lina, pasteure ; David, rabbin ; ainsi que Jean et Marc, tous deux abbés.
C’est un métier communautaire – Pasteure Lina
Lorsque nous discutons avec les représentant·e·s religieux·euses de leur quotidien, nous sommes frappées par la profonde humanité de leurs activités, par ailleurs très variées. En fait, moi la pandémie m’a vraiment fait mesurer combien c’est un métier communautaire, nous confie la pasteure Lina. La pasteure Lina, les abbés Marc et Jean et le rabbin David y sont tous et toute confronté·e·s quotidiennement avec les membres de leur communauté respective, par leur position unique, que chacun·e s’attache à nous expliquer avec force métaphores, comme l’abbé Marc : Je suis un peu le berger à la manière du pape François, c’est-à-dire que, de temps en temps, je suis devant et prends quelques décisions pour faire que les gens gagnent en spiritualité, avancent dans leur recherche de sens ; de temps en temps, je suis en plein milieu du troupeau, parce que je dois juste écouter les gens ; et de temps en temps, je suis tout derrière, parce que je dois aller au rythme du plus lent. Le rabbin David évoque avec humour une autre métaphore – à vrai dire je n’ai pas changé de profession, puisque autrefois je m’occupais de chimie organique, et qu’aujourd’hui je m’occupe de chimie humaine, tout simplement. Tou·te·s quatre sont en contact constant avec d’autres personnes dans leur quotidien. Leurs expériences de la pandémie sont à la mesure de leur forte implication dans la communauté. Lina s’occupe d’une paroisse de village, tout comme Marc. Tous deux se décrivent comme généralistes : en temps normal, il et elle donnent le culte hebdomadaire, enseignent le catéchisme, réalisent des rituels (baptêmes, mariages, enterrements). L’abbé Jean se définit comme curé modérateur. En plus de ces mêmes activités usuelles, il modère une équipe de 10 personnes, hommes et femmes, qui rayonne sur une unité pastorale. Enfin, le rabbin David est le grand rabbin de la Communauté israélite d’une ville Suisse dont il prend soin : Nous disposons de trois synagogues, d’un jardin d’enfants, d’un restaurant, d’une bibliothèque, ainsi que d’un rabbinat. La pasteure Lina est mariée et mère de quatre enfants. Le rabbin David, marié, a également quatre enfants, ainsi que trois petits-enfants. Leur activité religieuse occupe une place très forte dans la vie. L’abbé Jean par exemple, s’exprime à travers de multiples références à la foi : « Quand j’aurai été élevé de terre » dit Jésus « j’attirerai tout à moi », enfin tous les hommes, toutes les âmes ; c’est beau ! Et l’abbé Marc consacre tout son temps à sa vocation – il y a un temps de prière le matin et puis la journée va de 6h45 jusqu’à 22h30.
Tous les cultes, tout, tout, tout, tout s’est arrêté – Pasteure Lina
Dans ce quotidien bien rodé, l’arrivée du Covid en Suisse marque une rupture. L’abbé Marc nous avoue : On a été pris de surprise, de devoir arrêter tout, vu qu’il n’y a plus de rencontres, de réunions, de célébrations. On est passé à la solitude tout d’un coup. Puis après, il y a eu beaucoup de contaminations, notamment sur notre commune, et beaucoup de tristesse surtout. De la même manière, c’est avec ses mots à lui que l’abbé Jean raconte comment la pandémie a un petit peu grippé la machine : hors pandémie, il y a facilement 1500 fidèles le dimanche ; c’était beau à voir, quoi. La pandémie a alors affecté leur vie pastorale et spirituelle. Si Jean nous parle des trois vagues successives qui ont eu lieu, pour lui, il y en a encore d’autres sans doute qui vont arriver. Ces vagues justement, la pasteure Lina les distingue : je voudrais faire vraiment la différence entre la première vague et les deuxième et troisième vagues. Elle nous explique que le moment de la première vague est arrivé dans une période où normalement sont célébrées les confirmations. Dans son église, cela correspond normalement à des réunions de 240 personnes qui réunissent notamment les grands-parents. Cette situation de pandémie, ça a été une première ; ça a été stoppé net ; et quand on a voulu le revivre, il y a eu la deuxième vague, déplore Lina. Ses souvenirs sont intacts : c’était un 13 mars ; tous les cultes, tout, tout, tout, tout s’est arrêté. L’expérience du début de pandémie est semblable pour le rabbin David. Lui aussi se remémore avec précision l’arrivée du Covid : l’année passée, fin février, début mars ; dès que les autorités cantonales et communales ont pris leurs décisions, je me rappelle que le président de la communauté a fait le tour de toutes les synagogues pour leur dire que « Samedi matin, toutes doivent être fermées ». De manière absolument inédite, une « taskforce » qui comprenait deux médecins, le président de la communauté, le vice-président de la communauté, deux autres membres du comité, plus le secrétaire général, et bien entendu [le rabbin David] a été composée pour gérer au mieux les effets de la pandémie sur la communauté israélite dont ils ont la charge.
Cette pandémie marque également une autre rupture, celle avec les habitudes religieuses et spirituelles, parce que pour les gens, vous savez, d’être arrachés à des habitudes, comme entendre les cloches, cela a été un véritable choc, nous dit Lina. Pour pallier cela, elle raconte avec fierté que toutes les communes ont été d’accord de sonner les cloches, alors qu’il n’y avait pas de culte. Selon elle, de manière symbolique, cela faisait écho à des rites, des occasions de se voir, quelque chose qui accompagnait ce canton depuis des centaines d’années. Après la subite fermeture des lieux religieux, l’abbé Jean se souvient : la première vague, on nous a donné l’ordre de fermer toutes nos églises ; c’était l’État de Vaud qui avait reçu des directives du Conseil fédéral, mais il les avait interprétées de manière trop stricte dans le canton. Levant le doigt vers le plafond, il nous indique son appartement, précisément son studio, comme il le qualifie lui-même. Depuis sa fenêtre qui donne sur la rue, nous dit-il en se replongeant dans ses souvenirs, je vois ce qui se passe, et je voyais des hommes, des femmes à genoux, pleurant devant les portes fermées ; ça m’a vraiment fait saigner le cœur. Face à cette souffrance, injustement produite selon Jean, il réagit : alors j’ai téléphoné à nos autorités, qui ont appelé le Conseil d’État, qui a permis ensuite que l’on réouvre dans les 48 heures. Dès lors, s’il a été possible de ré-ouvrir, cela s’est fait selon les obligations sanitaires en vigueur. Au-delà des règles établies du port du masque et de désinfection des mains, l’abbé Marc, comme nous tous et toutes, appréhendait également les nouvelles informations transmises par le Conseil Fédéral durant ses conférences de presse quasi-quotidiennes. Aux questions que faire pour un enterrement, que faire avec des catéchèses ? par exemple, il trouvait réponse dans les directives transmises au diocèse, traduites et adaptées pour les églises, que chaque paroisse du canton recevait. Lina elle aussi a été briefée tout le temps. Avec les nouvelles directives, elle se demandait, qu’est-ce qui était possible, qu’est-ce qui n’était pas possible ? Finalement, nous dit-elle, c’est comme pour tous les métiers. Face à des restrictions grandissantes, le rabbin David assure et rassure : nous avons respecté à la lettre toutes les décisions prises par les autorités communales ou cantonales ; on n’a pas lésiné sur les moyens ; ce que nous avons fait, c’était toujours dans le cadre de la loi.
On a réalisé qu’on avait des ressources et puis qu’on pouvait changer – Abbé Marc
Chacun·e de nos interlocuteurs et interlocutrice retrace avec nous les moyens qu’ils et elle ont investis pour se réinventer en temps de Covid. Depuis la réouverture, l’abbé Jean décrit la participation de nombreux bénévoles qui accueillent les gens : on ne veut pas les refouler en fermant la porte à clé, simplement ; donc ils leur donnent à l’extérieur des cadeaux, ils partent avec une petite nourriture ; et ceux qui font le choix d’attendre dehors, au froid, toute la messe, et bien nous les prêtres, à la sortie, on va leur donner la communion. Il simplifie ainsi la communion pour la rendre Covid-friendly : pour les gens qui venaient se confesser en temps de pandémie, j’avais sur moi plusieurs hosties, et je leur donnais la communion à l’extérieur. L’abbé Marc se souvient de ce que représentait comme charge de travail de tout re-calibrer. Pour lui, ça a été compliqué et très fatigant, avec les directives qui changeaient tout le temps. A contrario, l’événement pandémique a aussi son lot d’aspects positifs. Marc souligne notamment que cela a apporté beaucoup de créativité et des trucs géniaux ; on a réalisé qu’on avait des ressources, et puis qu’on pouvait changer. N’ayant pas été, selon lui, la paroisse la plus 2.0, son Église décide tout de même de sonder par e-mail les membres de la communauté catholique, en les ciblant à travers la création de groupes thématiques : on a fait des trucs plus personnalisés, en plus petit noyau, et les gens ont beaucoup apprécié. Pour leur part, Lina et ses collègues ont lancé une newsletter qui, avec le site Internet de la paroisse, sont devenus les modes de communication principaux. Elle s’empresse de nous annoncer avoir DIRECTEMENT commencé à faire des audios, à mettre nos cultes sur le site, même des morceaux d’orgue, des cantiques, tout un déroulement de culte avec des audios ; on s’est vachement secoué ! Lina nous confie également avoir pris l’initiative personnelle de créer une série, comme des fondamentaux, ou une sorte dekit de survie religieux et spirituel.
Pour beaucoup de ces professionnel·le·s qui se confient, la situation liée au Covid marque comme pour beaucoup le début d’un basculement vers des rencontres en priorité en distanciel. La pasteure Lina explique comment son quotidien a viré à Zoom, Zoom et re-Zoom. Pareillement pour David, tout se passait par Zoom ; donc on a fait nos prières quotidiennes via le Zoom. Le grand rabbin relève également que l’usage des réseaux sociaux tel Instagram a connu une forte demande de la part de nos membres. Cependant, face aux autres traditions rencontrées durant nos échanges, la spécificité du judaïsme fait que l’utilisation de tout appareil électronique est interdite le jour du Shabbat, autorisant ainsi son usage uniquement les autres jours de la semaine.
Au-delà de ces innovations de spiritualité assistée par les technologies, la période du Covid a aussi permis à Lina, Marc, et David de s’essayer à de nouvelles expériences riches en émotions, notamment à Pâques. Marc raconte : Traverser Pâques en rassemblant zéro personne dans une église, c’était vraiment une chose contre-nature, et il ajoute : on a fait des choses sur Facebook ; moi j’ai fait un grand message filmé pour toute la population. Le même jour de Pâques, Lina nous révèle s’être levée à 5h30 du matin et s’être rendue au cimetière local– c’est vraiment un endroit presque un peu ancestral et symbolique de Pâques, qui parle de la mort et de la résurrection, donc qui touche un peu à tout ce que les personnes peuvent vivre comme deuil en lien notamment avec le Covid ; j’ai filmé le lever de soleil sur les Alpes et puis j’y ai prononcé ce que nous prononçons chaque année à Pâques : « Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité ». Je crois que cette marche que j’ai vécue ce matin-là, c’est quelque chose que je n’oublierai pas de sitôt ! L’événement de la Pâques juive résonne aussi pour le rabbin David qui raconte : Grâce à notre secrétaire générale, on a fait un travail colossal ; parce que la fête de la Pâques juive est très complexe ; les exigences de l’alimentation sont plus strictes que d’habitude ; on a même organisé des repas pour les nécessiteux qu’on a livrés jusqu’à domicile pour ne pas propager le virus.
Le contact humain est très important mais ce contact là nous faisait défaut – Rabbin David
Chacun d’elle et eux, au travers de la providentialité de leur métier, a fonctionné comme une espèce de caisse de résonance pour des expériences de souffrances, de limites, comme nous le raconte la pasteure Lina. Elle a été marquée par les récits des gens qui ne pouvaient pas voir leur maman ou des personnes qui ont des troubles de la mémoire et qui sont déjà désorientées ; c’était dur… De son côté, l’abbé Marc, en lien avec le CMS, nous confie avoir eu plus de demandes qu’auparavant pour les fins de mois. Le rabbin David, durant cette période, a aussi découvert comment, malheureusement, cela a affecté la communauté : Dans le cadre de la paix au sein du couple, ça a affecté quelques familles. Marc relève aussi la montée de la violence au sein des foyers : j’ai écouté quelques familles et c’était vraiment nerveusement tendu, voir physiquement violent ; ça pouvait même cogner un peu. En particulier, ce sont les personnes âgées qui semblent toutes et tous les préoccuper. Lina a été très en souci pour les personnes âgées ! Il y a des collègues qui ont fait beaucoup de téléphones. L’abbé Jean lui aussi était soucieux : on a une cuisinière, Maria, qui est une sainte personne ; et elle est une personne à risque, donc la crainte c’était de lui transmettre le virus ; une autre crainte c’était de transmettre le virus sans que je le sache, à des personnes âgées, parce que j’ai appris que des personnes âgées l’ont attrapé parfois par un prêtre qui avait célébré, puis tout d’un coup, le Monsieur est mort. Le plus dur pour lui a été la question des enterrements. Il y avait le strict minimum permis par la loi, explique David, on était juste cinq personnes ; on a pris les parents les plus proches, plus le rabbin, le ministre officiant, et voilà tout. Pour Lina, le plus douloureux, c’est quand vous n’aviez que le mari et les trois enfants ; c’était tout ! L’abbé Marc se sent quant à lui concerné par l’impact à long terme de ce type d’enterrement : ce sont vraiment des deuils psychologiquement qui sont très mal faits, à tout jamais. Pour illuminer ce triste tableau, l’abbé Jean raconte rendre honneur à la vie des défunt·e·s, même seul : parfois, des enterrements où il n’y a que le défunt et le prêtre, c’est les plus beaux. Il espère cependant que pour celles et ceux qui n’ont pas pu faire leurs adieux en raison de la jauge fixée à cinq personnes, on fera une célébration nationale d’adieux à nos chers défunts ; je dis bien « à Dieu », ça veut dire qu’on les a remis à Dieu : au revoir, on les reverra. La mort, il la côtoie au quotidien et face à face avec le Covid, il se dit à lui-même : « Si c’est l’heure, c’est l’heure » ; me donnant à Dieu, il se donne à moi aussi ; alors je n’ai pas peur de la mort ; puis le jour où le Seigneur vient nous cherche : Alléluia ! Pour Lina, mourir, on le peut chaque jour ; et dans mon métier, ça, on le sait, que la mort, elle n’a pas attendu le Covid ! L’abbé Marc n’avait lui non plus pas peur pour lui-même : Moi, j’avais le souci de mes parents, puis de mon frère, mes neveux, nièces, et de mes filleuls.
Finalement, c’est surtout l’absence du contact humain qui s’est fortement fait sentir. Écoutez, nous demande le rabbin,je ne cache pas que les personnes qui avaient besoin de nous sont venues chez moi, à la maison, toujours dans le cadre du respect des mesures. Il ajoute comme pour être clair : écoutez, il y a quelque chose de primordial dans le judaïsme, c’est la grande importance que nous accordons à la vie ; elle est au-dessus de tous les interdits, c’est la raison pour laquelle nous avons tout fermé. Ici, nous confesse l’abbé Jean, c’est un ministère de réconciliation ; comme tout le monde était invité à faire du télétravail, et que nous, nous confessions les gens en présentiel, et bien moi, je me disais, mais c’est peut-être bientôt la fin ; mais c’était aussi beau de se dire : « Si c’est la fin, on va être trouvé en tenue de service. On sera mort dans l’accomplissement de notre devoir ».
Dieu ne te veut pas de mal, Dieu ne fait que nous aimer – Abbé Jean
Dans un article du 14 novembre 2020, un journal local titrait « Le silence des Églises face à ce qui se passe est inquiétant », comme un renvoi à l’époque du Moyen-Âge où, selon l’historien Michel Grandjean, « les ecclésiastiques jouent un rôle prépondérant, parce que ce sont eux qui peuvent donner du sens [à la crise] ». Ce sens est souvent celui de la punition divine, comme le rappelle la pasteure Lina : Peut-être qu’il y a 100 ans, les églises auraient eu un message d’autorité qui aurait été « Dieu nous punit » ou « Dieu ceci, Dieu cela » ; il y aurait eu des espèces de déclarations un peu massives pour donner un sens à tout ça. Mais alors, comment les représentant·e·s religieux aujourd’hui interprètent-ils l’événement du Covid-19, et s’agit-il de lui donner un sens religieux ? S’il est un point sur lequel ils et elle s’accordent, c’est que Dieu n’a pas envoyé la pandémie, comme un énième fléau. L’abbé Marc l’affirme avec conviction : Si vous dites que c’est une punition de Dieu, je dis non tout de suite ! Selon lui, le rôle de Dieu n’est pas de punir : J’ai trouvé que Dieu était trop génial, il a été inspirant tout le long! On s’est dépassé comme jamais dans la charité, dans le souci de l’autre, moi je trouve que c’est génial ; je trouve que Dieu a été très inspirant pour moi qui croit en lui, et pour rien au monde je ne serais fâché avec lui durant cette pandémie. La pasteure Lina se refuse également à une interprétation de la pandémie comme fléau divin. En réponse à l’article de ce journal, elle s’insurge : Notre message ne se fanfaronne pas ! Peut-être qu’en situation de crise une religion nuancée c’est moins pratique, mais on a fait des tas de choses au service des gens ; ce ne sont pas des déclarations tonitruantes. La pasteure ne conçoit pas son rôle comme celui d’une autorité face à la société, mais vraiment comme celui d’un soutien à la communauté. Je ne me permettrais pas de dire ni que Dieu a voulu cette maladie, ni que ça n’a rien à voir avec lui, c’est pourquoi dit-elle s’être plutôt concentrée sur le service à la personne. Le rabbin David quant à lui, médite sur la pandémie. Pour lui, rien n’est dû au hasard, lequel n’existe pas pour l’homme de religion ; le mot hasard en hébreux se dit miqreh, composé de quatre lettres, mais dans ces quatre lettres, il y a deux lettres intermédiaires « rac » qui signifie « seulement », et « meashem » qui signifie « de Dieu » ; donc je ne peux pas attribuer cela au hasard ; bien entendu, Dieu a son message ; quel est-il ? Je laisse à tout un chacun de répondre à cette question. L’abbé Jean est pour sa part profondément ancré dans la tradition chrétienne et donne une interprétation rédemptrice de la pandémie : C’est une épreuve ; on ne peut pas dire que Dieu a envoyé ceci ; Dieu ne te veut pas de mal ; Dieu ne fait que nous aimer, mais il l’a au moins permise ; Je lie ceci, cette souffrance qui est mienne, en lien avec la pandémie, à la croix du Christ pour la Rédemption du monde. Selon lui, cette pandémie s’inscrit dans un plan divin plus large : J’aspire à un renouveau du monde entier ; je pense que ça va se faire, mais dans les douleurs de l’enfantement ; et une pandémie, c’est une douleur ; et il y en aura peut-être d’autre, je le crains.
Par notre corps, on fait partie du corps communautaire humain – Pasteure Lina
Ces diverses interprétations nous font réfléchir, et nous sommes finalement plutôt surprises de constater que même à l’intérieur d’une même religion, les discours sont nuancés. Si les personnes rencontrées nous ont confié le sens religieux qu’ils et elle donnent à la pandémie, nous abordons maintenant leur point de vue personnel. Les abbés Marc et Jean, ainsi que la pasteure Lina valorisent une prise de conscience vis-à-vis de la société de consommation matérialiste dans laquelle nous vivons : Mais moi mon truc ça se résume en une expression : « Enlever le mot “courant”, il faut marcher ». Le problème, c’est qu’il y a la volonté de revenir aux affaires courantes, mais c’est le mot « courant » qui est affreux ; la société a été ralentie, mais les gens aspirent au retour des affaires courantes ? Pourquoi donc ?, s’interroge aussi l’abbé Marc. Pour l’abbé Jean, il s’agit d’une opportunité pour se détacher des biens matériels qui nous emprisonnent ; c’est dur, mais les épreuves m’ont aidé à me détacher. La pasteure Lina renchérit avec force : C’est pas possible de vivre dans une société où seuls quelques privilégiés peuvent s’en sortir, non ! Il faut cette recherche de « Comment est-ce que je contribue au bien de tous, ou pas ? ». Finalement, les représentant·e·s religieux·euses perçoivent le renforcement des liens sociaux comme LE point positif lié à la pandémie. L’abbé Marc ne cesse de rappeler la grande solidarité en place dans sa commune, qui s’est encore affirmée avec la pandémie : c’était impressionnant combien cette période a été favorable! Parce que nous, on demande aux gens de se reconnecter ; la religion c’est plutôt la relation à Dieu, mais aussi la relation à soi, relation aux autres, relation à la nature. Il nous raconte en souriant : Ici c’est une paroisse où tout le monde se soucie quand même les uns des autres, donc j’ai eu des gâteaux aux abricots qui sont arrivés devant la porte ; les gens ont beaucoup d’attention. La pasteure Lina dit avoir redécouvert non seulement le corps physique, avec la maladie, mais également le corps communautaire et l’importance du lien social, – de tout un coup se rendre compte que par notre corps, on fait partie du corps communautaire humain, c’était comme un frein à l’individualisme ! Cette maladie nous a ramené à la réalité du corps communautaire. Même ressenti pour le rabbin David, qui rappelle que nous avons tous été créés à l’image de Dieu ; le premier homme n’a pas été créé juif, ni musulman, ni chrétien, ni hindou, c’est un être divin qu’il faut respecter ; il faut donc porter grande attention à la dignité humaine.
Nos rencontres avec la pasteure Lina, le rabbin David et les abbés Marc et Jean nous ont beaucoup touchées. Par leurs discours – remplis de bienveillance et valorisant la solidarité comme valeur centrale de la religion quelle qu’elle soit – ils et elle ont su transmettre un message de paix et d’amour dans un contexte difficile. Nous les remercions pour leur temps et leurs paroles.

De mars à mai 2021, entre confinement et enseignements à distance, une classe de master de l’UNIL en sociologie de la médecine et de la santé a mené onze enquêtes au plus près du quotidien d’une variété de métiers, de communautés, de milieux. Les paroles recueillies composent la trame d’expériences partagées et de vécus intimes des événements, une lecture plurielle de leurs existences au cœur de la pandémie.
Un projet accompagné par Francesco Panese et Noëllie Genre.