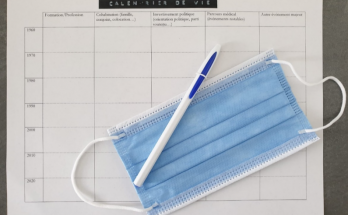Expériences de la pandémie
Lors du cours-séminaire « Sciences sociales de la médecine et de la santé » qui s’est déroulé en 2022/23 à l’UNIL sous la houlette de Laetitia Della Bianca, Céline Mavrot et Francesco Panese, une classe de master de l’UNIL en sociologie de la médecine et de la santé a mené des enquêtes au plus près du quotidien d’une variété de métiers, de communautés, de milieux autour de la thématique cruciale des vaccins. Les paroles recueillies et/ou les problématiques abordées composent la trame d’expériences partagées et/ou de vécus intimes en lien avec cette problématique.
Par Julie Fiedler et Emilie Vuilleumier
“On appelait ça “la vaccination des sans-papiers”. Il n’y en a aucun qui est venu sans papiers ! Ils ont tous des papiers ! Ils sont tous venus avec leurs papiers. (rire) Donc voilà, on était prêts à enregistrer des numéros, c’était ce qu’on leur avait dit. Mais en fait, ils n’avaient pas de problème, donc ils sont tous arrivés avec leurs papiers.”
Responsable médical de la campagne de vaccination (VD)
Dans le papier précédent, nous avons décrit les dispositifs mis en place à Lausanne au printemps 2021 pour la vaccination des personnes sans assurance maladie dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. Nous avons vu quels publics ils visaient et quelles mesures avaient été prises en conséquence. Confrontons à présent les catégories de personnes pensées en amont par les autorités sanitaires et celles qui ont été effectivement observées au centre de vaccination d’Unisanté. Nous verrons que cela nous mènera à un bilan plus nuancé de cette “vaccination des sans-papiers”.
Des “sans-papiers” avec papiers et assurance maladie
Une première observation consiste dans le fait que beaucoup de personnes dites “sans-papiers” sont venues avec des papiers (de leur pays d’origine) et n’ont eu aucun problème à les présenter. Les personnes ne sont en réalité pas “sans-papiers” mais sans statut légal en Suisse ou dépourvues des “bons” papiers. L’enjeu dans l’accès à la vaccination et de manière générale n’est pas de ne “pas avoir de papiers” mais justement d’avoir des papiers qui font porter un risque permanent (incarcération et/ou expulsion) à ceux et celles qui les détiennent. Par ailleurs, si la motivation des personnes était l’obtention du certificat COVID, alors elles étaient contraintes de fournir une identité et donc de venir avec des papiers.
Aussi, certaines personnes sans-papiers s’étant présentées au Centre disposaient d’une assurance maladie et auraient de ce fait pu se rendre également dans les centres classiques de vaccination. Pourquoi dans ce cas se sont-elles rendues au Centre d’Unisanté ? Il se peut que l’anonymat qui y était garanti les aient rassurées, mais il est également probable que d’autres personnes de leur communauté les y aient orientées.
Des personnes ne résidant pas en Suisse
Une seconde observation porte sur le fait que des personnes ne résidant pas en Suisse se sont présentées au Centre, parmi lesquelles des personnes suisses vivant à l’étranger sans assurance maladie helvétique :
“Il y a eu aussi quelques personnes suisses qui vivent à l’étranger pour des questions économiques, en Asie, en France ou comme ça. Et tout d’un coup, ces gens ont entendu, par le biais peut-être de connaissances, qu’ils pouvaient se faire vacciner même sans avoir d’assurance en Suisse et sont revenus pour se faire vacciner.”
Infirmière à Unisanté
Des touristes ont également sollicité les services de la vaccination d’Unisanté :
“En fait, il y a des gens, des touristes qui sont venus ! Des Russes (rire) qui sont venus se faire vacciner ici. Mais ma foi, de toute façon, on a plein de fric et assez de vaccins, donc c’était pas ça la question. (…) Au début, on a dit : « bon, s’ils restent plus d’un mois, on les vaccine. » Parce qu’on n’avait pas beaucoup de vaccins et puis c’étaient des personnes âgées. Ce sont souvent des parents qui viennent voir leurs enfants. Donc c’est raisonnable de les vacciner aussi de toute façon. Donc on a très rapidement ouvert ça à des gens qui ne résidaient pas en Suisse.”
Responsable médical de la campagne de vaccination (VD)
Relevons ici une distinction opérée dans cette citation entre les personnes “sans-papiers” et les “touristes”. Ces deux catégories ont en commun leur origine étrangère mais elles se distinguent par leur statut (illégal pour les premières, légal pour les secondes) et leur classe sociale. C’est justement parce que les personnes au statut de touriste — dont tout le monde ne peut jouir — n’étaient pas celles qui étaient à priori attendues au Centre d’Unisanté que le responsable médical de la campagne de vaccination souligne cette particularité. Les personnes détenant les “bons” papiers — et donc pas nécessairement suisses — n’ont pas été comprises par les autorités comme des populations vulnérables face à l’accès aux systèmes de santé. Pourtant, comme nous le verrons, les personnes au statut de touriste ne viennent pas toutes pour les mêmes raisons. Si certaines visitent la Suisse, d’autres utilisent ce statut pour travailler au noir et certains·es “touristes” se trouvent également en situation précaire.
Une troisième observation relève du fait que la vaccination a bien fonctionné pour certaines catégories de personnes et moins pour d’autres au sein des personnes issues de la migration.
Un intérêt relatif selon l’origine des communautés
Relevons ici que tout au long de leur description des événements, toutes les personnes interviewées subdivisent la catégorie “sans-papiers” en sous-catégories relevant de leur origine géographique. On nous apprend que dès l’ouverture du centre, les personnes d’Asie, plus spécifiquement de Chine, et celles venues d’Amérique du Sud se sont présentées en masse. Par contre, les personnes originaires d’Afrique subsaharienne ne sont pas venues, ou plus tardivement. Les professionnels·les interviewés·es présentent à ce propos diverses explications.
L’intérêt des populations serait à mettre en lien avec la situation épidémiologique dans leur pays d’origine. Cela expliquerait la venue immédiate des communautés sud-américaines :
“Très rapidement, donc dans les premiers jours, il y a tous les Sud-Américains qui sont venus. Pourquoi ? Parce que le COVID en Amérique du Sud, au Brésil notamment, faisait plus de dégâts. Enfin, c’est comme ça qu’on l’explique. Parce que ce n’est pas forcément ceux qu’on voit le plus chez nous dans notre consultation.”
Responsable médical de la campagne de vaccination (VD)
Inversement, cela impliquerait que les populations originaires d’Afrique subsaharienne se soient senties peu concernées par le virus, leurs pays ayant été peu touchés par l’épidémie. Cette exception africaine s’expliquerait notamment par le jeune âge de la population, le fait qu’elle ait été préalablement « immunisée » par un environnement spécifique et l’arrivée tardive du virus sur ce continent (Heikel 2021, p.167-168).
À propos des personnes originaires d’Afrique subsaharienne, plusieurs professionnel·le·s interrogé·e·s mentionnent une certaine méfiance envers les autorités ou envers les vaccins de manière générale :
« (…) très peu d’Africains au début, très très peu, à se demander pourquoi. Et il y aurait peut-être plusieurs hypothèses là-derrière. De méfiance des vaccins, de non-connaissance, de méfiance qu’ils soient dénoncés à la police. »
Infirmière à Unisanté
« (…) il n’y avait aucun Africain. Aucun Africain. Donc en fait, de nouveau, il y avait eu un message dans la communauté africaine que « c’est des vaccins de Blancs ». Je connais ça parce que je bosse beaucoup en Afrique. Donc ça arrivait de chez les blancs, donc c’était pas bon. C’était à la rigueur une maladie de blancs. Donc nous on se soigne avec un thé de gingembre, etc. »
Responsable médical de la campagne de vaccination du Canton de Vaud
« Une partie des Africains ont pensé qu’ils n’allaient pas être touchés par le COVID. Ils disaient que d’être noir, les protégerait du COVID. »
Infirmière au Point d’Eau
Cette “méfiance” ou ce “désintérêt” mentionnés pour justifier l’absence des “Africains” (terme qui désigne en réalité plus spécifiquement les personnes d’origine subsaharienne et donc noires) touchent en réalité à des enjeux de pouvoirs complexes de nature postcoloniale qui mériteraient d’être mieux étudiés. Nous évoquerons cependant ici quelques pistes de réflexion[1]. La méfiance envers les autorités pourrait être liée au profilage racial et à la violence policière dont les personnes noires (plus souvent les hommes) sont la cible dans la région lausannoise (Rapport Jean-Dutoit, 2017, p. 101-115). Précisons que la méfiance envers les autorités ne concerne pas exclusivement cette population mais qu’elle peut prendre pour les personnes noires une forme spécifique. Il en va de même de la méfiance envers le vaccin et le monde biomédical en général. Dans ce cas précis, cette méfiance peut être comparée à celle observée lors de l’épidémie d’Ebola en Sierra Leone (Niang, 2014) ou celle du Sida en Afrique du Sud (Fassin, 2007). Dans les deux cas, le contexte postcolonial a offert une “niche écologique”[2] à l’idée d’un complot mené par l’Occident à l’encontre des populations noires-africaines. Celle-ci s’est trouvée renforcée récemment par des propos tenus par deux scientifiques français envisageant de tester un vaccin contre le COVID en Afrique. Elle s’appuie également sur des faits historiques biens réels. Finalement, l’idée que le COVID soit une “maladie de blanc” doit être pensée à travers une conception de la maladie différente de celle véhiculée par le modèle biomédical et en prenant en compte le contexte d’infodémie auquel le continent africain n’a pas échappé. Ce faisant, il devient possible de concevoir le COVID-19 comme une “punition” visant l’Occident et épargnant les personnes afro-descendantes.
Il se peut aussi que la vulnérabilité face au virus ait impacté l’intérêt pour le vaccin. Comme pour la population générale, le jeune âge des personnes migrantes subsahariennes pourrait également justifier ce désintérêt. Inversement, le responsable médical de la vaccination note l’importance d’offrir l’accès au vaccin aux populations originaires d’Amérique du Sud, plus enclines au surpoids :
« Il y a beaucoup d’Américains du Sud qui sont en surpoids. Donc c’était très important de les atteindre. C’est pour ça qu’on s’est dit : « c’est bien que les Américains du Sud viennent, surtout s’il s’agit de personnes jeunes. » ». Responsable médical de la campagne de vaccination (VD)
Notons que le désintérêt des populations subsahariennes n’a pas été total puisque, plus tardivement, certaines personnes ont finalement sollicité la vaccination. Cet intérêt tardif serait à relier à leur parcours migratoire, comme nous le verrons. Contrairement à d’autres populations, jamais leur intérêt (ou désintérêt) pour la vaccination n’est relié à leur activité professionnelle.
Cela nous amène à un autre constat : la vaccination n’a pas toujours été un choix. Bien que la Confédération ne l’ait jamais rendue obligatoire, la vaccination s’est imposée à certaines personnes. S’agissant d’une vaccination non consentie, deux facteurs se présentent : les déplacements transnationaux et l’insertion dans le marché du travail.
Dans le premier cas, certaines personnes ont été poussées à se faire vacciner pour obtenir un certificat COVID leur permettant de voyager au-delà des frontières helvétiques. Si, pour certain·es, ces déplacements prenaient la forme de visites à la famille restée au pays ou de tourisme, d’autres ont été contraintes par des motifs administratifs. C’est le cas de certains migrants subsahariens qui, ayant transité par l’Italie, se voient obligés d’y retourner régulièrement pour y renouveler leur permis de séjour, comme le fait remarquer l’infirmière du Point d’Eau :
« Certains l’ont fait, parmi les Africains, parce qu’ils ont une carte d’identité italienne et pour la renouveler, ils devaient retourner régulièrement en Italie. Comme les conditions de voyage étaient extrêmement strictes à la frontière, ceux-là ont été obligés d’avoir un pass COVID. Ils se sont donc faits vacciner. »
Infirmière au Point d’Eau
En lien avec le parcours migratoire, la vaccination a donc parfois été indispensable pour maintenir son permis de séjour.
Le vaccin : ressource ou contrainte ? La pression du marché ou de l’employeur
Dans le second cas, c’est la nécessité d’accéder à l’emploi qui a motivé certaines personnes. Les personnes que nous avons interrogées ont observé des vagues de vaccination liées aux secteurs professionnels, qui se recoupent parfois avec l’origine des personnes.
Pour les travailleurs et travailleuses du sexe, l’intérêt a été immédiat. Comment l’expliquer ? Si la vaccination n’était officiellement pas obligatoire, nous supposons qu’elle a pu leur être imposée par la pression de leur employeur et par la concurrence sur le marché. En effet, plusieurs sites proposant leurs services mettaient en avant le statut vaccinal des travailleurs et travailleuses du sexe pour “protéger le client”, parfois sous la forme d’un pictogramme.

Dans l’économie domestique aussi, le vaccin aurait parfois été imposé par l’employeur. Cette situation aurait principalement touché les personnes (spécifiquement les femmes) d’Amérique du Sud :
« Les plus intéressés, c’était quand même les personnes originaires d’Amérique du Sud ou d’Asie. Certaines étaient en Suisse depuis assez longtemps et travaillent dans des familles, font du baby-sitting ou des ménages. Leurs employeurs exigeaient qu’ils soient vaccinés. C’était une des conditions pour qu’ils puissent retrouver leur travail. Pour eux c’était donc important de se faire vacciner. »
Infirmière au Point d’Eau
Dans la restauration également, certain·e·s employé·e·s se seraient vu imposer la vaccination. Dans ce secteur comme dans tous les autres, la vaccination n’a jamais été obligatoire, mais le certificat COVID a cependant été imposé pour le personnel non vacciné ou non guéri, le coût des tests étant à la charge de l’employeur. Nous pouvons émettre l’hypothèse selon laquelle certain·e·s patron·ne·s auraient imposé le vaccin à leurs employé·e·s pour des motifs économiques. Cela semble avoir été le cas pour de nombreuses personnes issues de la communauté chinoise, selon les dires de l’infirmière d’Unisanté. Lorsque nous lui demandons dans quel secteur travaillent les personnes ayant été contraintes à la vaccination par leur employeur, elle nous répond ceci :
« Alors là, il y avait beaucoup les Chinois dans la restauration parce qu’il y avait une grosse amende à ce moment-là. Je crois, que c’était 10’ 000 francs d’amende si on n’était pas vacciné. »
Infirmière à Unisanté
Ces personnes seraient selon elle arrivées en Suisse avec un statut de touriste leur donnant droit à un séjour de trois mois, sans permis de travail. Elles seraient employées illégalement dans la restauration et feraient des allers-retours entre la Chine et la Suisse, au rythme du renouvellement de leur statut de touriste :
“On a eu plusieurs vagues successives de personnes chinoises, comme employées dans les restaurants et tout. Et là, on voyait très bien le flux migratoire. Ces gens viennent travailler pour trois mois et tous les trois mois, on avait de nouveau une vague de première dose (…).”
Infirmière à Unisanté
Dans le secteur de la construction aussi, la vaccination aurait été imposée par certains employeurs. L’infirmière d’Unisanté nous dit avoir vacciné beaucoup de personnes y travaillant :
“Il y avait quand même pas mal de métiers manuels dans le gros œuvre : tous les maçons, les électriciens, tout ça. Ils avaient une contrainte parce qu’il y a quand même énormément d’entreprises qui ont été freinées, voire complètement bloquées dans leur travail. Alors quand l’opportunité est revenue de pouvoir reprendre le travail, certains patrons ont exigé la vaccination.”
Infirmière à Unisanté
La vaccination pour tou·te·s : enjeu démocratique, épidémiologique… ou économique ?
Nous avons vu comment les secteurs professionnels, le genre, la nationalité, l’âge mais aussi des rapports de pouvoirs relatifs à des enjeux postcoloniaux influent sur la vaccination, qu’elle soit choisie ou contrainte. Ces facteurs se recoupent, créant des situations spécifiques et complexes. Cela nous mène à rejoindre Didier Fassin dans le constat selon lequel les migrant·e·s ne peuvent être considéré·e·s comme un groupe homogène. La “vaccination des sans-papiers” a certes pris en compte les éventuelles particularités linguistiques de sa cible, à travers la traduction de flyers et la mise à disposition d’interprètes communautaires. Elle a aussi pris appui sur les liens de confiance qui reliaient son public au réseau social institutionnel existant, permettant l’activation des liens individuels entre bénéficiaires et professionnels·lles de terrain. Mais le fait même qu’elle soit dédiée à un public cible dit des “sans-papiers” revient à les particulariser. Or, selon Fassin (2021, p.245) ;
Le fait de particulariser les migrants et de se focaliser sur leurs caractéristiques conduit à les considérer à part du reste de la population, comme s’ils partageaient une condition suffisamment commune pour justifier de les distinguer des autres, alors même qu’on trouve en leur sein des trajectoires et des situations très différentes.
Comme il le relève, cette particularisation des migrant·e·s par la santé publique reproduit la même logique que celle que leur imposent les politiques de l’immigration :
Continuer à parler de santé des migrants (…), c’est souvent sans le vouloir appliquer aux exilés le même traitement d’exception que les politiques de l’immigration leur ont depuis des décennies imposé. (Fassin, 2021, p.246)
La santé publique est depuis longtemps associée à la maîtrise de l’immigration. (…) le contrôle de la frontière obéit à deux logiques distinctes : l’une consiste à tenter de faire écran aux pathologies contagieuses ; l’autre opère comme une fonction subsidiaire de la régulation des flux. (…) Bien que les circonstances influent sur l’importance accordée à l’une ou l’autre de ces logiques, la première se [renforçe] en cas d’épidémie et la seconde [prend] le dessus lors des tensions sur le marché du travail (…). (Fassin, 2021, p.228-229)
Dans le cas de la pandémie du COVID-19, c’est bien de faire écran à une maladie contagieuse dont il s’est agi : par le contrôle des frontières, mais aussi à travers la quête d’une couverture vaccinale maximale de la population. Pour mettre à bien ce dernier objectif, un dispositif de santé sans précédent a été mis en place pour permettre la vaccination des sans-papiers et des personnes précaires au Centre d’Unisanté. De par sa gratuité, son inconditionnalité, son anonymat et l’importante communication pour faire connaître son existence, ce dispositif a été exceptionnel. Fallait-il attendre une pandémie pour que la santé des personnes sans statut légal et/ou précarisées fasse l’objet d’autant d’intérêt ? Comme l’énonce Simonot (2008, p.2) : “Trop peu de pays ont résisté aux tentations xénophobes ou tout au moins discriminatoires de la séparation et hiérarchisation de l’égalité d’accès aux soins selon les statuts administratifs ou sociaux.” Le système de santé suisse n’échappe pas aux politiques migratoires répressives, au racisme, ni au système capitaliste globalisé qui dresse le droit à la santé comme valeur marchande. Les personnes sans-statut légal et/ou sans moyen de payer une assurance maladie se retrouvent privées de certains soins. Comme l’énoncent deux juristes de Genève : “Dans les faits, le constat est que le statut légal peut jouer un rôle en Suisse dans l’accès aux soins. ” et ce malgré l’existence d’institutions sanitaires existantes censées répondre à cette problématique. À travers la vaccination des “invisibles”, ce qui était en jeu n’était pas uniquement leur propre santé, mais aussi celle de l’ensemble de la population. On peut alors se demander si les réactions des autorités politiques en charge de la santé auraient été la même s’il n’y avait pas le risque que soient contaminés les corps ayant accès au système de santé ordinaire.
Aussi, nos entretiens ont révélé le rôle des personnes en situation de migration irrégulière dans le marché du travail, y compris non déclaré. Leur vaccination relevait également d’un autre enjeu : la relance de l’économie, qu’elle soit formelle ou informelle. Les “sans-papiers” y jouent très souvent un rôle non reconnu, bien que nécessaire. Tenant compte de cela, comme le suggère Fassin, la “santé des migrants” ne relève pas (uniquement) de leur condition sanitaire en lien avec la migration, mais plutôt de “santé au travail”. Il s’agirait en conséquence de “mettre leur condition sanitaire en relation non pas avec leur migration en tant que telle, mais avec les pratiques des entreprises qui les pénalisent en raison de leur vulnérabilité sociale” (Fassin, 2021, p.248). Autrement dit, plutôt que de s’attacher aux qualités des personnes, Fassin propose d’examiner “la forme de vie que les circonstances leur imposent”(Fassin, 2021, p.254). Cette approche aurait peut-être permis d’éviter que certaines personnes soient vaccinées sous la pression du renouvellement de leur titre de séjour, de leur employeur ou du marché du travail. Car si la “vaccination des sans-papiers” se voulait un accès universel au vaccin vu comme une ressource, nos entretiens laissent entrevoir la possibilité que pour certains·es le vaccin ait été une contrainte. Si cette idée, qui demande à être approfondie, s’avérait confirmée, le bilan positif établi par les personnes interviewées devrait donc être revu à la lumière de ce constat.
[1] Nous nous appuyons pour ce faire sur un travail non publié réalisé par Emilie Vuilleumier dans le cadre du cours de Cynthia Kraus, “Genre, médecine, santé” (2022).
[2] Ian Hacking considère la “niche écologique” comme “l’espace social qui rend possible l’apparition d’une maladie” mais nous l’étendons ici à la manière de Didier Fassin à ”[l’espace social qui rend possible] l’émergence d’une théorie locale” (Fassin, 2007 : p.108).
Bibliographie
Littérature académique
Fassin, D. (2007). Entre désir de nation et théorie du complot. Les idéologies du médicament en Afrique du Sud. Sciences sociales et sante, 25(4), 93‑114.
Fassin, D. (2020). Les mondes de la santé publique : Excursions anthropologiques. https://www.college-de-france.fr/site/didier-fassin/course-2020-2021.htm
Fassin, D. (2021). Les Mondes de la santé publique, excursions anthropologiques. Cours au Collège de France 2020-2021. Paris: Seuil.
Heikel, J. (2021). Pandémie à coronavirus Covid-19 : l’exception africaine ? Revue Française de Socio-Économie, 26, 165-171.
Niang, C. I. (2014). Ebola : Une épidémie postcoloniale. Politique étrangère, 4, 97‑109.
Simonnot, N. (2008). La discrimination dans l’accès aux soins des migrants en Europe : Un déni des droits fondamentaux et une absurdité de santé publique. Humanitaire. Enjeux, pratiques, débats, 19. https://journals.openedition.org/humanitaire/465
Sources primaires
Collectif Jean Dutoit. (2017). Rapport pour les droits et la mobilité des personnes migrantes noires africaines en Suisse et en Europe. Lausanne.
Coronavirus et essais de vaccin en Afrique : L’OMS fustige des propos « racistes » et une « mentalité coloniale ». (2020, 7 avril). TV5MONDE. https://information.tv5monde.com/afrique/coronavirus-et-essais-de-vaccin-en-afrique-l-oms-fustige-des-propos-racistes-et-une
L’Afrique, perpétuel cobaye ? (2020, 11 octobre). Le Courrier. https://lecourrier.ch/2020/10/11/lafrique-perpetuel-cobaye /
Prostitution et Covid – Prostituée vaccinée ou non ? Le choix est possible. (2021, 10 août). 24 heures. https://www.24heures.ch/prostituee-vaccinee-ou-non-le-choix-est-possible-728724883979