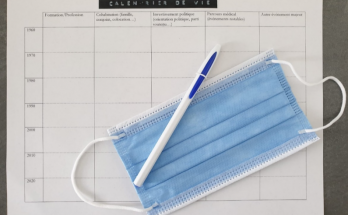Par Coralie Gil
Plus de deux mois se sont écoulés depuis le début de cette crise, ce bouleversement dans nos vies : Corona, CoVid19, SARS-CoV-2. Tout a peut-être déjà été dit, mais tout est à redire encore. Deux mois, une certaine lassitude oui, l’impression de devoir faire le point, mais pas encore le bilan. Se demander : « En somme, où en sommes-nous maintenant ? » et de ce passé ponctuel et de cet après possible, composer, juste dire.
Deux mois donc. Le temps de s’être habitué, équilibre, partiel confort dans la situation. Le changement radical engendré, la créativité de trouvailles et retrouvailles numériques. Il y a eu des vagues, il y a eu des vacarmes et puis l’accalmie aussi ; constatons.
En partant de notre expérience subjective, située à la frontière entre la caisse d’un supermarché suisse et la recherche en philosophie, se dessinent, il nous semble, trois mouvements, trois types de questions engendrés par le Corona (appelons-le donc ainsi) : ralentissement et expérience de la décroissance d’abord, ennui et mort ensuite, redémarrage finalement.
Le Corona, ralentissement imposé
Indéniablement, le Corona nous a amené à faire le constat de nos quotidiens, de nos ritualités non virtuelles. Tous nos endroits, toutes nos places, se sont condensées en une seule : le chez soi. Toutes nos vies, sociales, artistiques, amoureuses, professionnelles et familiales se sont retrouvées, groupées pour la première fois, autours du même sujet : Corona. D’un seul coup, toutes les évidences, tous les acquis ont dû se réagencer.
Et puis, un mois plus tard, après l’ébullition des premières variations, me voilà prise dans un nouveau quotidien, recréé, différent, mais finalement quotidien tout aussi vivable, allant à l’essentiel. Un seul trajet demeure, pour le travail de caissière, j’augmente mes heures même, question de solidarité, y aller, épaules solides ; heureusement qu’il y a le plexiglas.
Le reste du temps, la chambre devient le bureau, spatialité recomposée, seconde vie de la vieille Laserjet qui croupissait jusque-là, sous une table. Sociabilité par écrans interposés.
Ralentissement imposé donc. Et attention nouvelle portée aux choses dont l’existence ne nous apparaissait même pas, avant, brillant maintenant par leur absence. La nécessité des fleurs, les contacts tactiles d’une embrassade ou d’une poignée de mains, sentir l’odeur d’une silhouette de passage. Le chant du merle sans le bruit des avions, le ciel dénudé. Dehors, on imagine presque l’urbex[i], on rêve d’une nature reprenant ses droits, tôt ou tard oui. L’angoisse vient peut-être de là : fantasme et effroi du monde sans humain, apocalypse fantasmée.
Le Corona, l’ennui et la mort : l’humain mis face à sa condition
Apocalypse, l’attente spectaculaire dont la mort n’est que l’ombre, la version soft. Presque pire, comme matière à penser, et pourtant c’est surtout à cette dernière que l’humain se confronte, confiné. Inquiétude pascalienne. Non seulement concrètement, ramené à la mort par un virus potentiellement mortel, l’homme occidental surprotégé est soudainement ramené à sa condition, mais en plus, l’ennui, l’injonction à rester chez lui, l’oblige à y penser.
La mort, réelle, rôde. D’habitude, nous l’esquivions, nous nous croyions au-delà, immortels presque, de la technologie à la crème anti-âge, la mort était ailleurs. Nous ne connaissons pas vraiment l’odeur des cadavres, la mort existe mais toujours lointaine, cachée. D’ailleurs, la vieillesse aussi. Les fragilités sont hors-champs. Existence tolérée, invisibilité requise. Nous en étions là. Et puis arrive le Corona, nous voilà forcés de constater l’Iceberg.
Alors, toutes sortes de tentatives d’évitement. De tourner en rond à brasser de l’air en passant par « passer trois heures à télécharger un logiciel permettant de mettre en ligne une vidéo créée à partir d’un autre logiciel après l’avoir compressée à l’aide d’un troisième logiciel ». Tout va bien. Divertissement : à tout prix, faire en sorte de penser à autre chose, ou de ne pas penser du tout.
Malgré nous, finalement, le retour au corps, le retour à la chambre, le retour à soi. Ennui imposé. Tout à coup, on prend le temps de contempler, parfois sans même faire exprès. La manière dont la plante verte se tourne vers le soleil, ce livre depuis longtemps ouvert à cette page, pourquoi déjà ? la peau abîmée de désinfectant : je n’ai jamais passé autant de temps à regarder ma main, la paume, les lignes, les veines comme des racines sur le dessus, la forme de chaque doigt, l’ongle un peu brisé. Méditation, ma peau, enveloppe, tout autours, et à l’intérieur tous ces non-humains, qu’est-ce que je suis, finalement ? A quoi je sers ?
Lequel du balcon ou du plexiglas ?
L’ennui, privilège bien entendu, des heures, s’il y en a, où l’on ne travaille pas. Toutes nos vies autours du même sujet. Le monde quasi-entier, pour la première fois, vit en même temps, le même problème. Visuellement, plus d’avions dans le ciel, quelques fantasmes d’apocalypse, et un crash boursier, possiblement sans précédent. Des politiciens, effrayés viennent à ne plus savoir quoi dire, comment gérer à la fois le profit et la santé ? Quel coût humain est acceptable pour ne pas empirer la situation financière ?
Depuis mon balcon, l’impression d’un monde en pause.
Derrière le plexiglas de ma caisse, l’impression d’un monde à l’affût : la moindre information du Gouvernement peut mettre fin à toutes les bonnes résolutions ; les attitudes changent, on revient à l’individualisme exacerbé de la première phase de la crise. Alors, on crie sa colère sur la caissière, seul face à face de la journée, catharsis évidemment. Le balcon et le plexiglas ne me promettent pas les mêmes après.
Depuis mon balcon, j’imagine une prise de conscience, plus de solidarité, le retour au local, aux plaisirs simples et à l’ennui. J’imagine un après ralenti, une attention nouvelle, une remise en question des schèmes existants.
Derrière mon plexiglas, je vois la précipitation, s’élancer à tout prix vers le « comme avant » en pire. Un redémarrage de consommation en force, l’envie d’en finir avec la parenthèse, de reprendre au plus vite. Des postillons énervés, des pizzas surgelées, la fastlife à tout prix.
Lequel du balcon ou du plexiglas ? J’espère le constat, le pas en arrière, le recul, j’espère un éventuel compromis.
[i] L’urbex ou « urban exploration » décrit la fascination pour des lieux abandonnés et sur lesquels la nature a repris ses droits. De ce phénomène naissent un certain nombre de photographies où les lychens avalent des buildings, donnant l’impression que la vie humaine n’est plus qu’une trace, lointain souvenir lui-même bientôt englouti.
Coralie Gil, récemment diplômée d’un Master en Philosophie à l’Université de Lausanne et caissière dans un supermarché, s’intéresse à la pensée « en réseaux » et à la diversité des moyens de comprendre le monde. Ses domaines de recherches s’articulent autours de l’anthropologie, l’histoire des sciences et la philosophie contemporaine. Elle travaille actuellement sur la thématique nature-culture dans une perspective harawayienne regroupant l’urbex, le cyborg et les non-humains.