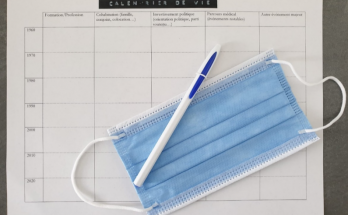Expériences de la pandémie
De mars à mai 2021, entre confinement et enseignements à distance, une classe de master de l’UNIL en sociologie de la médecine et de la santé a mené onze enquêtes au plus près du quotidien d’une variété de métiers, de communautés, de milieux. Les paroles recueillies composent la trame d’expériences partagées et de vécus intimes des événements, une lecture plurielle de leurs existences au cœur de la pandémie.
Une enquête de Carla Gosteli, Guillaume Pauli, Viviane Adler
En avril 2020, le journal Le Temps relève que l’interdiction du travail du sexe à cause de la pandémie Covid-19 a des conséquences dramatiques pour les travailleur·e·s du sexe (TDS) : pour les plus précaires d’entre elles et eux cela signifie ne rien avoir à manger ni de lieu où dormir[1]. Au fil du temps, des assouplissements ont eu lieu dans certains cantons, mais leur situation est restée incontestablement difficile. Quatre femmes travaillant dans ce secteur ont partagé avec nous leurs expériences. Entrer en contact avec elles s’est avéré un vrai casse-tête : nous avions imaginé pouvoir entrer en contact avec celles et ceux qui s’étaient exprimées publiquement dans les médias, mais leur anonymisation rendait cela impossible ; les associations de solidarité venant en aide aux TDS nous conseillaient d’aller directement dans les rues afin de les aborder personnellement. Nous avons suivi leur conseil et sommes allé·e·s explorer sur deux sites distincts, à Lausanne et à Zurich.
Ici c’est mort, elles ne vous parleront pas. La plupart de ces filles n’ont pas de papiers, elles sont très méfiantes – Iasmin
À Lausanne, nous sommes confronté·e·s à une forte réticence de la part des TDS : regards fuyants, réponses brèves, évitement craintif. Nous apprenons grâce à Iasmin – une des rares travailleuses à nous répondre dans cette première tentative – la réalité des femmes que l’on a tenté de rencontrer ce soir-là dans la rue : Ici c’est mort, elles ne vous parleront pas ; la plupart de ces filles n’ont pas de papiers, elles sont très méfiantes. Nous comprenons qu’elles sont réticentes à communiquer avec toute personne représentant de près ou de loin une institution, qu’elles fuient toute interaction prolongée pouvant mener à un contrôle policier. Nous suivons la recommandation de Iasmin : entrer en contact avec des salons où la situation est généralement plus stable et où les femmes se sentent plus en sécurité. Après en avoir visité plusieurs, nous parvenons à organiser un entretien avec Judith, une gérante, ainsi que deux employées, Mathilde et Mina, qui acceptent de nous parler.
À Zurich, la situation est encore plus délicate : le travail du sexe y est toujours interdit en raison du Covid-19. Pourtant, en marchant dans les rues, nous remarquons aisément que le travail du sexe n’a pas pris fin : nous observons la présence de femmes assises aux terrasses de bars fermés, attendant des clients. La police est présente elle-aussi, créant une ambiance assez particulière. Quand nous leur demandons pourquoi elles ne travaillent pas dans un autre canton où le travail serait légal, une femme nous répond : Parce que je ne les connais pas, tu sais ; quand je suis arrivée en Suisse, il y a quelques semaines, je ne connaissais personne. Les raisons diffèrent probablement selon les femmes, mais un souhait est partagé par toutes : pouvoir continuer à travailler, à gagner de l’argent pour vivre, même si cela doit être dans des conditions difficiles et dangereuses. Les TDS à Zurich se voient donc obligées de rester très prudentes et réservées. Le simple mot « Gespräch » engendre des gestes de refus et met fin à la demande. Finalement, après avoir abordé de nombreuses femmes, Ana accepte : Je peux le faire, mais là je n’ai pas le temps, je dois rencontrer un client. Elle nous donne son numéro de téléphone et nous organisons un rendez-vous.
On a peur aussi que la police arrive et qu’on soit sans masque – Judith
Dans le salon, Judith explique comment le contrôle à évolué suite à la situation sanitaire : les contrôles de la police c’était plutôt pour les papiers des filles ; après le Covid, ils sont venus… plus rapidement, chaque mois, et c’est pas la même police, hein, c’est une autre police, la police de sûreté je crois. Ces contrôles ne sont donc pas nouveaux, mais leur but orienté Covid n’atteint pas la bonne cible selon Ana : Il y a besoin de contrôles, mais ça je trouve dommage par contre, parce qu’en Autriche les filles doivent être contrôlées pour bosser ; et je trouve ça dommage qu’il n’y ait pas ça en Suisse, explique Judith. Elle développe en expliquant que de tels contrôles devraient contribuer à la protection de la santé des clients, mais aussi des employées du salon. La protection de la santé des clients est aussi primordiale pour Judith qui a d’ailleurs organisé un rendez-vous pour faire vacciner l’ensemble de ses employées. Mais cette surveillance est devenue source de stress pour Judith et ses employées, parce qu’on a peur aussi que la police arrive et qu’on soit sans masque. En effet, en cohabitant et en se testant fréquemment, elles s’autorisent par moment à baisser le masque dans la journée. Si des policiers, généralement en civils, viennent effectuer leur contrôle, elles risquent de fortes amendes, voire la fermeture du salon.
À Zurich aussi, la police est en civil quand ils et elles contrôlent plusieurs filles dans les rues. Ana nous explique qu’il s’agit davantage du contrôle des cartes d’identité et des permis de séjour que du contrôle du respect des mesures contre le Covid. Toutefois, ces contrôles ne semblent pas revêtir une grande importance pour les femmes même si, Ana le sait : oui, le travail est interdit pour le moment… bien sûr, c’est un risque ! Nous avons l’impression qu’elles sont habituées aux contrôles et savent comment les gérer.
La pandémie de Covid-19 a mis fin à l’époque où l’on pouvait gagner facilement et rapidement de l’argent avec le travail du sexe – Ana
Pendant la première vague de Covid, la police se rendait régulièrement au salon afin de vérifier qu’il n’était pas en activité. A Lausanne, les salons ont été en effet fermés pendant trois mois au début de la pandémie. Durant cette période, l’aide reçue au titre d’indemnité pour réduction de travail a été minimale. Judith nous raconte que certaines de ses employées n’ont rien reçu : il y a aussi beaucoup des nanas qui savent pas leurs droits, ou qui ont honte, ou qui font en cachette de la famille, qui voulaient pas faire le nécessaire pour prendre leurs droits. Pour sa part, elle a reçu en tout et pour tout 1503.50 CHF pour 90 jours de fermeture, alors que pour la même période, elle a dépensé 45’000 CHF en loyer pour les différents salons qu’elle possède, et qu’elle a, en parallèle, fourni une aide à ses employées : les filles, d’habitude elles travaillent, elles envoient leur argent… ; tout à coup c’était à moi de payer tous les billets des filles pour que les filles partent ; et même les entretenir pendant ces 90 jours. Les billets auxquels Judith fait référence sont les billets d’avion pour la Roumanie, pays d’origine de plusieurs de ses employées, et dans lequel elle leur a suggéré de retourner pendant cette période car le coût de la vie y est moins cher. D’ailleurs, le jour de la réouverture des salons, alors que les clients ont massivement afflué, des filles n’étaient pas rentrées de Roumanie…
Passée la fièvre de la réouverture, le salon a pourtant été confronté à une cruelle diminution de la clientèle, que Judith tente de s’expliquer : les jeunes, du coup, ils sortent pas s’il y a pas de disco, s’il y a pas un café ouvert ; et les vieux… ils sont vieux, ils ont peur aussi. Elle explique aussi que la traçabilité imposée pour lutter contre la propagation du Covid a également fait fuir les clients en supprimant une partie de l’anonymat.
Les employées du salon confirment les affirmations de la gérante concernant les difficultés économiques subies pendant cette dernière année. En revanche, elles assurent avoir demandé des aides et n’avoir reçu que des réponses négatives. Mathilde explique que, travaillant au début de la pandémie dans un autre pays, elle avait eu le droit à une aide qui lui permettait de vivre sans se voir obligée de s’exposer au virus ; mais à son grand désarroi, lorsqu’elle a déménagé en Suisse, elle n’a plus reçu d’aides de l’État. Mina et Ana se sont retrouvées à exercer en tant que TDS à cause de la perte de leur autre emploi dans la restauration qu’elles exerçaient depuis des années : C’est à cause de tout ce processus lié au Covid que je me suis retrouvée pour la première fois à travailler en ça ; tu sais !? Mina n’apprécie pas vraiment ce travail et elle tente de gagner un maximum d’argent pour en changer au plus vite. Mais elle sait que son plan risque désormais de prendre du temps à se réaliser, car depuis qu’elle s’est lancée dans le travail du sexe, la clientèle s’est énormément réduite : Parfois maintenant tu te fais un client par jour… Si tu gagnes cinquante francs, ça revient à trente francs pour toi… Quand j’ai commencé à travailler ici, normalement tu pouvais gagner cinq-cents, six-cents francs par semaine… et pourtant j’étais celle qui travaillait le moins car je ne connaissais personne… Mathilde confirme avoir remarqué elle aussi une diminution drastique de la clientèle : ça a réduit de nonante pourcents ! Faisant l’effort de parler français, elle nous fait part de ses propres hypothèses quant aux raisons de cette baisse de la demande de la part des clients : Les clients, c’est moins la peur qu’ils ont, que le besoin ; ils prennent ça comme un labeur primordial ; car facilement un homme devient fou… C’est plutôt à cause que, comme tout était fermé, ils ne prenaient pas le risque de venir en cachette ; s’ils venaient ici et si la police les choppe, il y a un vrai impact pour leur famille. Quand tout est fermé, les bars et restaurants… alors les clients n’ont plus d’excuse à donner à leur femme la nuit : « Chérie je vais boire une bière. » Comment vont- ils venir ici ? Ils vont donner quoi comme excuse ?
Dans le travail du sexe, le facteur économique est omniprésent : pour la majorité des TDS, c’est leur motivation principale. Ana revient sur son parcours : normalement je travaille dans le secteur gastro au Portugal, mais avec la pandémie j’ai perdu mon emploi. Mon meilleur ami, mon coiffeur, m’a donné le conseil de partir dans un autre pays où personne ne me connaît et de travailler comme travailleuse de sexe. Il connaissait mes difficultés et faiblesses économiques… J’ai deux fils qui me manquent incroyablement, c’est pour eux que je le fais. Mais la situation actuelle ne rend pas la tâche aussi facile que prévu : La pandémie de Covid-19 a mis fin à l’époque où on pouvait gagner facilement et rapidement de l’argent avec le travail du sexe. Actuellement, il y a pas beaucoup de clients et c’est encore plus difficile pour moi qui suis nouvelle, parce que je ne connais personne et je ne sais jamais si les clients sont bons ou non. Ana poursuit en nous expliquant que les TDS font actuellement face à deux difficultés majeures : la diminution du nombre de clients et une baisse des prix de leurs services. Selon elle, en temps normal le salaire journalier minimum varie de 60 à 75 CHF, ce qui fait 3000 à 3500 francs par mois ; mais actuellement, personne ne gagne ce minimum !Pour Ana, la récente chute brutale des prix est liée au fait que le virus a déclenché une crise mondiale qui affecte toute la population, que les gens ne se sentent plus en sécurité, financièrement et psychologiquement. Pour elle comme pour la plupart de ses collègues, l’impact économique de la pandémie est énorme et place les TDS dans une position de vulnérabilité. Une autre femme avec laquelle nous avons échangé informellement et rapidement dans la rue refusait notre demande d’entretien parce que le temps, c’est de l’argent. Et ne pas voir des clients signifie ne pas avoir de dîner sur la table.
Elle a risqué sa vie pour moi – Mathilde
L’un des effets plus positifs de ces difficultés est l’établissement et le renforcement des liens entre les employées des salons. La gérante exprime sa confiance envers ses employées : elles sont vraiment responsables, elles savent que là, c’est leur boulot, c’est comme leur maison ; elles vont pas faire n’importe quoi. Dans cette « maison » professionnelle se nouent des liens de solidarité entre les TDS qui la partagent. Interrogeant Mathilde et Mina au sujet d’éventuelles rivalités entre elles au sein du salon, la réponse est claire : aucune. Et Mina explique qu’il y a des règles très concrètes que toutes les employées respectent : Les problèmes, c’est pas la faute des filles mais du client qui choisit. Si moi je suis en charge d’accueillir les clients, par exemple, le client arrive et moi j’ouvre la porte et une autre fille passe derrière moi. Ça on ne doit pas le faire ; car à ce moment-là, le client a déjà vu quelqu’un d’autre qui passe ; il peut donc changer d’avis et finalement choisir l’autre fille. On a des règles. Comme chacune respecte ces règles, il n’y a pas de problèmes. En revanche, Mathilde nous explique qu’ayant eu des soupçons d’avoir attrapé le Covid quelques mois auparavant, le soutien de la part de ses collègues n’avait pas toujours été à la hauteur de ses attentes : La plupart me tournaient le dos ; personne ne voulait venir dans ma chambre car elles pensaient que j’avais le Covid. Malgré cela, Mathilde est très reconnaissante envers deux femmes qui, à la différence des autres, ont su prendre soin d’elle : Une fille est venue m’amener une soupe ; une autre s’est décidée et est venue me dire « Vas-y on y va, je mets mon masque et des gants et je t’emmène à l’hôpital. » Elle a risqué sa vie pour moi.
À les entendre, au contraire des relations entre femmes exerçant en salon, beaucoup de rivalité et de méfiance existent entre les TDS exerçant dans la rue, une tendance ordinaire qui s’est encore accentuée avec la baisse des clients liée à la pandémie : Surtout les nouvelles travailleuses comme moi sont considérées comme des rivales… ; je le comprends, c’est leur travail. Et Ana poursuit en nous expliquant qu’il existe ainsi de fortes différences hiérarchiques fondées sur l’ancienneté de l’activité en tant que TDS et sur le pays d’origine, que les mélanges avec des femmes d’autres origines sont rares, qu’elles restent entre elles ou toutes seules. Elle relève néanmoins avoir découvert le soutien associatif pour celles et ceux qui travaillent indépendamment dans la rue : C’est impressionnant, je n’ai jamais vu ça dans aucun pays et surtout pas dans le mien (le Portugal), une telle solidarité et un tel soutien de la part des organisations. Ana est réellement fascinée par les organisations solidaires qui font des tours dans la ville et mettent des informations, des préservatifs ou des produits alimentaires à la disposition des TDS, cela gratuitement, avec discrétion et bienveillance. La gérante rend également hommage à ces organisations solidaires : Elles savent tout faire ; et c’était pas le canton (l’État) qui était là, parce que tout était fermé, tout à coup, mais elle (l’association qui leur vient en aide) elle était partout.
Les séquelles qui restent en toi, même si tu ne t’es jamais fait contaminer, sont énormes – Mathilde
Malgré le soutien et la solidarité loués par Ana, Mathilde et Mina, l’impact psychologique de la crise sanitaire n’en demeure pas moins prégnant. Mathilde, qui s’identifie elle-même comme économiquement vulnérable, nous explique que les TDS se voient souvent confrontées à des situations complexes : Si l’État ne pense pas à nous en tant que pauvres, c’est toi-même qui doit te préoccuper d’avoir quelque chose à manger, acheter des médicaments. Elle décrit comment, au fil du temps, les employées ont commencé à sentir l’impact que la situation avait sur leur mental : Je pleurais 24/7. Parfois j’allais manger et je me disais « Putain, hier je n’avais rien à manger… ». Je me sentais submergée par mes angoisses. Évidemment après je ne peux pas travailler ; et les clients le voyaient, ils voient ressortir en toi les angoisses, ils sentent que t’es dans le besoin. Les séquelles qui restent en toi, même si tu ne t’es jamais fait contaminer, sont énormes. Et à cela s’ajoutent la charge de la culpabilité : Beaucoup de membres de ma famille sont morts, continue Mathilde ; je n’ai rien pu faire. Je n’ai pas pu non plus leur envoyer de l’argent pour les aider, car j’en gagnais pas. J’ai une double douleur. La douleur de ne pas pouvoir être là-bas avec eux, et la douleur de ne pas pouvoir les aider en rien. Mina aussi est affectée : Cette situation est en train de me rendre folle. Je suis tellement stressée… J’ai mal à la tête tous les jours, je dois prendre des pilules. Tu passes ta journée sur ton canapé à attendre, tu regardes les murs. Ça te tend… Je ne sais même plus quoi regarder sur mon téléphone. Ana s’inquiète et se voit parfois obligée de s’absenter du travail parce que tout tourne dans ma tête : j’espère de tout cœur que ça (la situation pandémique et le travail de sexe) ne m’affectera pas à l’avenir, que ça ne m’affectera pas gravement sur le plan psychologique. Et Mina d’enchaîner sur l’estime d’elle-même entamée par la situation : Les filles qui ont pu faire un peu d’argent sont seulement quelques-unes. T’imagines bien qu’il y a des corps et des corps… Parce que le mien, il est pas très beau. Et tu sais le type de corps que les hommes aiment… Les petits corps tout fins. Moi j’ai mes bourrelets et mes vergetures… A entendre ces employées qui se mettent à nu devant leurs clients, au sens propre comme au figuré, on comprend que la crise rend les complexes, les sentiments d’insécurité, l’ébranlement psychologique ou les moments pénibles de la vie encore plus difficiles à cacher qu’en temps ordinaires, compromettant un travail déjà difficile et souvent non choisi.
Je ne peux pas voir la maladie sur le visage des clients, ce qui me fait peur – Ana
Leur travail à l’heure du Covid-19 est rendu compliqué non seulement par le stress psychologique, mais aussi par les règles et mesures visant à prévenir la propagation du virus. Judith les décrit : lavage des mains à l’entrée pour les TDS et les clients, port du masque en permanence, désinfection toutes les demi-heures des lits, douche avant les rapports et interdiction des baisers – ça devient vraiment maniaque, je l’étais déjà avant, imagine maintenant avec le Covid. Les nouveaux rituels d’hygiène décrits par la gérante semblent bien partagés par les employées, lorsque les clients acceptent bien sûr de s’y soumettre aussi : J’ai toujours du gel sur moi ; dès que le client arrive, je lui en mets sur les mains. Ils portent toujours le masque ; il y en a beaucoup qui l’enlèvent pas tout du long. Je me suis jamais fait contaminée. Judith précise que ces mesures sont, bien que contraignantes, globalement bénéfiques au niveau sanitaire pour la protection des TDS : Vraiment, pour une prostituée, je crois que ces mesures c’était les meilleures mesures de notre vie [rire]. Judith explique ensuite avec soulagement et fierté le comportement de ses employées : Les filles sont quand même des personnes responsables, qui sont mariées, qui rentrent à la maison, et qui vont pas non plus choper n’importe quoi. Elles font pas n’importe quoi pour l’argent, et ça aide beaucoup. Les clients aussi semblent respecter assez volontiers les mesures, au salon en tous cas : les clients, ils sont aussi conscients, la plupart en tout cas ; tous les clients arrivent avec masque, et y a pas de baiser.
En revanche, une femme qui travaille de manière indépendante est plus exposée au risque d’une infection avec le Covid-19, explique Ana. Comme il existe une rivalité et une compétition entre les TDS, les clients ont le pouvoir d’exiger beaucoup de choses. Si une femme ne l’offre pas, ils passent à la suivante. Cela a forcément un impact sur le respect des mesures de protection : Si je parle simplement avec un client, je peux porter un masque, mais si le client vient à mon appartement, c’est difficile… La grande majorité refuse que je travaille avec un masque ou des gants. La seule chose que je peux faire pour me protéger est de choisir mes clients ; mais le virus est une chose invisible, je ne peux pas voir la maladie sur le visage des clients, ce qui me fait peur… ; et pas toujours facile de demander qu’ils se lavent les mains quand ils entrent dans mon appartement. Je peux utiliser le virus comme prétexte pour éviter de les embrasser. Cela me donne un peu de sécurité, mais j’ai quand même peur.
Les échanges avec les quatre TDS témoignent de manière impressionnante de la manière dont la pandémie a affecté ce secteur d’activité dans lequel les travailleur·e·s sont directement et extrêmement exposé·e·s au virus. En même temps, on comprend par leurs récits que les changements induits par la crise sanitaire ont et auront des effets spécifiques pour chaque TDS en fonction de leurs conditions de travail et leur situation de vie. Pour celles et ceux qui vivent dans ces situations précaires, les mesures contre le Covid-19 souvent engendrent et renforcent les vulnérabilités et la marginalisation qui accentuent les inégalités existantes. Les récits d’expériences de ces quatre TDS qui ont eu le courage de nous parler de leurs espaces doublement confinés nous le rappellent de manière dramatique et poignante.
[1] https://www.letemps.ch/suisse/ne-vais-faire-lamour-un-masque-gants

De mars à mai 2021, entre confinement et enseignements à distance, une classe de master de l’UNIL en sociologie de la médecine et de la santé a mené onze enquêtes au plus près du quotidien d’une variété de métiers, de communautés, de milieux. Les paroles recueillies composent la trame d’expériences partagées et de vécus intimes des événements, une lecture plurielle de leurs existences au cœur de la pandémie.
Un projet accompagné par Francesco Panese et Noëllie Genre.