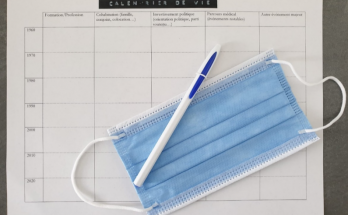Par Léonard Dolivo
Prologue
Restons positifs (comme un frottis nasopharyngé), l’épidémie a eu au moins le mérite de démocratiser des savoirs scientifiques. Par exemple, tout le monde sait à présent que le processus de fabrication d’un vaccin est complexe, capricieux et somme toute désespérément long (comme un confinement sans jardin), ce qui constitue un gain significatif pour l’empowerment général. La crise sanitaire fournit toutefois des enseignements contradictoires : on aura vu, à la même période, certains vaccins inventés du jour au lendemain, presque en un claquement de doigt. Le courage est de ceux-là. Dans l’épisode actuel, il fait même figure de panacée, comme s’il devait à lui seul suppléer à une immunité par trop inaccessible. Il a été généreusement distribué à toute personne obligée de poursuivre, parfois sans grande protection, un travail au contact de quidams nécessairement suspects d’infectiosité (il s’agit là, tout bien réfléchi, de proxitravail). Quoique le principe actif soit connu depuis longtemps (« surmonter la peur »), on ignore à peu près tout de la structure et de la composition du médicament. Livrons-nous donc à une analyse tout à fait rigoureuse du produit. Par manque de moyens, le dispositif de notre expérience ne consiste pas en un spectromètre de masse, mais en un spectacle de marionnettes. Le Conseil fédéral en a permis la tenue par dérogation exceptionnelle. Tous les personnages sont des savants, réunis pour un huis clos, un peu comme dans Les Physiciens de Dürrenmatt, à ceci près qu’on ne discute pas ici de nucléaire, mais bel et bien de courage. Déjà, les trois coups retentissent et le rideau se lève.
Acte I
La première figurine apparaît. Elle est poussiéreuse, frêle, toute ridée et dotée d’une longue barbe blanche. Quelqu’un dans le public la reconnaît sur-le-champ. Il s’écrie : « C’est la poupée dont parlait Walter Benjamin ! On la trouve dans la première desThèses sur le concept d’histoire ». C’est en effet la marionnette de l’Histoire, qui a toujours de belles choses à nous raconter. Elle s’avance sur la scène, réfléchit un peu, regarde vers l’arrière, se retourne, puis demande d’un ton docte : « Saviez-vous que le courage descend du mot cœur ? ». Silence dans la salle. On en attend un peu plus : on sait au moins depuis Marc Bloch et son Apologie que l’étymologie ne vaut pas une explication. Elle poursuit : « Le courage prend son origine dans la virtus des Romains et dans l’andreia des Grecs. C’est donc une affaire d’hommes, de guerriers ». Un murmure désapprobateur parcourt le public. La voix chevrotante du petit mannequin reprend cependant: « Cela vous paraîtra bizarre, mais il ne faut pas faire de jugement a posteriori. À de nombreux jeunes sur le champ de bataille, le courage a délivré le permis de mourir sans regret et, aux plus vieux qui les y expédiaient, celui de vivre sans culpabilité ». Le public en a assez : quel est le rapport avec les infirmières qui, chaque jour, ont travaillé au front tout en gardant leurs proches éloignés? Quelques individus crient « Remboursez ! » et voilà tout à coup que le fantoche de l’Histoire est poussé dehors sans ménagement par une autre marionnette.
Acte II
Avec sa silhouette musclée, on dirait une pratiquante de boxe ou de karaté ; d’un quelconque sport de combat, en somme. Après un instant de flottement, on l’identifie alors : c’est la penseuse de la Sociologie ! Il va se passer quelque chose, c’est sûr. Le public frémit d’excitation. Il n’est pas déçu, la star effectue une entrée maousse : « Le courage ? Fait social total ! » tonne-t-elle d’emblée. Elle enchaîne : « Ma collègue à la barbe blanche est un peu dépassée, mais elle a raison de vous parler de chair à canon ! ». A ces mots, l’assemblée se rembrunit. L’oratrice continue sur sa lancée : « Vous me dites héroïsme ? J’entends sacrifice. Vous forgez des médailles ? D’avance, j’en devine le revers. Vous me parlez de courage ? Mais je ne vois qu’un rouage ! ». Un brouhaha mécontent monte des gradins. Le pantin doit maintenant parler plus fort pour se faire entendre : « Les soignant·e·s, les employé·e·s de supermarché, les balayeur·euse·s, toutes les personnes dominées ne sont-elles pas depuis longtemps des parangons de vaillance? On les loue à présent, et pourtant, il y a peu encore, on les ignorait, on tenait leur engagement pour acquis, on soupesait leur mérite comme on calcule une marge de bénéfices, et vous verrez que dès demain, Mesdames et Messieurs, ce que vous appelez ‟héroïsme” aura revêtu ses vieux atours, cela s’intitulera ‟cahier des charges” ou ‟catalogue de prestations”! ». Mais déjà, plus personne ne l’écoute. La poupée de la Sociologie s’époumone encore un peu, puis finit par quitter la scène, désabusée. « Ils ne comprendront donc jamais », l’entend-on maugréer dans les coulisses. C’est au tour d’une jolie marionnette bronzée de venir au devant du public. Elle se distingue tout de suite de ses prédécesseures en déclarant : « Je comprends votre déception, tout cela est à vrai dire un peu ethnocentré ». Les spectateurs devinent alors : c’est l’Anthropologie qui s’adresse à nous ! « Le courage est universel, mais il est partout différent », commence-t-elle. Un insolent dans l’audience l’interrompt : « Comment le reconnais-tu, alors ? », et de se mettre les rieurs de son côté. La statuette est prise au dépourvu. « Eh bien, quoi, c’est le courage, simplement ! » balbutie-t-elle. L’effronté pousse alors son avantage : « Et comment sais-tu que ce dont tu parles, c’est bien du courage, sinon par tes références occidentales ? Parle-nous donc de nous, ou ne nous parle pas ! ». Cette fois, l’assemblée entière éclate de rire. La poupée prend la mouche. « Ils n’ont donc aucune ouverture d’esprit», marmonne-t-elle. A vrai dire, elle n’a pas le temps de s’appesantir sur sa déception.
Acte III
Trois autres personnages débarquent tous ensemble pour la remplacer. Ils sont vêtus d’élégants complets-vestons et se comportent comme s’ils étaient les premiers à fouler les planches de la scène. « Nous sommes Biologie, Neurosciences et Génétique, et nous allons vous expliquer ce qu’est le courage ! ». La lumière diminue, un écran blanc se déploie et, bientôt, on y projette de fort belles diapositives. Durant la présentation, on apprend que le courage existe car il fournit un avantage évolutif ; qu’il se situe dans une zone bien précise du cerveau, celle qui s’allume quand on fait une IRM fonctionnelle à des gens valeureux ; et que l’on est même parvenu à isoler le gène du courage. Tout cela, les savants n’ont à vrai dire pas besoin de l’affirmer : c’est la p value qui le dit. Les trois comparses finissent leur exposé et le public, impressionné, applaudit à tout rompre. A présent, au moins, les choses sont claires. Ce n’est pas du blabla. Une petite dame dans l’assemblée intervient malgré tout : « Excusez-moi, mais je me demandais… C’est sans doute idiot… Je me demandais comment vous vous y étiez pris, au début, pour définir à l’avance, pour ainsi dire avant l’expérience, ce que vous alliez chercher? ». Les marionnettes savantes réfléchissent, discutent un instant entre elles. « C’est une excellente question », répond finalement l’une des trois spécialistes. « Nous avons utilisé des critères précis de définition du courage, que vous trouverez en annexe de la publication. Mais, à la lumière de votre interrogation, il nous apparaît clair que si voulions y répondre tout à fait, il nous faudrait aussi comprendre comment nous avons abouti à de tels principes descriptifs. Nous devrions alors sans doute effectuer des recherches d’un nouveau genre… ». Une des trois comparses prend le relais avec enthousiasme : « Oui, nous pourrions, par exemple, investiguer dans le passé les définitions variables du courage qui ont mené à celle qui nous sert aujourd’hui. Nous devrions aussi enquêter sur le rôle de cette valeur dans notre société, et même, qui sait, comparer tout cela avec d’autres civilisations dans le monde ! Ainsi, nous aurions une base solide pour répondre à votre question ». A ce moment précis, le public réalise qu’il a été dupé. La salle résonne de huées, on jette des tomates sur les pantins. Les malheureux ne comprennent pas ce qui leur arrive. On décide de mettre fin à la représentation. Au dernier moment, toutefois, une créature tente de se faufiler sur la scène. En vain : on lui en interdit l’accès avec fermeté. Quelques personnes dans la salle pensent avoir aperçu la silhouette malingre de la Théologie. Voilà, le rideau se baisse. Le spectacle est terminé.
Epilogue
A l’heure d’interpréter les résultats de notre expérience, on ne peut rien déduire de très concluant (comme pour l’hydroxych…), sinon, peut-être, que nos poupées savantes semblent ne jamais discuter d’une version de la bravoure qui convienne au public. On devine ici, séparant les spectateurs des comédiens, un quatrième mur d’un genre singulier. Comme si, en réalité, les uns et les autres ne parlaient pas de la même chose. Quoique les marionnettes s’expriment avec le langage de la raison, il semble qu’elles ne trouvent pas les mots justes. Et si leurs tentatives de rationalisation étaient vouées à l’échec non du fait d’une éventuelle maladresse de leur part, mais de la nature même de leur objet d’étude ? Qu’on l’historicise, qu’on le fonctionnalise, qu’on l’essentialise, l’étrange remède qu’incarne le courage au temps du coronavirus résiste à l’enfermement dans un registre scientifique préconçu. A l’évidence, une formidable mécanique s’est mise en branle pendant l’épidémie, enclenchant d’un mouvement tous les ressorts de la rhétorique – ethos, logos et pathos – pour aboutir à la création d’un nouveau récit. Une odyssée revisitée, en quelque sorte : Pénélope confinée, Ulysse, en fait de cyclope, aux prises avec un virus et, en prime, l’inversion du genre des personnages. Ainsi envisagée, la performance collective de création d’héroïsme, par sa teneur irrationnelle, sa visée transcendante et sa nécessité esthétique, ressemble alors à de l’art. A la façon du cancre de Prévert balayant tout d’un coup les problèmes que le maître lui impose de résoudre, la communauté des mortels, face au microbe et ses menaces apocalyptiques, devant ses propres failles aussi, a tout effacé, « les chiffres et les mots », « les dates et les noms », « les phrases et les pièges », pour dessiner d’un geste unanime et cathartique, sur le tableau noir des décomptes morbides, non « le visage du bonheur », mais celui de la vertu. L’œuvre, si l’on veut bien consentir à la nommer ainsi, paraît spontanée, pétrie d’automatismes, au point de porter sur elle un stigmate surréaliste. Sidérante sous certains aspects, elle a pourtant constitué l’imago agens de la lutte contre l’épidémie, celle du soutien populaire aux personnes engagées, banderoles devant les hôpitaux et foules applaudissant sur les balcons. Certes, l’œuvre est bien fille du temps et du lieu. Elle n’échappe pas à la possibilité d’une critique au sens second et, à plusieurs égards, elle ressemble à notre monde : en ce qu’elle paraît en effet autocentrée, qu’elle est produite en quantité industrielle, qu’elle témoigne d’une communion exacerbée mais en partie virtuelle et qu’elle figure de naïves retrouvailles avec une lugubre inconnue – la mort. Qu’importe, cependant, si notre création n’a pas tout à fait l’allure des tragédies anciennes. Comme l’écrivit Théodor W. Adorno en une jolie formule : « l’art est la magie délivrée du mensonge d’être vrai ».
Léonard Dolivo est médecin diplômé et doctorant FNS en histoire de la médecine à l’Institut des humanités en médecine de Lausanne (Unil-CHUV). Il travaille sur les discours médicaux sur les convulsions de Willis (1621-1675) à Tissot (1728-1797) et s’intéresse par ailleurs à tous les domaines des humanités en médecine. Le reste du temps, il promène son bulldog anglais nommé Archibald (2019-…).
Image ©Gratisography