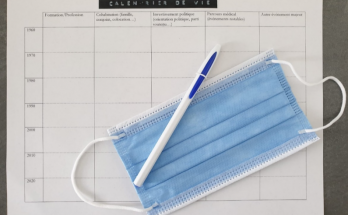Par Patrick Gaboriau et Christian Ghasarian
La « crise épidémique » du covid-19 se comprend au regard de multiples facteurs, parmi lesquels les facteurs sociaux et culturels ont été largement sous-estimés. Pourtant, ils permettent de mieux saisir les différences de gestion de l’épidémie et de mortalité au covid-19 d’un pays à l’autre. Dans ce contexte la crédibilité de la parole publique est cruciale. Lorsqu’elle est contestée, le sentiment d’unité collective s’amoindrit, donnant place à l’amertume et aux antagonismes sociaux prévisibles de l’après-confinement. Alors que les Suisses font dans l’ensemble confiance au Conseil fédéral et soutiennent ses décisions face à l’épidémie, avec une minorité estimant même que l’on pourrait aller plus loin, la situation est toute autre en France.
À propos des inégalités, l’économiste politique Alfred Hirschman parle de « l’effet tunnel ». Deux files de voitures à l’arrêt sont dans un tunnel et il est interdit de franchir la ligne qui les sépare. Soudain, une file se met à avancer. Les conducteurs de l’autre file sont d’abord emplis d’espoir car ils pensent que leur file va progresser sous peu. Mais si, au bout d’un certain temps, ils n’avancent toujours pas, alors ils s’énervent, se plaignent et adoptent des conduites à risque ; au final, ils revendiquent le droit d’avancer eux-aussi, ils franchissent l’interdit et déboîtent pour prendre la file rapide.
Comparativement à l’Allemagne, avec laquelle la France se mesure sans cesse, la file dans ce dernier pays stagne, et dans cette file nationale, une autre file, celle des plus défavorisés, stagne encore plus… Quatre fois plus de morts en France, pourtant moins peuplé. Ces résultats médiocres, semblables à ceux de pays latins, l’Espagne et l’Italie, invitent à comprendre les différences. Pourquoi les résultats de certains des voisins de la France outrepassent-ils les efforts pourtant ô combien méritoires des équipes médicales ? La comparaison éveille un sentiment local d’amertume. Au final, après le confinement, comme chez ceux qui changent de file et transgressent l’interdit, un « énervement » collectif se dessine et profile une possible sortie du confinement agitée.
Pour expliquer la variation de la mortalité, nombre de facteurs sont à prendre en compte. Ainsi, la richesse économique du pays, les possibilités généralisées ou non d’accéder aux soins (grâce à la protection sociale et aux assurances). De même, la situation géographique du pays paraît essentielle. Il est plus facile de contrôler les frontières danoises ou portugaises (pays qui n’ont de frontières terrestres qu’avec un pays) que françaises, avec ses huit pays frontaliers. Ou encore, la densité de population semble essentielle (14,7 habitants au kilomètre/carré en Norvège, 93,0 en Espagne, 119,1 en France, 201,6 en Italie). L’extension de la maladie progressera d’autant moins vite que la densité est faible. À Paris, avec une densité de 21 067 habitants par km2, la situation n’est pas la même qu’à Oslo, avec 1 521 habitants par km2. Par ailleurs, l’épidémie touche davantage les régions de circulation du commerce international et les villes-mondiales (Londres, Paris, New York, Bruxelles, Madrid, Turin, Milan).
Cependant, à côté d’influences multiples qui exercent des effets sur la représentation du danger et la mortalité plus ou moins forte, un facteur culturel joue un rôle essentiel : le caractère crédible ou discrédité de la parole publique. Anthropologues, nous nous sommes posés la question de savoir ce qui, en France ou ailleurs, rend crédible le discours public. En effet, pour que le pouvoir politique soit crédible, certains éléments semblent décisifs et doivent être collectivement ressentis et, parmi ceux-ci, le sentiment de solidarité est essentiel. Un exemple. Dans l’île de Rapa, en Polynésie française, toute la population s’est, à l’initiative du maire, réunie en mars, avant l’arrivée du premier bateau pouvant potentiellement comprendre un ou des passagers porteurs du virus (l’île n’a une liaison avec le monde extérieur que par un bateau tous les deux mois). Après de longs échanges dans lesquels beaucoup d’habitants prirent la parole, il fut collectivement décidé de mettre en quatorzaine la soixantaine de passagers du bateau dans l’école du village, aménagée à cet effet. Des personnes se distribuèrent des tâches pour rendre ce confinement possible (approvisionnement en nourriture, préparation des repas, soutiens divers à distance…). Tout le monde fut d’accord pour agir ainsi, pour le bien de tous, y compris les confinés, qui ont depuis réinséré leur familles dans l’île, qui s’avère aujourd’hui non touchée par le virus. Ainsi, aux antipodes, des Français du Pacifique, qui auraient été totalement démunis si le virus avait proliféré, ont, ensemble avec leur maire (qui vient d’être réélu au premier tour pour son sixième mandat), pris leur destin en main pour se protéger.
L’existence ou non d’un rapport de confiance préalable à la crise sanitaire est déterminant. Or, en ce qui concerne la France métropolitaine, rappelons les préambules. En effet, les carences et, pour d’autres, les forces, s’inscrivent dans une histoire récente, pour laquelle on aurait tort de diminuer l’importance ou de postuler l’amnésie. Bien avant le confinement, le pays était sur une file qui n’avançait guère, submergés par d’autres crises. D’abord celle des Gilets jaunes. La réponse répressive fit deux à trois mille blessés parmi les membres de ce mouvement, parmi lesquels plus de quatre-vingt gravement (main arrachée, œil éborgné). Ces drames ont touché des familles entières, qui n’oublient pas. Les propos récents du préfet de police de Paris montrent une poursuite de la ligne répressive. La phrase de décembre dernier « Allez-y franchement, n’hésitez pas à percuter, ça fera réfléchir les autres », adressée aux CRS, résonne encore lorsqu’il ose dire en avril « Ceux qui sont aujourd’hui hospitalisés, ceux qu’on trouve dans les réanimations, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l’ont pas respecté, c’est très simple, il y a une corrélation très simple » – une phrase qui constitue une véritable insulte au corps médical, en première ligne, particulièrement touché par le virus. Ensuite, la grève pour annuler la réforme des retraites, largement soutenue par la population, aura été la plus longue de ces trente dernières années. L’un et l’autre mouvement cessèrent parce que, de fait, les rassemblements furent interdits en vertu d’une loi d’exception qui ne porte pas son nom.
Préparation et conscience collective vont de pair. En France, très vite, l’impréparation sauta aux yeux : alors que les forces de l’ordre ne manquaient ni de bombes lacrymogènes ni de balles LBD, la population ne disposait ni de masques ni de dépistages massifs ni de gel hydroalcoolique. Cette imprévoyance s’associa au sentiment d’être berné. Au nom de la Science, les carences furent proclamées comme étant des précautions inutiles. À la population, sous-équipée et sans munitions, le pouvoir expliqua que les armes ne servaient à rien. Quand la « guerre » contre le virus débuta, le pays était déjà vaincu par son impréparation. L’attente du virus, c’était la drôle de guerre, et après ce fut la déroute. À titre de comparaison, en 2018, le gouvernement suédois distribuait à l’ensemble de sa population une brochure de vingt pages titrée « Si une crise ou la guerre vient. Information importante pour la population suédoise », où le choix et la quantité de nourriture, d’eau et des vêtements étaient indiqués, préparant psychologiquement la population et la mettant à l’abri de queues dans les magasins et de rayons vides.
Des prises de décisions diligentes et fondées rassurent les populations. En France, le temps de réaction politique aura été fatal. Il faut se rappeler la communication officielle pendant les premières semaines, quand les automobilistes venant d’Italie entraient librement, quand le journal télévisé expliquait que les hôpitaux italiens étaient mal organisés et qu’il n’était, hélas, pas possible de fermer les frontières et de stopper les échanges internationaux (« Le virus n’a pas de frontière », nous disait le président). Idem pour le premier tour des élections municipales : avec le gel hydroalcooliques et la distance de sureté entre les votants, il n’y avait soi-disant aucun risque de contamination… Au stade premier, de cette indécision politique résulta quelques milliers de décès en plus.
D’autres facteurs, plus sociologiques, jouent également un rôle dans les différences d’impact du virus, notamment la retenue que l’on accepte et que l’on peut se donner. Sans tomber dans un culturalisme réducteur, les habitants des pays latins semblent davantage réfractaires aux interdits édictés par l’Etat. En Suisse par exemple, il n’y a pas de confinement obligatoire mais les gens évitent de sortir. Seuls les rassemblements de plus de cinq personnes sont interdits par la Confédération. Pourtant, un sondage révèle que les Suisses romands, conscients de l’existence d’un rapport régional plus flexible à la loi que dans le reste du pays, demandent la mise en place de mesures de restrictions de circulation plus sévères que les Suisses alémaniques (beaucoup moins touchés par la contamination que les Suisses Romands et Tessinois), qui croient davantage en la responsabilité individuelle. Les éthiques protestantes et catholiques reposent sur un rapport différent à la persuasion, à l’autorité et au devoir, comme le montrait Max Weber.
L’égalité de traitement entre les citoyens doit être confirmée dans les faits pour qu’un climat de confiance s’instaure. En France, l’exacerbation des inégalités diffusa un vague sentiment d’écœurement, défavorable au sentiment communautaire. Beaucoup parmi les plus riches purent quitter le bateau des villes, s’approvisionner et partir dans leur maison de campagne ou à la montagne. Les « fractures sociales » semblent exacerbées : fracture économique (habitat spacieux ou restreint, revenu suffisant pour faire des provisions et appareils ménagers pour stocker ou non) ; fracture numérique (avec ou sans internet) ; fracture intellectuelle (avec ou sans livre, intéressé ou non par la lecture). Les conditions défavorables s’additionnant, les pauvres d’avant la crise deviennent miséreux, souffrant de la faim.
La faible crédibilité du pouvoir en place se note dans les sondages : « 76% des Français et 81% des professionnels hospitaliers estiment que l’Etat a failli et aurait pu en faire davantage pour éviter la propagation de l’épidémie » (OdoxaSondages du 17 avril 2020). Le Président paye maintenant son discours d’autorité, qui obligeait, alors que d’autres leaders politiques tenaient un discours d’adhésion, qui incitait et invitait. Pour les Suédois, il s’agit de prendre ses « responsabilités communes » ; pour les Allemands, Angela Merkel demande de faire « preuve d’une grande endurance et d’une grande discipline », alors que les Français restent sans moyens contre un « ennemi » invisible, le virus, avec le risque d’une amende de cent trente-cinq euros pour non-respect du confinement, et le sentiment d’un sauve-qui-peut général où la frange aisée, une fois encore, s’en sort au mieux.
À vouloir imposer ses conceptions par la force, y compris policière, à tergiverser et mentir, le pouvoir politique français a perdu l’adhésion et le soutien du peuple, maintenant indispensable au moment du déconfinement. En lieu du sentiment d’appartenance et de cohésion sociale resurgiront les défiances sociales, car la question essentielle sera : reprenons-nous le cours du monde, comme avant, ou s’agit-il d’instaurer une autre forme d’organisation et de changer de modèle économique ? Les manifestations des Gilets jaunes reprendront-elles le samedi ? L’impôt sur les grandes fortunes serait-il mis en place ? Lorsque le malaise dans la crédibilité s’instaure, les luttes sociales constituent le seul champ possible, elles constituent le moyen, pour les conducteurs dont la file n’avance pas, de se faire entendre.
Patrick Gaboriau est anthropologue, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS, membre du Lavue, et du groupe Alter). Ses travaux portent sur la France, la Californie et la Russie. Ils concernent l’anthropologie urbaine, les personnes sans logis, les phénomènes de sorcellerie, l’ethnopsychiatrie et l’épistémologie des sciences sociales.
Christian Ghasarian est professeur en ethnologie à l’Université de Neuchâtel. Après des recherches sur le multiculturalisme à l’île de La Réunion, il a été et été chercheur associé à l’Université de Californie à Berkeley, moment où il a étudié les ajustements sociaux et culturels des transnationaux de l’Inde dans la Silicon Valley. Ses recherches actuelles portent sur les pratiques cosmopolites dites “New Age” et sur les relations sociales en Polynésie.