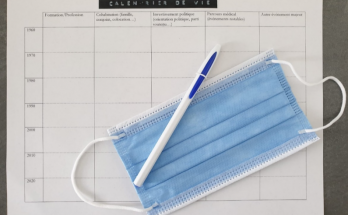Par Oriane Sarrasin, avec Robert Avery, Aurélien Graton, Valentin Gross, Ocyna Rudmann, Cinzia Zanetti
En tant qu’expert·e·s en psychologie sociale, les parallèles et divergences entre la crise du covid-19 et l’urgence climatique, et plus particulièrement sur la manière dont la population y réagit, nous interpellent profondément. Face à une pandémie, la très grande majorité des individus a accepté des mesures restreignant strictement son quotidien et ses libertés individuelles. Il en est tout autre quand il s’agit de lutter contre le profond dérèglement climatique que l’humain a provoqué. Depuis des décennies, la communauté scientifique alerte sur l’état catastrophique de la planète et les dégradations encore bien pires auxquelles nous ferons faces dans les prochaines décennies. Ces appels ont été intensifiés ces dernières années, notamment lors de la COP21 à Paris en 2015 et dans le rapport 2018 du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat). Saisies par ces perspectives alarmantes, des voix additionnelles se sont élevées, des manifestations et actes de désobéissance civile organisés… Malgré cela, pour l’écrasante majorité non seulement des mondes politiques et économiques mais également de la population, c’est « business as usual ». Pourquoi accepter des mesures pour lutter contre le covid-19, et pas pour le climat? Il va sans dire que les deux situations divergent sur un certain nombre de points, notamment sur la temporalité des mesures proposées (à court terme et réversibles dans le cas du covid-19, pérennes dans le cas du climat). Mais ce n’est pas de cela que nous souhaitons discuter ici… En tant que chercheur·e·s en psychologie sociale, nous sommes convaincu·e·s qu’un élément central de la manière dont l’humain traite mentalement ce qui l’entoure—à savoir la distance psychologique avec laquelle on perçoit les objets—explique en grande partie les différences entre les réactions face aux mesures pour lutter contre le covid-19 et celles pour lutter contre le dérèglement climatique. Cruciale, cette comparaison nous fournit des pistes quant à comment présenter l’urgence climatique pour pousser les individus à agir.
L’humain est capable de se représenter des « objets » (ce mot décrivant tout autant une chose physique qu’une activité ou un phénomène de large ampleur) qui ne sont pas directement en sa présence (par exemple, situés à un autre endroit ou dans le futur). Ceci est dû à sa capacité à former des représentations abstraites des objets dits distaux (pour en savoir plus sur cette capacité, voir Trope et Liberman, 2010). Par exemple, si l’on pense à un repas chez des ami·e·s (cela fait du bien de se rappeler que ce genre d’activités existe…), ce qui s’active généralement dans notre cerveau, ce ne sont pas forcément tous les détails de la future soirée (le contenu des plats, l’heure exacte etc.) mais une impression diffuse de « moment sympa » (ou alors si ce n’est pas le cas il faut réfléchir si ce sont vraiment des ami·e·s!). Nous avons dans notre tête un « prototype », basé sur nos propres expériences mais également sur les normes sociétales, de ce qu’est un repas entre ami·e·s. La distance psychologique entre des objets et nous-même se décline sur quatre plans, qui interagissent entre eux: temporel, géographique, social et hypothétique. Ainsi, un objet peut être éloigné dans le temps et/ou dans l’espace, mais également peut ne pas toucher des personnes que l’on connaît et ainsi être perçu comme plus ou moins probable. C’est donc au prisme de ces dimensions de la distance psychologique que nous analysons les réactions face à la crise du covid-19 et au dérèglement climatique.
Fin 2019 et début 2020, en Europe le covid-19 était encore (très) distant psychologiquement. En effet, non seulement l’existence de ce virus était limitée à un autre continent, mais il ne touchait aussi (sauf dans de très rares cas) que des gens que l’on ne connaissait pas, et sa “sortie” d’Asie n’était qu’un seul scénario parmi ceux possibles. Au fur et à mesure que le phénomène se rapprochait de nous, grandissait l’acception des mesures proposées et apparaissaient des voix pour en réclamer de plus strictes. Au moment-même où nous écrivons ces mots, le pic épidémique semble dépassé dans la plupart des pays européens, et l’acceptation de mesures protégeant les plus faibles commence à faiblir dans certains milieux. Quoiqu’il en soit, même si certaines courbes tendent à s’aplanir, l’objet « covid-19 » reste et restera dans un futur proche indubitablement moins distant psychologiquement que le dérèglement climatique, un phénomène par nature complexe et multi-facette (sur ce sujet, voir McDonald, Chai et Newell, 2015). En effet, même si les effets du dérèglement climatique se font de plus en plus sentir en Europe (par exemple, lors d’épisodes caniculaires en été, via la raréfaction de la neige l’hiver), le moment où nos vies ou celles de nos proches seront potentiellement en danger immédiat est perçu comme distant. De plus, les multiples attaques des mondes politiques et économiques sur la crédibilité du phénomène (alors qu’un consensus scientifique existe) renforce la dimension hypothétique, rendant mentalement l’objet encore plus distant de nous. Est-il donc nécessaire d’expérimenter le dérèglement climatique de plein fouet pour accepter de changer son mode de vie?
La réponse est NON. Il semble certes qu’une diminution de la distance psychologique entre le dérèglement climatique influence nos perceptions et notre volonté d’agir. Il a par exemple été démontré scientifiquement que vivre des phénomènes climatiques extrêmes augmente la probabilité que l’on croie que le climat se dérègle (voir McDonald et al., 2015). Cependant, la recherche suggère également que la volonté de lutter contre les atteintes à la biosphère, notamment en acceptant des restrictions importantes de ses libertés individuelles, nécessite un certain niveau d’abstraction dans la manière dont on se représente le dérèglement climatique (voir le même article). En effet, même s’il nous est présenté comme (plus) proche temporellement, spatialement et socialement, le dérèglement climatique reste, malgré tout, un phénomène complexe, impliquant des interdépendances entre les lieux (ce qu’on fait ici impacte ce qui se passe ailleurs), entre les générations (ce qu’on fait impactera la vie des enfants d’aujourd’hui et à venir) et entre les phénomènes (un problème climatique en renforce un autre, et ainsi de suite, menant hypothétiquement au fameux point de bascule). De plus, la promotion des luttes pour le climat ne pourra jamais être aussi simpliste qu’un message anti-environnemental tel que « les écologistes veulent détruire l’économie »! Comment agir alors? Comment convaincre la grande majorité ne faisant que peu ou rien pour le climat de soutenir des mesures permettant la sauvegarde de la biosphère et de l’humanité?
Les pistes de réponses sont nombreuses … L’une, prometteuse, pourrait être de ne pas « lâcher le morceau », de présenter encore et encore les perspectives catastrophiques auxquelles nous faisons face, dans toute leur horreur et leur complexité (en créant donc ce qui se nomme en jargon « un appel à la peur ») mais en les accompagnant toujours de solutions pratiques et réalistes. En effet, il est conseillé d’allier grands buts abstraits (le « pourquoi ») avec des éléments concrets (le « comment ») afin de favoriser les actions pour l’environnement (voir par exemple Rabinovich et al., 2009)! Et ceci à tous niveaux: à l’école, dans la presse, dans les campagnes politiques… Ces éléments concrets de solution ne doivent cependant pas s’inscrire uniquement dans une perspective individualisante, où l’individu, par ses actions propres, est responsable de l’état de la planète et de son potentiel sauvetage (Maniates, 2001). En effet, exposer les individus à la complexité et la gravité du dérèglement climatique ne doit pas uniquement s’accompagner de messages (parfois culpabilisants) dont le but est de les pousser à diminuer leur empreinte écologique personnelle (même s’il est indéniable qu’il est important de le faire). A ce titre, un récent courant en psychologie de l’environnement met en avant l’importance du collectif, tout autant dans les représentations du dérèglement climatique mais également dans les réponses à y apporter (Fritsche et al., 2018). Une de ces représentations collectives, construites et partagées entre individus, par les milieux politique et économique, les médias, etc. touche au rôle de l’Etat, et en particulier aux droits qu’on lui confère à intervenir. Du fait des décisions prises et des sommes importantes débloquées, la crise du covid-19 a certainement renforcé la manière dont on se représente le pouvoir de l’Etat de « nous » (individus, entreprises etc.) sauver. Au vu des importantes barrières individuelles au changement (nommées « les dragons de l’inaction par Gifford, 2011), il serait donc maintenant temps de s’interroger si la piste à prendre ne serait pas d’initier et de soutenir bien davantage l’action de l’Etat à intervenir dans la lutte pour le dérèglement climatique.
Fritsche, I., Barth, M., Jugert, P., Masson, T., & Reese, G. (2018). A social identity model of pro-environmental action (SIMPEA). Psychological Review, 125, 245-269.
Gifford, R. (2011). The dragons of inaction: Psychological barriers that limit climate change mitigation and adaptation. American Psychologist, 66, 290–302
Maniates, M. F. (2001). Individualization: Plant a tree, buy a bike, save the world? Global Environmental Politics, 1, 31-52.
McDonald, R. I., Chai, H. Y., & Newell, B. R. (2015). Personal experience and the ‘psychological distance’ of climate change: An integrative review. Journal of Environmental Psychology, 44, 109–118.
Rabinovich, A., Morton, T. A., Postmes, T., & Verplanken, B. (2009). Think global, act local: The effect of goal and mindset specificity on willingness to donate to an environmental organisation. Journal of Environmental Psychology, 29, 391–399. Trope, Y., & Liberman, N. (2010). Construal-level theory of psychological distance. Psychological Review, 117, 440e463.
Oriane Sarrasin (maître assistante, UNIL), Robert Avery (assistant diplômé, UNIL), Aurélien Graton (Maître de conférence, Université Savoie Mont-Blanc), Valentin Gross (doctorant FNS, UNIL), Ocyna Rudmann (doctorante boursière, UNIL) et Cinzia Zanetti (assistante diplômée, UNIL) sont chercheuses et chercheurs en psychologie sociale. Leurs intérêts de recherche portent sur l’environnement (Oriane, Robert, Aurélien et Valentin), la désirabilité sociale (Ocyna) et la triche collective (Cinzia).