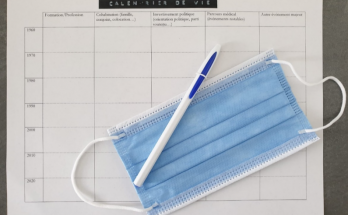Par Laura Bernardi
Crise sanitaire, vulnérabilité socioéconomique et personnes à risque : sur l‘importance de collecter des données sur la situation socioéconomique des individus par le biais des enquêtes longitudinales de longue durée.
Depuis le début de la crise sanitaire actuelle, nombreuses sont les initiatives de recherche qui se sont accumulées. La plupart des études, suivant souvent le sens de la demande des autorités, cherchent à identifier les facteurs de risque du point de vue épidémiologique et médical (âge avancé, genre et présence de pathologies chroniques). Ces études ne se sont que très rarement focalisées sur la position socioéconomique des personnes en la liant au risque d’infection et de décès. Cela ne surprendra pas, car les bases de données qui permettent actuellement de connaître la prévalence de l’infection par statuts socioéconomiques, que ce soit par le niveau d’instruction, par le statut professionnel ou le revenu n’existent pas encore. Ce qui est surprenant est que l’importance de ce genre d’information ait été mise en doute, ou n’ait pas été considérée comme une connaissance cruciale avant que la crise à laquelle nous sommes confrontés n’en démontre la nécessité.
Nous savons en effet que pendant le SRAS les désavantages socioéconomiques se sont traduits en risques plus élevés d’infection et de mortalité. Plus généralement, nous savons qu’il y a un gradient socioéconomique en matière de santé et de mortalité. Nous savons que l’exposition, la probabilité d’être infecté, la qualité des soins et la mortalité ne sont jamais distribuées de manière aléatoire dans la population, et il n’y a pas de raison de croire qu’il en soit autrement dans la crise actuelle.
Les mécanismes qui produisent un risque différencié en matière de santé et de mortalité sont multiples, certains directs et certains indirects. Pour en citer quelques-uns, considérons premièrement l’exposition directe et indirecte au risque d’infection due au type de travail et à la mise à l’épreuve différenciée du système immunitaire. L’exposition directe concerne en particulier les emplois liés au soin ou à des services qui ont forcément plus d’opportunités de contacts avec les personnes déjà infectées. L’exposition indirecte est liée, par exemple, au stress et aux conséquences négatives de ce dernier sur le système immunitaire. Un haut niveau de stress peut être lié à des occupations intrinsèquement plus dangereuses ou à des emplois dont la précarité se révèle durant cette pandémie (comme les travailleurs ad intérim, les saisonniers, les restaurateurs, les prestataires de soins à domicile, mais aussi les travailleurs dans l’économie des petits boulots indépendants et non protégés, la gig economy). Dans ce dernier cas, la crise risque fort de coïncider avec la perte de l’emploi et l’appauvrissement dans un mécanisme de cumul de désavantages qui rend les personnes vulnérables encore plus vulnérables. Deuxièmement, des conditions de vie moins avantageuses impliquent souvent de partager son quotidien dans des espaces et des logements à la fois plus petits et plus peuplés. Le risque de maladie y est donc probablement plus élevé, soit parce que garder une distance sociale est moins aisé, soit parce qu’il est plus difficile de s’y isoler pour longtemps en cas d’infection. Troisièmement, la capacité de prévention en matière de santé est strictement liée aux possibilités de s’informer, comprendre et suivre un style de vie sain, que ce soit en matière de nutrition, d’hygiène de vie, ou de respect de la distanciation sociale.
Ce qui précède ne présente que quelques-uns des arguments en faveur de l’hypothèse suivant laquelle il existe un gradient social au risque d’infection. Cependant, si les indicateurs socioéconomiques ne sont pas pris en compte dans les jeux de données sur la pandémie, comme c’est le cas des données officielles actuelles mises à disposition par l’Office fédéral de la santé publique, ces différences resteront invisibles, mais pas pour autant inexistantes. Connaître les déterminants socioéconomiques du risque lié au COVID est crucial, non seulement pour estimer la portée des inégalités sociales face à la crise sanitaire, mais aussi pour définir et mettre en œuvre des stratégies de prévention et de santé publique plus efficaces.
Des initiatives pour collecter des données plus riches sont apparues de manière apparemment peu coordonnée à travers les régions et les Etats ; elles se traduisent en plusieurs enquêtes réalisées via web avec de bases d’échantillonnage variées et plus au moins représentatives de la population. Bien que la plupart de ces enquêtes fournissent sans doute des informations utiles, elles permettent difficilement de comparer les niveaux de risque par statuts socio-économiques car nous disposons souvent de peu d’information sur la situation des individus et des ménages antérieure à la crise. Quand cette information est demandée rétrospectivement pendant la crise, elle risque d’être biaisée par la situation actuelle, surtout en ce qui concerne des dimensions plus subjectives comme le niveau de stress et de bien-être.
C’est donc au travers de données longitudinales produites par des enquêtes auprès de panels qui réinterrogent régulièrement un même échantillon de personnes et qui ont été initiées bien avant la pandémie actuelle, que nous pourrons estimer la vulnérabilité individuelle à la maladie de manière adéquate. Forte de cette conviction j’ai embrassé l’idée, en collaboration avec des chercheuses et chercheurs de FORS (Centre de compétences suisse en sciences sociales), d’introduire rapidement une « vague COVID » au Panel suisse des ménages (PSM) : l’enquête représentative de la population suisse qui a démarré en 1999 et contient, parmi d’autres, des informations sur la situation socio-économique, démographique et la santé de personnes. La vague COVID a été lancée en mai 2020, avec un taux de réponse très encourageant jusqu’ici et vise à interroger au moins 4’000 individus qui participent déjà au PSM. Elle permettra bientôt de comparer la situation avant la crise et les risques associés, pendant et après la crise. Il sera ainsi possible et particulièrement intéressant d’étudier les conséquences à court et moyen terme de la pandémie sur différentes sous-populations, puisque l’enquête continuera à interroger les mêmes personnes dans les années à venir. De plus, l’enquête « COVID » du PSM est en partie comparable à d’autres panels réalisés en Allemagne dans le cadre de l’enquête socioéconomique SOEP, au Royaume-Uni, en France et en Australie. Tous ces pays ont été touchés par le COVID presque au même moment, mais ont mis en place des politiques relativement différentes en matière de temporalité, de restriction des mouvements de population, ainsi que de politiques d’aide sociale à destination des plus défavorisés. Dans les prochains mois, nous aurons ainsi la possibilité de comparer l’effet du contexte national sur la distribution des vulnérabilités liées à la pandémie de COVID.
Laura Bernardi est professeure de démographie et sociologie du parcours de vie à l’Université de Lausanne et responsable de projets dans le centre de recherche LIVES. Elle est également membre du conseil scientifique de FORS – Centre de compétences suisse en sciences sociales. Elle étudie l’évolution des familles et des parcours de vie dans leur fascinante complexité et diversité.