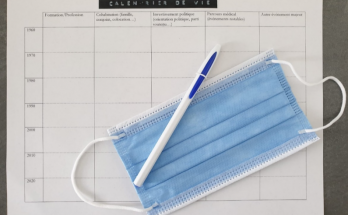Par Francesca Bosisio
L’épidémie de Covid-19 en cours montre à quel point la santé est un « fait social total » qui doit être appréhendé à plusieurs niveaux. Dans ce contexte, « anticiper » s’est révélé une manière de « prendre soin » non seulement des personnes les plus vulnérables, mais également de leurs proches, du personnel soignant et médical, et du système de santé lui-même.
Anticiper pour soigner
Durant l’épidémie de Covid-19, l’anticipation a été la pierre angulaire du dispositif de soin cantonal et national de réponse à l’urgence socio-sanitaire créée par le virus. Au niveau du macrosystème des soins (le terme est utilisé ici au sens de Mohr & Batalden 2002), anticiper et prévenir la surcharge des infrastructures et l’épuisement des médecins et des soignants a permis non seulement de prendre soin des personnes les plus vulnérables, de leurs proches, du personnel soignant et médical, mais aussi du système de santé lui-même afin que nous puissions continuer à en bénéficier et ainsi à pouvoir prendre soin de nous et des autres. Au niveau du microsystème des soins, l’anticipation s’est traduite par la volonté d’étoffer l’éventail d’options thérapeutiques disponibles à l’extérieur de l’hôpital et d’encourager les personnes les plus à risque de développer des complications à réfléchir, à l’avance, aux soins qu’elles souhaiteraient recevoir si elles devenaient incapables de décider par elles-mêmes en raison de la détérioration de leur état de santé. C’est cette deuxième anticipation que je souhaite discuter dans le but de démontrer quelles sont les conditions d’une anticipation qui soigne. La pandémie constitue dans ce contexte une loupe qui nous permet d’observer des phénomènes moins visibles habituellement.
Nous sommes tous vulnérables
L’épidémie de Covid-19 nous a fait prendre conscience qu’anticiper est une manière de soigner, au sens de Joan Tronto. En effet, dans sa célèbre thèse, publiée dans les années 1990 avec le titre français « Un monde vulnérable », le soin (care) est défini comme une « activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre « monde », de sorte qu’on puisse y vivre aussi bien que possible. » (Tronto, 2009, p. 143). Dans les mots de Tronto, une société juste est une société qui reconnaît que nous sommes toutes et tous vulnérables et que nous faisons toutes et tous, à un moment ou à un autre, l’objet de soins.
Ce principe, cependant, est en profond désaccord avec les valeurs d’autonomie et d’indépendance défendues dans les sociétés occidentales, au sein desquelles la médecine est essentiellement conçue comme un moyen de restaurer l’autonomie et l’indépendance. L’épidémie de Covid-19 a montré que la santé est un fait social total (au sens de Mauss, 1920). En effet, la menace socio-sanitaire constituée par le virus a mobilisés la totalité de la société et des institutions et a, par ce biais, révélé la pertinence de la définition du soin de Tronto. La vision individualiste de l’autonomie a en effet montré ses limites en biomédecine par le passé – par exemple en matière de prévention ou de consentement – et la crise sanitaire et sociale engendrée par l’épidémie a mis en évidence la formidable source de motivation constituée par la prise de conscience – nous espérons permanente – que nous sommes toutes et tous vulnérables et dépendants. La pertinence de la notion de communauté dans le domaine des soins prend tout son sens dans les circonstances actuelles sur quatre niveaux : la détection des besoins de l’autre, la prise en charge de l’autre, l’adéquation de la réponse aux besoins de l’autre, et la capacité de réponse aux nouveaux besoins créés par la réponse aux besoins initiaux.
Une vision instrumentale des décisions anticipées en matière de soins
Les directives anticipées ont vu le jour dans les années 1960 dans le but d’étendre le pouvoir d’agir de patients au-delà de la perte – temporaire ou permanente – de leur capacité de discernement. Ces directives permettent en effet à toute personne d’indiquer les traitements médicaux auxquels elle consent ou non et de désigner un représentant thérapeutique. En l’absence de ce document, le Code Civil définit une liste de personnes habilitées, dans un ordre de priorité, à autoriser les procédures médicales ou les soins recommandés au patient.
Les directives anticipées traduisent une logique pragmatique (Habermas, 1991) et une vision individualiste de l’autonomie (Beauchamp & Childress, 2001) relativement populaires à toutes les échelles du milieu sanitaire. Sans surprise, l’observation des pratiques de soin, les sondages et la littérature scientifique démontrent que les
directives anticipées sont peu utilisées et ont un effet très limité. Les raisons sont multiples : d’une part, nous semblons peu enclins à discuter d’une détérioration de notre état de santé ou de notre mort et manquons généralement d’informations concernant les documents et démarches qui nous permettraient de nous exprimer par anticipation (Vilpert et al., 2018). D’autre part, la réflexion autour des directives anticipées s’est beaucoup focalisée sur la création de documents très explicites et détaillés, négligeant dans ce processus d’examiner l’adéquation de ces formulaires aux préférences et aux styles décisionnels de leurs auteurs (Hawkins et al., 2005). Plus problématique, les directives anticipées peuvent être remplies sans que les proches, plus particulièrement le représentant thérapeutique, ainsi que les médecins et soignants impliqués dans la prise en charge du patient ne soient informés de l’existence et du contenu de ces directives (Bosisio et al., 2018). Leur effet est de ce fait limité.
Vers une autonomie relationnelle en matière de décisions anticipées
Partout en Suisse, au cours de l’épidémie de Covid-19, des proches de personnes partiellement ou complètement incapables de discernement ont été appelés – des semaines après leur dernière visite – pour savoir si les directives rédigées devaient être mises à jour et/ou appliquées en cas de complications. Partout en Suisse des proches, des médecins et des soignants se sont demandé ce que la personne souhaiterait dans les circonstances de cette urgence sanitaire. Partout en Suisse, des proches, médecins et soignants se demandent s’ils ont pris la bonne décision.
J’aimerais défendre par ces quelques lignes l’idée que l’anticipation est une pierre angulaire du soin, cohérente avec la définition de Tronto. Une anticipation qui soigne est à mon sens une anticipation qui doit permettre de tisser et consolider un réseau de soutien qui reconnaît que nous sommes toutes et tous – patients, proches, médecins et soignants – vulnérables face à la maladie et à la menace existentielle.
Dans ce contexte, les directives anticipées constituent une opportunité pour toutes les personnes impliquées de s’informer et d’apprivoiser l’incertitude qui caractérise toute décision en prévision d’une perte de la capacité de discernement. Elles devraient permettre aux personnes qui participent à leur élaboration de prendre conscience du poids existentiel des décisions qui pèseront sur les épaules des proches, médecins et soignants lorsqu’il faudra mettre en oeuvre ces décisions anticipées. Il me semble ainsi essentiel de promouvoir des démarches capables de soutenir non seulement le pouvoir d’agir de l’auteur des directives anticipées, mais également de ses proches, médecins et soignants, et diminuer ainsi les urgences décisionnelles. Dans les pays anglo-saxons, le projet de soins anticipé (advance care planning en anglais) intègre les directives anticipées dans un processus de communication structuré facilité par un professionnel formé qui réunit le patient, ses proches, médecins et soignants dans le but de définir des objectifs des soins en prévision d’une perte de la capacité de discernement. Cette démarche fait ses preuves de plus en plus en Suisse et dans le canton de Vaud (Bosisio et al., 2019) et a montré sa valeur durant l’épidémie de Covid-19.
En conclusion, j’aimerais souligner qu’une anticipation qui soigne est une approche des soins en général et de la décision anticipée en particulier qui reconnait que nous sommes tous vulnérables face à l’urgence existentielle et que les êtres humains sont tous, par nature, dépendants. Une vision individualiste de l’autonomie a donc une portée limitée dans le soin et dans la décision anticipée. Une vision relationnelle de l’autonomie (Mackenzie & Stoljar, 2000) permet au contraire de promouvoir un système de santé qui valorise le lien avec les proches et la communauté et reconnait cette interdépendance comme un moteur essentiel du soin.
– Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2001). Principles of biomedical ethics. Oxford University Press.
– Bosisio, F., Fassier, T., Rubli Truchard, E., & Jox, R. (2019). Projet de soins anticipé ou advance care planning. Proposition d’une terminologie commune pour la Suisse romande. Revue Médicale Suisse, 15, 1634–1636.
– Bosisio, F., Jox, R., Jones, L., & Rubli Truchard, E. (2018). Planning ahead with dementia: What role can advance care planning play? A review on opportunities and challenges. Swiss Medical Weekly, 148(w14706).
– Habermas, J. (1991). The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society. MIT Press.
– Hawkins, N. A., Ditto, P. H., Danks, J. H., & Smucker, W. D. (2005). Micromanaging Death: Process Preferences, Values, and Goals in End-of-Life Medical Decision Making. The Gerontologist, 45(1), 107–117. https://doi.org/10.1093/geront/45.1.107
– Mackenzie, C., & Stoljar, N. (2000). Relational autonomy. Feminist perspectives on autonomy, agency, and the social self. Oxford University Press.
– Mauss, M. (1920). Essai sur le don: Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques. Paris: Presses Universitaires de France (PUF).
– Mohr, J. J., & Batalden, P. B. (2002). Improving safety on the front lines: The role of clinical microsystems. Qual Saf Health Care, 11(1), 45–50.
– Tronto, J. C. (2009). Un monde vulnérable: Pour une politique du care. Paris: La Découverte.
– Vilpert, S., Borrat-Besson, C., Maurer, J., & Borasio, G. D. (2018). Awareness, approval and completion of advance directives in older adults in Switzerland. Swiss Medical Weekly, 148(2930). https://doi.org/10.4414/smw.2018.14642
Francesca Bosisio est psychologue de la santé et responsable de recherche au ColLaboratoire, Unité de recherche-action, participative et collaborative de l’Université de Lausanne. Spécialiste de l’anticipation des décisions de santé, en particulier chez les personnes âgées, elle est en charge de plusieurs projets mandatés par la Direction générale de la santé et l’Office du médecin cantonal.